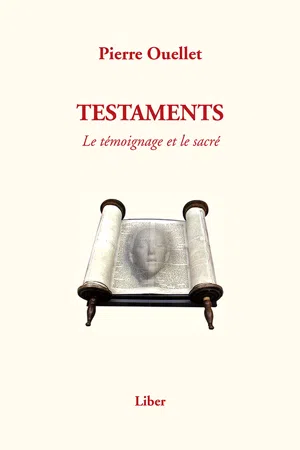![]()
Deuxième partie
Testamentaire
![]()
Au-delà des fins
« Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir… » Beckett nous a laissé, il y a déjà plus d’un demi-siècle, le leitmotiv de notre époque. Sa rengaine, sa ritournelle, qui nous reste dans la tête longtemps. Une comptine, une chansonnette, dont l’air, le rythme et le refrain nous fascinent et nous obsèdent. On n’entend plus que ce battement : fin de l’Homme, fin de l’Art, fin de l’Histoire… Mais l’entend-on toujours d’une même oreille ? Le comprend-on toujours dans le même sens ? Suivant la même leçon ? On s’y est habitué, accoutumé, au point d’en être intoxiqué, de faire chaque jour une overdose de cynisme dont on ne souffre même plus, insensible qu’on est à cette espèce de scie : mort de cela ou de ceci, de la civilisation ou de la démocratie, mort de Dieu, de l’espèce, de la planète… mort de la Vie. L’addiction a ses effets : elle nous rend familiers avec une étrangeté, cette fin qui nous nie et nous renie, cette « chose » en négatif qui ressemble à un « manque » dont on serait drogué bien plus qu’à une réalité, un état de fait, une quelconque substance. Nous sommes devenus des camés de la fin, des accros de l’eschatologie, des défoncés de l’apocalypse… mais qui, étrangement, s’accomodent de cet état, même menaçant, comme si « vivre » au plus près de la fin et même au-delà était le seul mode d’être qui pût nous satisfaire vraiment.
Antoine Volodine, dans Vociférations, prend le relais de Fin de partie en déclarant et déclamant dans une quasi euphorie :
73. En cas de malheur, ne te réincarne pas à la va-vite ! […]
76. En cas de malheur, ouvre ta gourde lacrymale et attends
la suite !
77. Si le malheur survient, n’agonise qu’à bon escient !
78. Marche à pas menus vers l’amie évanouie ! […]
82. Si l’amie évanouie t’accorde la vie sauve, suspends-toi à tes
propres os et attends !
83. Si le malheur t’accorde la vie sauve, pends-toi à tes propres
os et attends la suite !
Voilà le sort de l’Homme : rester suspendu à sa propre fin en attendant la suite, n’être sauvé qu’en se pendant à ses propres os. La fin n’est plus une fin en soi, mais un moyen… d’aller au-delà, « en attendant la suite », tout en restant dedans la fin, pendant la fin, « pendu ou suspendu à elle ». De Beckett à Volodine — puis à Céline Minard et Patrick Chatelier dont je parlerai plus loin —, la fin change de fin, puisqu’elle n’est plus un but ou une butée, un point de destination, un point oméga vers lequel on va, tragiquement, fatalement, mais un début, un point alpha, un point zéro d’où tout repart même s’il s’agit d’un grand départ, parfois, où « agoniser à bon escient », entrer dans le Bardo ou l’espace noir dans lequel « ça va finir, ça va peut-être finir » mais à l’infini, comme si l’homme ne pouvait se réincarner qu’en ce lieu désincarné ou décharné de la Fin à jamais prolongée, où l’on se suspend à ses propres os, où l’on marche à pas menus comme des spectres et des fantômes dans le tunnel interminable de l’après-vie.
Lapsus tempi
Durablement hantés par la finitude de notre existence, par la finalité de notre histoire, nous ne parlons plus, selon une tradition millénariste, de la fin du monde mais, dans une orientation beaucoup plus messianiste, du monde de la fin : on n’a plus tant l’impression de sortir du monde que d’entrer dans cette fin, d’y pénétrer en profondeur comme dans un lieu d’après le monde, d’après l’Histoire, d’après l’Humain… On glisse vers un eskhaton qui n’est plus tant une limite, au-delà de laquelle on tombe dans le néant, qu’une orée, un horizon, une lisière par-delà lesquels se trouve ou se découvre un nouveau continent… Un continent noir, certes — un continent flottant, sans cesse à la dérive comme l’horizon dont il incarne non tant la ligne, mince, fuyante, fictive, que l’espace à n dimensions qu’il dissimule —, mais un Nouveau Monde quand même, une autre réalité, qui n’a rien de « continental » au sens propre, puisque c’est un monde qui ne « tient pas ensemble », qui ne « se contient plus », sans contenance ni contenu, qui nous dé-contenance, en fait, devenu d’un coup notre « lieu commun » hors du commun, notre sol létal plus que natal, où l’on marche comme sur des eaux, un archipel mobile dont chaque îlot aurait la taille d’un de nos pas, séparés l’un de l’autre par la largeur d’un saut, toujours périlleux.
Nous sommes les nouveaux Colomb : nous nous élançons dans le temps comme il s’est lancé sur la Pinta dans l’espace vague des océans sans savoir ce qu’il trouverait au bout, peut-être la fin, sa propre fin ou celle du monde, du monde connu, du monde ancien, sauf que nous savons, nous, que nous ne trouverons rien, pas de monde, pas de terre ferme, parce que c’est précisément dans la fin que nous nous jetons et nous projetons, dans ce « Rien » qu’elle est… au bout du temps humain, comme l’abîme du bout du monde représentait le « Néant » dans l’espace précolombien. Bref, nous n’allons plus vers la fin, nous vivons désormais en son sein, en son milieu, qui sans cesse croît, comme le désert selon Nietzsche, s’élargissant autour de nous comme si elle avait une véritable extension, à l’instar de tout espace, même s’il s’agit d’un « espace de temps » dans lequel on se tient au bord, toujours, à la frontière, à la limite, borderline, disent les Anglais, qui savent la folie que c’est de vivre en équilibre sur un « laps » de temps qui est tout entier lapsus, chute ou rechute dans le hors-temps, comme si chaque instant était « relaps » d’un temps hérétique, erratique, manquant, dans lequel il « retombe » et nous entraîne avec lui.
Carbure-t-on au Principe désespérance, peut-on alors se demander, paraphrasant Ernst Bloch ?… Lui qui écrit : « Ce n’est pas pour les temps meilleurs que l’on menait le combat mais pour la fin de tous les temps », pour « l’irruption du Royaume », précise-t-il, en bon lecteur de Rosenzweig, de Scholem, de Benjamin, c’est-à-dire en bon messianiste, professant un messianisme sans Messie, toutefois, un Royaume sans roi, « un Royaume de Dieu sans Dieu », écrit Michael Löwy, « un Royaume qui renverse le Seigneur du monde installé dans son trône céleste et le remplace par une “démocratie mystique” », soit un Dernier royaume au sens de Pascal Quignard : le royaume des derniers, des derniers venus ou des derniers arrivés, des « parias » selon Benjamin, des « sous-hommes » selon Volodine. Le règne de la fin sans fin — du Temps sans temps, du Lieu sans lieu, du Dieu sans dieu —, voilà le rêve réalisé de toute utopie, qu’elle soit positive ou négative, édénique ou infernale : là rien ne règne sur rien… c’est un royaume sans sujet ni souverain, où seule règne la Fin, partout et en tout temps. Un royaume « divin » régi par le seul dèmos messianique, non pas par quelque daimon millénariste, c’est-à-dire par la seule démocratie révélée, non pas par quelque théocratie redemptrice au sens dogmatique ou doctrinal du terme.
Dans le monde de la fin, Dieu est un verbe, un adjectif, une interjection, comme les aime Antoine Volodine dans ses Vociférations, jamais un nom ou un substantif, qui désigne une chose ou une personne. Dieu est épithétique : ni thèse, ni hypothèse, il est epi-, « au-dessus » de toute thèsis, de « ce qui tient et se tient », il plane sur tout, agissant à distance, comme s’il n’y était pour rien. L’épithète Dieu désigne ainsi la qualité d’un acte de parole, la propriété qui donne vie à un acte de langage omnipotent, omniprésent, comparable à la prière, cette forme sacrée de l’injonction — prière de faire ceci, prière de faire cela… — qui ne vise pas, toutefois, l’atteinte d’un but précis — obtenir telle faveur, telle grâce —, mais sécrète en chaque mot qu’elle émet une puissance « divine » grâce à laquelle on échappe au temps humain, une force ou une vertu superlative qui émane de nos poumons telle une « âme » tangible, capable de franchir toutes les frontières de l’espace et du temps, de « voyager dans la douleur », écrit Volodine, plutôt que dans le futur ou dans le passé, d’atteindre le « dernier Royaume », ce sur-monde des sous-hommes où la mort est reine, où la fin prime, qui met un terme à la souffrance par la vengeance du Temps contre le temps, la rédemption de l’Histoire par son au-delà, l’éternité vécue heure par heure qu’il appelle aussi, dans Nos animaux préférés, « le ciel péniblement infini ». Ce « ciel » incarne le règne de l’araigne, l’un de ses « animaux préférés », son totem étant l’araignée qui tisse sa toile telle une cité… tout entière sortie de sa bouche en un narrat, un romånce, une entrevoûte, un peu de bile, de bave, de salive solidifiées, un lien de souffle tressé serré. C’est le règne de l’a-régné, de l’a-régnant, où seule la privation de tout pouvoir, cette ascèse, cette anachorèse, donne réellement de la puissance, de la virtus, de la vertu :
18. Ferme en toi le museau vif, apprends l’aragne !
19. En toi seule l’aragne vive mérite qu’on l’oublie !
20. Celle qui ouvre en toi le museau vif, regarde-la, oublie-la !
Le post-exotisme est un ana-chorétisme, profane et militant : les deux termes découlent du même mot, chora, issu du verbe choreô qui veut dire « déplacer » : « après » (post-) ou « de côté » (ana-). On va vers l’après comme on va vers le retrait : on se tire et se retire… dans la fin du monde ou le monde de la fin, dans l’Utopie ou l’Ur-topos le plus archaïque et le plus eschatologique en même temps, parce que l’extrême est notre seul « milieu », lieu hors lieu de l’araigne sans règne, temps hors temps du non-règne le plus puissant, qu’il s’appelle Dieu ou n’importe comment.
Ernst Bloch décrit l’« esprit d’utopie » et le « principe espérance » qui le sous-tend — même dans les situations les plus désespérées, où chacun essaie d’accélérer la venue de la Fin, seul Messie qu’on puisse encore prier, appeler, interpeler — comme « la découverte de l’avenir dans les aspirations du passé sous forme de promesse non accomplie ». Ainsi « les barrières dressées entre l’avenir et le passé s’effondrent d’elles-mêmes, de l’avenir non devenu devient visible dans le passé, tandis que du passé vengé et recueilli comme un héritage […] devient visible dans l’avenir ». Voilà les temps tête-bèche, passé, avenir, présent sens dessus dessous, origines et fin en un périlleux tête-à-queue, comme dans le dernier roman d’Alain Fleischer, cet autre prophète contemporain de la fin sans fin du temps humain, qui écrit aux dernières pages d’Imitation : « Je suis envahi par une mélancolie de la dernière fois [on pourrait dire aussi une « fantasmagorie de la première fois »], et je flotte dans un temps sans repère. Il me semble avoir rêvé cela : qu’une musique sublime [une écriture aussi] échappe à la loi du temps ordinaire et instaure sa propre temporalité infinie. Tout est là derrière nous et devant nous, entre la dernière et la première fois. Et tout s’inverse : normalement, la dernière fois vient après la première, et maintenant la dernière fois est derrière nous, et la première devant. »...