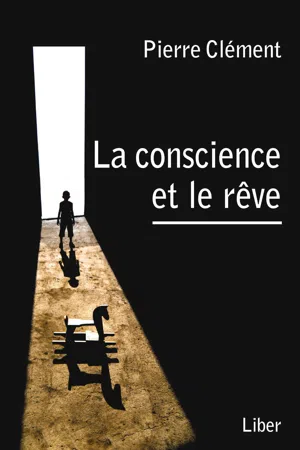![]()
chapitre 1
Une histoire d’orignal
Quand nous comparons notre état de veille à celui de nos rêves, il nous vient immédiatement à l’esprit que le rêve diffère par son caractère étrange. Mais porter un tel jugement exige que nous attendions l’éveil, ce moment où les deux états sont en présence — nos perceptions à l’éveil et le souvenir de nos rêves — nous permettant d’affirmer qu’ici le monde est normal et là non. Les perceptions en état de veille sont normales parce que nous sommes en mesure de vérifier leur réalité au moyen de la pensée réflexive, ce qui n’est pas le cas dans nos rêves.
Pourtant, plongé dans son univers, le rêveur ne trouve rien d’étrange. Au contraire, tout comme dans l’état de veille, il s’intègre à ce monde mystérieux et tente tant bien que mal de s’y adapter sans interroger outre mesure sa réalité ou la qualité de son étrangeté. Voici un exemple de rêve bien connu : un individu se retrouve nu dans un endroit public. Ne s’arrêtant pas pour réfléchir au caractère bizarre de la situation, il ressent un malaise et tente de se couvrir. De toute évidence, notre rêveur, sans se poser de questions sur la factualité de ses perceptions visuelles, s’adapte tant bien que mal aux événements tels qu’il les voit.
Cela dit, le caractère d’étrangeté du rêve n’agit que dans une direction, la raison étant que, si nous savons que nos rêves sont étranges, il nous est tout à fait impossible de penser en rêvant à l’étrangeté de la vie éveillée. En effet, advenant que la chose fût possible, le rêveur appliquerait la logique du rêve pour tenter de mieux saisir les aspects étranges de l’univers éveillé. Ce serait comme si, plongé dans un monde largement privé des catégories spatiales, temporelles et causales que nous connaissons, il pouvait malgré tout observer et réfléchir sur les irrégularités de cet autre monde assujetti aux catégories que je viens de mentionner. La perception d’individus demeurant identiques à eux-mêmes, soumis aux lois de la physique et de la nature, et aux multiples codes et tabous de la conduite, tout cela lui semblerait très insolite. Certains voudront mettre à profit ce constat d’impuissance et dire qu’il nous permet, fort heureusement peut-être, de situer la réalité des choses au bon endroit, c’est-à-dire dans la vie éveillée.
Je veux revenir un moment à l’étrangeté du rêve. Bien que nous rêvions toutes les nuits de notre vie, force est de constater que chaque rêve est unique. Cette particularité explique sans doute la fascination qu’exerce chacun des rêves dont nous nous souvenons. Mais en fait, la singularité du rêve appartient également au domaine du monde éveillé. Bien que le caractère répétitif de la vie moderne nous donne une impression de régularité et de déjà vu, il n’en demeure pas moins que chacune de nos perceptions sensibles est tout à fait unique. Malheureusement, la routine du quotidien a pour effet d’endormir la conscience et de l’empêcher de voir ce qui pourrait ressembler à un rêve.
Tentons de mieux comprendre cela en comparant la singularité du rêve à celle du monde de la veille. Nous savons que le rêveur se voit constamment bombardé de perceptions disparates et mal définies mais qu’il les accepte comme faisant partie de son monde. Peut-on trouver une situation similaire au rêve au cours de la vie éveillée ? Voici un exemple : un touriste en quête d’exotisme se rend dans un pays dont le contexte géographique, culturel et politique diffère en tout point du sien, où la langue, la culture et les traditions sont à un point tel autres qu’elles effacent ces balises lui permettant d’attribuer au monde externe sa qualité d’objectivité.
Cela me rappelle qu’au cours d’un premier voyage en Inde, l’idée d’occuper moi-même la fonction de conducteur ayant été jugée irréaliste, nous avions loué mon épouse et moi une voiture avec chauffeur dans le but d’effectuer le trajet Delhi-Agra, site du spectaculaire Taj Mahal. À mesure que nous roulions, je me surprenais à être le témoin d’un paysage tout à fait insolite. Devant nous la chaussée était occupée par des camions, des autobus, quelques automobiles mais aussi par des vaches, des singes, des porcs et autres animaux. Tantôt un camionneur réparait nonchalamment une crevaison au milieu de la chaussée, tantôt un conducteur fonçait en sens inverse de notre côté de la route. De toute évidence, mes sens étaient bombardés d’images inusitées et mes notions de code de la route telles que je les avais apprises au Canada ne s’appliquaient plus. Plongé dans ce monde « irréel », mon émotion était telle que je me demandais si je rêvais ou si j’hallucinais.
La vue d’animaux divers occupant de plein droit une route très fréquentée offrait un paysage tout à fait inusité et parfaitement digne d’un scénario rêvé. Seulement voilà, je me suis dit que j’étais dans un lieu jamais visité auparavant et que cela seul pouvait expliquer l’étrangeté de la situation. D’ailleurs, ma mémoire me rappelait quelque chose au sujet des vaches sacrées en Inde et de leur droit de passage sur les routes. Sans cette mise en situation, cette scène serait probablement demeurée dans un registre semblable à celui de l’hallucination.
Il arrive que nos perceptions de la vie quotidienne soient le théâtre d’événements surréalistes comparables à celui que je viens de mentionner ou à ceux des rêves. La différence tient à ceci que le sujet éveillé peut, en s’adaptant, dire que telle perception, si étrange soit-elle, fait partie de la réalité et doit être traitée comme telle. Dans certains cas, le sujet s’adapte mal, refuse la perception et la remplace par un subterfuge. Nous disons alors qu’il hallucine ou délire.
![]()
Un récit
Dans le but de préciser ma pensée, voici une autre histoire qui illustre le caractère parfois insolite de nos états de veille. Les événements que je vais décrire ont eu lieu non loin de mon chalet d’été situé dans les Basses-Laurentides. Nous nous étions levés tôt un matin de début juin ma fille de dix ans, son amie et moi pour faire une randonnée dans un sentier du parc provincial Papineau-Labelle non loin de là. L’objectif de notre excursion était ambitieux : gravir à pied le mont Devlin et y admirer le paysage. À notre départ, l’air du matin était encore frais et le soleil jetait obliquement sa lumière bleutée sur le flanc des montagnes.
Nous marchions en forêt depuis une heure lorsque nous avons débouché sur une éclaircie donnant sur un étang ; l’eau était calme et réfléchissait un ciel limpide. Quelques canards au fond de l’étang attirèrent notre attention et nous nous sommes assis un instant pour les regarder. Nous tournions le dos au sentier. Au moment de repartir, je me suis retourné le premier. Mes yeux furent à ce moment surpris par la présence d’une masse sombre qui m’apparut énorme, démesurée. Elle était là, inerte, tout près de moi. J’ai fixé la chose pendant un instant, sans bouger. Je n’étais ni en mesure de réagir ni de l’identifier. Après ce moment de stupeur, je suis devenu littéralement envoûté par ce qui maintenant prenait la forme d’un animal. Juchée très haute sur ses pattes, la bête était pourvue d’une certaine élégance. Curieusement, il n’y avait là rien qui puisse m’effrayer. Il me semblait au contraire que sa présence s’agençait parfaitement avec le calme de la forêt. Puis, tout en prenant conscience du fait que je voyais pour la première fois un orignal, j’ai crié doucement à ma fille et son amie : « C’est un orignal ! » À ce moment, j’ai remarqué que la bête, une femelle qui me dépassait largement en hauteur, était accompagnée de son petit, encore tout fragile sur ses quatre pattes. Personne, y compris les deux animaux, n’a bougé. Nous sommes demeurés face à face un moment, puis, nous tournant le dos, la mère a pris lentement le chemin des bois avec son petit.
J’aurais pu intituler l’épisode « Ma première expérience avec un orignal » et en faire une histoire. Mais il y a une autre façon d’aborder ces événements, celle de les relater comme si c’était un rêve, c’est-à-dire en demeurant le plus près possible des impressions immédiates et en évitant de les rattacher au moyen d’un récit narratif.
L’exercice mérite qu’on s’y attarde parce qu’il nous aidera à mieux saisir le caractère inusité de la conscience en état de veille. Ma rencontre avec l’orignal peut se diviser arbitrairement en trois temps de perception dont le caractère d’étrangeté varie. Le premier repose sur une impression immédiate, une émotion vive coupant court à tout effort de compréhension. En somme, comme dans le cas des rêves, je dois revenir sur cet événement précis et utiliser ma mémoire pour en faire un récit. Mon souvenir de ces premiers instants se réduit à peu : une perception vague, une masse informe et un état de stupeur.
Attardons-nous sur ce premier temps de perception. Bien qu’il m’ait semblé très bref et irréel, il ne fut pas hors de portée de ma conscience. Aucune image, aucune pensée qui pourraient m’aider à comprendre la nature des événements n’accompagnaient cette perception. Malgré cette incapacité à penser et à identifier la chose qui occupait mon champ de vision et malgré l’intensité de l’émotion, mon esprit demeurait conscient. Seulement, n’étant pas de nature réflexive, cette conscience ne me permettait pas de prendre du recul, de penser et d’attribuer une signification aux événements. Il y avait simplement état de conscience, je dirais conscience simple, sans sujet qui pense et sans objet.
En fait, ma première impression ne contenait rien qui puisse me cadrer logiquement à l’intérieur d’un temps et d’un espace. J’ai beau dire que cet événement n’aura duré qu’un instant et décrire l’expérience au moyen de termes évoquant une dimension spatiale, par exemple la perception d’une masse sombre dressée devant moi, force est d’admettre que j’ai simplement tenté de formuler après coup une situation émotive indescriptible quoique perceptible et perméable à ma conscience. Cet instant fut vécu comme événement non pas sur le plan de la pensée mais sur celui de la conscience : quelque chose advenait simplement devant moi.
Nous tenons pour acquis que, tout comme nous disons « être conscients de quelque chose », la conscience implique un sujet conscient de cette même chose. La raison vient sans doute de ce que faire usage de la conscience suppose un sujet déjà présent. Si par exemple j’aperçois devant moi un orignal, c’est bien moi comme sujet a priori qui prend acte de cette impression sensible. Autrement dit, c’est comme si la perception consciente supposait un sujet déjà présent, prêt à devenir conscient de quelque chose. Ce dernier disposerait d’une conscience à la manière d’un projecteur dont le faisceau serait orientable ou bien sur soi ou bien sur le monde.
L’expérience de tous les jours montre cependant qu’un état de pleine conscience sur soi ou sur le monde ne peut être soutenu que temporairement. Le plus souvent, nous passons notre temps à rêvasser ou simplement à nous laisser envahir par le jeu de nos humeurs. C’est ce qui m’est arrivé au cours de ma rencontre avec l’orignal. Pourtant, malgré cette absence de conscience pleine, sans sujet et objet distincts, ma mémoire a été en mesure de rappeler de mes centres mnésiques le souvenir d’événements vécus.
Posons la question autrement : une conscience suppose-t-elle un sujet conscient de soi ou d’un objet ? Se peut-il que, pendant le court moment dont je viens de parler, il y ait une conscience sans sujet et sans objet ? Le cas échéant, il nous faudrait admettre l’antériorité de la conscience sur le sujet et l’objet : d’abord une conscience première, conscience brute, et par la suite une conscience de sujet et d’objet.
Dans le but d’exposer le caractère singulier de la conscience, le philosophe américain Thomas Nagel avait posé la question suivante : « Comment est-ce que d’être une chauve-souris ? » Être conscient, pour l’auteur, signifiait être tel ou tel. Par exemple, qu’est-ce que c’est que de voir cette couleur rouge ou de sentir au visage ce coup de vent froid par une journée d’hiver ? Détail important à noter, Nagel n’utilise pas la première personne mais bien la troisième, de manière à insister sur la nature non subjective de l’état de conscience de la chauve-souris. Par extension, demandons-nous ce que c’est que de faire la première rencontre avec un orignal. Certains voudront comparer cet état de conscience première à la conscience non thétique qui se veut une attribution d’existence, non pas constat d’une existence subjective ou objective, mais simplement singularité d’existence. Dans le contexte de mon aventure, je me hasarde à décrire cette singularité non pas comme un devenir, puisqu’il y a absence de conscience du temps, mais comme un état sensible sans sujet et sans objet, simple singularité affective.
Parlons maintenant du second état de perception de l’orignal. Il dure à peine plus longtemps que le premier, quelques secondes peut-être, et se manifeste également par une forte émotion. Mon impression devient plus nette, je perçois maintenant un animal dont l’allure et la forme me fascinent.
N’étant pas en mesure de le décrire ou d’en connaître la nature, j’éprouve néanmoins un sentiment nouveau. Cet état me porte à penser que nos regards respectifs sont le reflet d’une mystérieuse symétrie. L’animal que je perçois fait maintenant partie de mon monde comme je fais partie du sien ; il est là debout dans le sentier mais aussi, étrangement, il habite ce qui devient tout à coup mon espace intérieur.
Je deviens conscient de la beauté de l’animal plutôt que de l’animal comme tel. C’est sa forme qui me captive et c’est moi qui éprouve dans mon esprit un sentiment qui dès lors m’appartient. Manifestement, cette perception est caractérisée par l’introduction de la dimension spatiale : c’est à la forme provenant de l’extérieur que sont jumelées mes émotions, et cela par une sorte d’équilibre qui unit émotion et forme pour constituer une image dont j’ai parfaitement conscience. Le lecteur me permettra d’insister sur ce point à savoir que l’émotion dont je parle ne précède ni ne succède à la forme perceptible, elle s’unit à cette dernière pour produire une image. Autrement dit, dans la mesure où nous parlons de perception sensible, une image se veut le résultat d’une adéquation entre deux états distincts, celui de l’émotion, provenant de l’intérieur et celui de la forme, provenant de l’extérieur.
Ce deuxième état établit non pas une conscience d’objet distinct mais bien une conscience d’image dans la mesure où cette dernière fait inextricablement partie de mon intérieur. Et bien que forme (externe) et émotion (interne) entretiennent une relation de symétrie, il n’en demeure pas moins qu’elles ne cessent d’être, dans une certaine mesure, distinctes. Le caractère un de ce que je perçois, c’est-à-dire la forme et l’émotion, ne m’empêche pas de discerner un moi émotif percevant une forme animale.
Le constat que ce qui apparaît comme un à la conscience est le résultat d’une adéquation de deux termes qui ne cessent pas pour autant d’être distincts a pris naissance avec le cogito cartésien. Avoir conscience de ma réalité propre est le résultat de l’adéquation réunissant un je suis et u...