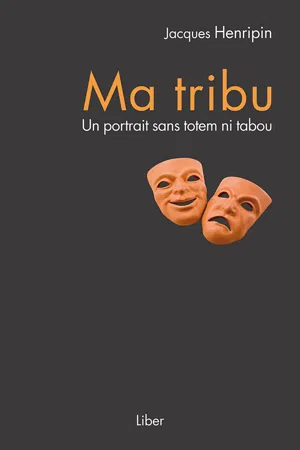![]()
Chapitre 1
La tribu dont il s’agit
Je ne peux me faire à l’idée que ma tribu serait constituée par les Québécois, même si, à part quelques centaines de truands, de menteurs et de prétentieux, je les aime bien à peu près tous. Mais enfin, ma tribu, c’est autre chose qu’un groupe d’êtres humains définis par la géographie ! Je ne prétends pas ici démêler les mystères, les flagorneries, les facilités, les impostures, les vantardises qui entourent l’usage de concepts comme nation, société, groupe ethnique, groupe culturel, tribu ou autres vocables qui servent à désigner un ensemble de personnes qu’unissent des caractères communs. Dieu soit loué, on n’en est pas encore à la « civilisation québécoise » ! Et je n’ai vu personne encore ajouter ce dernier qualificatif aux six ou sept civilisations majeures de Huntington.
Je me contenterai de rigoler doucement à propos du titre de « nation » octroyé récemment aux Québécois et accueilli avec un plaisir manifeste, en particulier par les profiteurs électoraux potentiels et les porteurs de cocarde. Vous pouvez tordre le dictionnaire comme vous voulez, il me semble bien difficile de justifier le terme de « nation québécoise ». Mais je n’en ferai pas une analyse, même embryonnaire. Il me suffit de penser qu’au Canada il y a de soixante à quatre-vingts nations amérindiennes. Je ne vois vraiment pas ce que signifie la nation québécoise dans ce contexte… ni dans un autre.
Je n’aime pas beaucoup le recours aux auteurs prestigieux, mais je ne résiste pas à la tentation de rappeler que Fernand Dumont était du même avis : pas de nation québécoise. Je retrouve dans Le Devoir de juillet 1998, sous la plume de Marco Veilleux, une expression qui dit tout : la nation québécoise, c’est de « l’inclusivité bien pensante ».
S’agissant d’identifier le groupe humain relativement important avec lequel je me sens le plus d’affinités, je choisis sans trop hésiter les Canadiens français. J’en fais partie depuis huit ou neuf générations, par le truchement de quelque cent vingt ou cent cinquante aïeux, ce qui fait beaucoup d’arbres abattus, de champs labourés, de neige pelletée, de fausses couches et de naissances vivantes.
Voilà en tout cas un groupe humain qui a de la consistance. Il y a en effet entre ses membres plusieurs traits communs remarquables : la langue, bien sûr ; une histoire de quatre cents ans, illustrée par des réussites, des échecs, des inquiétudes, des souffrances, des projets, des actes de courage, des bêtises, des personnages, des batailles et peut-être surtout par une grande victoire : la survie. Cette dernière a sans doute plusieurs causes, mais l’une d’elles est exceptionnelle et ne peut laisser indifférent le démographe que je suis : entre 1760 et 1990, donc en deux cent trente ans, les quelque 70000 habitants de la Nouvelle-France et de l’Acadie se sont multipliés par cent, malgré une saignée de près d’un million aux États-Unis. Presque tous sont descendants des quelque 8500 colons qui se sont établis entre 1608 et 1760 en Nouvelle-France, de même que de quelques milliers de colons acadiens. Cela explique peut-être le sentiment qu’ont beaucoup de gens de ma tribu d’être plus ou moins parents. Il y a aussi des coutumes, des fidélités, des croyances propres à cette tribu. J’y reviendrai à propos de la culture dite québécoise, dont beaucoup d’éléments sont en train de disparaître, notamment l’emprise de la religion catholique. Malgré cette évaporation, il reste des liens et des souvenirs communs, peut-être un génome un peu particulier.
Donc, ma tribu, ce sont les Canadiens français. Pas les Québécois, pas les Canadiens tout court. Bien sûr, quand il s’agira de voir comment ce morceau d’humanité se gère collectivement, il faudra bien s’en reporter à la province de Québec.
Il vaut la peine de survoler le passé et l’avenir démographiques de ces quelques millions de bipèdes. Après tout, il n’y a ni société, ni nation, ni tribu sans une population pour les soutenir.
![]()
Chapitre 2
La population canadienne-française :
évolution passée
On appelle normalement « Canadiens français » les personnes dont les ascendants sont originaires de France. C’était le sens du concept d’« origine ethnique française » dans les recensements du Canada jusqu’à celui de 1981. Depuis lors, Statistique Canada a introduit la possibilité de déclarer « origine canadienne », ce qui prive la question de son sens. Des quelque 70000 qu’ils étaient en 1760, les Canadiens français sont passés à six millions et demi en 1981 et peut-être à huit millions en 2010. Les quatre cinquièmes, soit un peu plus de six millions, vivent au Québec.
Dans cette évolution, il y a deux éléments numériques contraires : un fort taux de croissance naturelle, caractéristique de l’Amérique du Nord, et un bien petit noyau de colons. On connaît de façon précise le nombre d’hommes et de femmes qui se sont établis en Nouvelle-France, entre 1608 et 1760 : 8527, soit 56 par an. Il y en eut probablement dix fois moins en Acadie. Pratiquement, l’immigration française s’arrête là pour longtemps. Ces quelque dix mille colons sont donc la souche des habitants de langue française qu’on trouve sur les rives du Saint-Laurent et en Acadie en 1760. Il faut bien voir les choses comme elles sont : l’administration des colons par la France a été assez pitoyable. Elle fut très règlementée, confiée à des administrateurs qui s’y intéressaient peu et soumise aux intérêts du roi. Les protestants étaient interdits. Elle avait d’ailleurs été assez mal précédée par les instructions que François Ier donna à Jacques Cartier : « … descouvrir certaines ysles et pays où l’on dit qu’il se doigt trouver grant quantité d’or et autres riches choses ».
Les conséquences de cette médiocre colonisation furent, semble-t-il, gigantesques, même à l’échelle du monde. En 1760, la population américaine était vingt fois supérieure à celle du Canada. Si les Canadiens avaient été aussi nombreux que leurs voisins du sud, ils auraient colonisé la vallée du Mississippi et ses affluents de bout en bout, limitant l’accès des Américains à l’est du continent. Il y aurait en Amérique du Nord autant de francophones que d’anglophones. Cela aurait placé la langue française dans une position assez proche de celle de l’anglais. Conjecture, bien sûr. Intéressante, tout de même. Alfred Sauvy a exprimé cela de façon saisissante : « Il a suffi que, dans un des deux pays en lutte pour un immense continent, l’un envoie, chaque année, quelques milliers de colons, l’autre quelques centaines, pour que le cours de l’histoire reçoive une formidable impulsion. Et, symbole tragique, au moment même où la langue française s’assurait en Europe la prédominance internationale, grâce à sa forte démographie, elle était en train de la perdre à terme dans le monde parce que quelques bateaux de plus […] quittaient tous les ans la petite Angleterre. »
On sait aujourd’hui que ce ne fut pas « quelques milliers » contre « quelques centaines », mais plutôt environ un millier contre cinquante-six. Pour le moins, cela a fortement contribué à l’écrasante domination de l’anglais trois siècles plus tard. Par les bassins du Saint-Laurent et du Mississippi, les Français avaient un accès relativement facile au centre de l’Amérique du Nord qu’ils auraient pu peupler. Les Anglais étaient gênés par les Appalaches à l’est desquelles ils ont longtemps été confinés. On peut se demander quel serait aujourd’hui le poids respectif des deux langues si chaque colonisateur avait occupé son « territoire naturel ».
Huit millions de Canadiens français, donc, en 2010. Dont une bonne partie cependant ne sont plus de langue maternelle française, et l’on peut se demander quel sentiment d’appartenance ils ont pu conserver par rapport à leur tribu d’origine. Pour cette raison, je préfère m’en tenir à ceux qui sont de langue maternelle française. On en a compté 6,9 millions au Canada au recensement de 2006, ce qui veut dire une perte de 700000 (9 %) par rapport au nombre approximatif de 7600000 Canadiens d’origine ethnique française cette année-là. Environ 85 % de ces francophones (5,9 millions) vivaient au Québec, où ils constituaient 79,6 % de la population. Voilà donc le poids démographique de ma tribu. On est fort loin de la prédiction d’un célèbre chansonnier qui, vers 1980, avait annoncé la disparition de la langue française au Québec avant l’an 2000 ! Pour les grands artistes (et pour les petits aussi), l’évidence arithmétique la plus simple et élémentaire ne convainc pas ; le grand chansonnier vient d’ailleurs de récidiver… dans une autre tonalité. Il faut donc se méfier de la passion, du moins en démographie. Nous verrons dans le chapitre suivant les chances de survie à long terme de ces francophones nord-américains. Examinons d’abord brièvement les traits majeurs de cette population.
Les prouesses démographiques passées sont en fait moins extraordinaires qu’il n’y paraît. Le passage de 70000 en 1760 à 6,5 millions en 1981 tient à deux éléments. Premièrement, aux États-Unis comme au Canada, depuis le début de ces colonies d’Européens jusqu’en 1875, la croissance naturelle (jeu des naissances et décès) a correspondu à un doublement de la population tous les trente ans environ. C’était là un comportement jusqu’alors probablement inédit sur notre planète. Il résultait tout simplement d’une nuptialité relativement précoce et d’une fécondité dite naturelle, c’est-à-dire sans intervention pour limiter les naissances. En moyenne, les familles avaient huit enfants, lorsque la mort ne venait pas raccourcir la tranche de vie féconde du couple.
Deuxièmement, la période 1875-1960 a été une exception proprement canadienne-française. C’est vers 1875 qu’a commencé à se répandre la contraception en Occident et la fécondité a diminué partout jusqu’au baby-boom des années 1946-1966. Pour être plus complet, ajoutons que cette baisse avait commencé un siècle plus tôt en France. À partir de 1875, la fécondité a diminué aussi chez les Canadiens français, mais très lentement, et ce n’est que vers 1960 qu’elle a rejoint le niveau des autres Canadiens. Ce qu’un anglophone a appelé « la revanche des berceaux » était terminé.
Depuis, la fécondité des Canadiens français a été remarquablement chétive, plus faible, en général, que celle du reste du Canada. En se basant sur l’évolution de la fécondité québécoise, on peut dire que les générations de femmes nées après 1942 ont cessé de mettre au monde les 2,1 enfants nécessaires pour assurer le remplacement de leur génération et que toutes celles qui sont nées entre 1950 et 1970 n’auront pas dépassé 1,7 enfant. C’est 20 % de moins que le niveau de remplacement. Bien sûr, il y a des sociétés dont la « défaillance » est pire, mais la fécondité canadienne-française, autrefois si triomphante, est maintenant au-dessous de la médiane occidentale.
Peu de chose à dire sur la mortalité, sauf qu’elle n’a plus rien d’exceptionnel. La très forte surmortalité infantile de la première moitié du vingtième siècle a, en particulier, totalement disparu. On le doit aux médecins, aux responsables de l’hygiène et à l’amélioration des conditions de vie. Peut-être en partie aux infirmières de la Victorian Order of Nurses qui, si mes souvenirs sont bons, visitaient les familles où un enfant était né, à Lachine, où j’ai passé mes premières années. Elles répandaient quelques bonnes habitudes élémentaires et quelques soins. Des études ultérieures ont montré que nos mamans d’alors en avaient bien besoin. Cela n’enlève aucun mérite aux « gouttes de lait », ces cliniques publiques, disparues sans bruit depuis belle lurette, où nos mères et grands-mères amenaient leurs poupons.
Le dernier groupe de phénomènes qui ont pu affecter la population canadienne-française est constitué par les courants migratoires. On n’en sait pas grand-chose avant 1970, sauf la saignée qui en a conduit près de 800000 aux États-Unis entre 1850 et 1930. Cela n’a pas beaucoup modifié leur poids dans l’ensemble du pays, puisque les autres Canadiens ont fait la même chose, en proportion à peu près comparable. D’autre part, peu d’immigrants étrangers furent de langue maternelle française. Signalons aussi que d’une façon générale les Canadiens français québécois ont été assez réfractaires à une émigration vers d’autres provinces.
Cependant, les migrations des autres groupes linguistiques, fort importantes, ont déjà et vont encore modifier leur importance relative. Cela nous amène à jeter un coup d’œil sur l’avenir.
![]()
Chapitre 3
L’avenir des Canadiens français
La question de l’avenir des Canadiens français est controversée et passionnelle. Il faut distinguer le Québec (et à certains égards le Nouveau-Brunswick) du reste du Canada, car même si environ 15 % des francophones vivent hors du Québec, c’est là que réside leur pouvoir politique, économique, culturel et démographique. De même que leur capacité de survivre encore quelques siècles.
Le Nouveau-Brunswick est un cas particulier : il y a là 235000 francophones. Ce n’est que le quart de ceux qui vivent hors Québec, mais ils constituent 33 % de la population de leur province, ce qui leur donne du poids et de la résistance. Il est vrai que cette fraction diminue lentement, mais la fierté et la vigueur des Acadiens constituent une assez bonne assurance de leur pérennité. Plusieurs d’entre eux m’en voudront peut-être de les amalgamer aux Canadiens français sans plus de manières, mais je ferai remarquer que deux tiers des Québécois francophones ont une Acadienne ou un Acadien parmi leurs ancêtres, d’après une étude remarquable d’une équipe de démographes généalogistes de Chicoutimi et de Montréal. Et j’ai été assez fier d’apprendre que mon patronyme est la transformation du nom d’un Henry, qui est allé engendrer pas loin de vingt enfants en Acadie entre la fin du dix-septième siècle et le milieu du suivant. Au moins un de ses fils ou petits-fils est revenu dans la région de Montréal et l’un de ses descendants a rallongé son patronyme en ajoutant « pin » ou « pain ». Je dois cette information à mon collègue Hubert Charbonneau, grand amateur de généalogie. Bref, il y a, ma foi, de l’Acadien un peu partout !
Les francophones des autres provinces de ce qu’on appelle le ROC, rest of Canada, paraissent beaucoup plus fragiles. En 2006, l’Île-du-Prince-Édouard et l’Ontario comptaient 4,2 % de francophones et les autres provinces se situaient entre 1,4 % et 4 %. Et ces pourcentages étaient partout en diminution. Les analyses de mobilité linguistique ne laissent pas beaucoup de doute : hors du Québec et de ses franges en O...