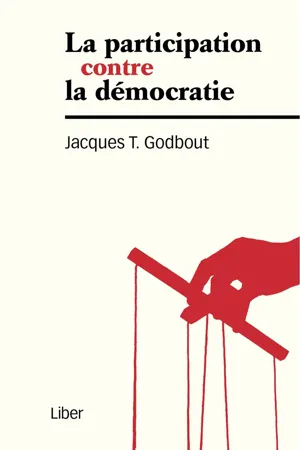![]()
Chapitre 1
Qu’est-ce que la participation?
Quelle participation?
J’étudie la participation des usagers, des citoyens, des «clients», de ceux qui sont touchés par les décisions d’une organisation sans en être membres. Ce n’est donc pas la participation au sens global, psychologique et culturel du terme, où ce phénomène est pratiquement identifié à la vie associative et même au fait de faire partie d’une société1. C’est au sens politique et organisationnel, où le terme de participation désigne le fait, pour des individus, d’être associés à des décisions. Le phénomème sera défini de façon plus précise plus loin. Provisoirement, disons que par participation des citoyens, nous désignons les différents rôles que sont amenés à remplir, au sein d’une organisation, ceux qui sont reliés à elle par leur statut d’usager, de «client», de bénéficiaire ou, de façon plus générale, par le fait d’être touchés par les décisions prises par cette organisation.
À l’intérieur même d’une approche politique et organisationnelle, cette définition exclut plusieurs phénomènes de participation aux décisions. Pourquoi privilégier la participation des usagers? L’énumération de certains aspects de la participation qui, tout en étant importants, ne constituent pas l’objet du présent texte permettra de faire ressortir l’aspect spécifique qui est traité.
Cette notion renvoie le plus souvent à deux grands types d’expériences: d’une part l’implication de la clientèle d’une organisation dans l’organisation, d’autre part la participation des employés de l’organisation, des travailleurs, c’est-à-dire toutes les expériences qui remettent en question l’organisation hiérarchique du travail dans les milieux de production. Ces deux types sont très différents l’un de l’autre et peuvent même être contradictoires du point de vue de l’implication des individus. Ce livre porte essentiellement sur la participation des usagers, de la clientèle, de ceux qui sont touchés par l’output d’une organisation.
Nous n’aborderons donc pas, sauf à titre comparatif, les expériences d’autogestion et de cogestion des travailleurs, des producteurs, des employés.
Le phénomène de la participation des experts, externes à l’organisation, phénomène de plus en plus fréquent dans l’administration contemporaine2, n’est pas non plus abordé. Nous étudions bien l’intervention d’agents extérieurs à l’organisation. Mais à la différence de celle des experts, leur intervention est fondée sur la connaissance que leur apporte le statut d’usager et de bénéficiaire de l’organisation; elle est fondée aussi sur leur droit de bénéficier d’un produit répondant à leurs besoins, et non pas sur leurs connaissances techniques, scientifiques ou même morales du secteur d’intervention de l’organisation.
Importance et intérêt de l’objet
Au début de la dernière décennie, H. W. Hallman affirmait que la participation des citoyens constituait un des événements les plus significatifs pouvant affecter l’administration publique3. «Ce phénomène a atteint la plupart des groupes sociaux au cours de la dernière décennie4, écrit Cole. Noirs, travailleurs d’usine, consommateurs, étudiants, populations démunies ont réclamé une participation accrue aux décisions qui les touchent5.» Il a même provoqué des crises qui ont touché le fondement même de la vie en société: les événements de mai 1968 en France se sont déroulés sous le signe de la «participation authentique», qu’on opposait à la pseudo-participation.
Aux États-Unis, entre les périodes électorales, c’est par les «groupes de pression» que les citoyens sont censés participer à la vie politique. Or, à partir de l’analyse des données de plusieurs enquêtes, Schattschneider en arrive à estimer qu’environ 90% de la population n’a pas accès au système des groupes de pression6. Toutefois, d’après Vernon, à la suite du mouvement actuel de participation, cette proportion diminuerait considérablement7.
Il est donc d’un intérêt certain de mieux comprendre la signification de ces expériences de participation: s’agit-il d’un phénomène transitoire relié à des circonstances historiques et d’une durée limitée? Au contraire, assistons-nous à l’émergence d’une nouvelle phase dans «l’art de s’associer», dont Tocqueville considérait l’amélioration continuelle comme aussi importante que les progrès de l’égalité des conditions8? La participation peut-elle contribuer à satisfaire le double besoin de «planification et d’autogestion» souligné par Crozier9? Ou encore sommes-nous en présence des premières manifestations d’un «nouveau contrat social10»? Quels sont les effets de ce phénomène de participation sur le fonctionnement des organisations et, tout particulièrement, sur leur produit?
Sans nier l’importance en quelque sorte «quantitative» du phénomène, on peut toutefois mettre en question l’intérêt d’une telle étude à deux points de vue: pour plusieurs chercheurs, la participation dans le système capitaliste n’est qu’un phénomène de récupération, d’aliénation supplémentaire du travailleur, un jeu de dupes pour le participant. Le pouvoir seul est gagnant car la participation diminue les possibilités de contestation du système par ceux qu’il exploite; elle est une façon de «masquer les contradictions». La seconde objection porte sur le fait de privilégier l’étude de la participation des usagers, plutôt que la participation des producteurs: pour les chercheurs marxistes, seule cette dernière a une importance historique, se situant au niveau des variables fondamentales qui font évoluer la société.
Pour répondre à ces objections, nous sommes amené à effleurer des problèmes importants, qui seront traités beaucoup plus en profondeur plus loin, et surtout dans la conclusion générale.
«Je participe, tu participes, il participe… ils profitent»
Ce graffiti très connu des événements de mai 1968, en France, exprime clairement l’objection à la participation en régime capitaliste. Nul ne peut songer à nier l’existence de telles expériences de participation caractérisées par la manipulation des participants; elles sont rapportées en grand nombre dans la littérature sur le phénomène de la participation, comme nous le verrons. Surtout, il est indéniable que la récupération, la neutralisation, la «régulation11» des participants est l’objet principal le plus fréquent des organisations, des administrations, des gouvernements qui utilisent la participation dans leur programme; et l’intégration sociale des marginaux est une fonction indéniable de la participation, qui est presque contenue dans la définition même du phénomène. Mais les expériences de participation se réduisent rarement à la récupération à sens unique; la récupération désigne souvent, soit un aspect seulement du phénomène, soit une situation extrême (et temporaire), un pôle d’un continuum dont l’autre pôle est le noyautage d’une organisation par les «participants». Dans la même expérience de participation, l’organisation parle de récupération des contestataires, les contestataires de noyautage de l’organisation. Ces deux pôles décrivent beaucoup plus souvent l’objectif des acteurs de l’expérience que l’ensemble du processus de participation, qui sera analysé comme un échange, une relation dialectique entre l’organisation et les participants, où il y a des perdants et des gagnants, mais rarement un effet à sens unique. Ce processus produit des effets non voulus par les acteurs, qu’il importe d’analyser pour comprendre les résultats de la participation.
Participation du consommateur et participation des producteurs
Pour plusieurs analystes, c’est le système de production, ce sont les rapports de production qui déterminent l’évolution sociale et les rapports de domination entre les groupes sociaux. Seule la lutte pour le contrôle des moyens de production est importante; le reste, et en particulier le secteur de la consommation, est un champ secondaire, servant souvent à détourner l’activité des classes laborieuses de leur champ de lutte principal. D’ailleurs la consommation est entièrement déterminée par les exigences de la production, puisque la consommation de la majorité de la population n’est que la «reproduction des forces de travail». C’est ainsi que pour Edmond Preteceille, l’évolution des revenus de l’ouvrier est entièrement déterminée par «l’évolution des exigences objectives de la reproduction de sa force de travail». Pour cet auteur, par exemple, c’est l’intensification du travail, et, de façon générale, les conditions de plus en plus difficiles de l’ouvrier au travail qui expliquent l’existence des week-ends, des congés et des vacances. C’est pourquoi le «besoin de partir en week-end à la campagne […] n’est plus aujourd’hui une consommation de luxe12.»
Notre position est différente et nous amène à faire l’hypothèse de l’importance de la participation des usagers. Constatons d’abord que ces auteurs ne démontrent pas, par une étude systématique de l’évolution, entre deux périodes, des conditions de travail et de vie d’une même catégorie d’ouvriers, cette relation inverse entre conditions de travail et de vie, ni cette dégradation des conditions de travail depuis le début du capitalisme. Une telle enquête serait nécessairement difficile, de même que l’interprétation des résultats. Doit-on accorder plus d’importance à des indicateurs comme le nombre d’heures de travail, ou le rythme de travail, le travail à la chaîne, le temps de transport, etc.? La seule dimension des conditions de travail à s’être dégradée de façon évidente, c’est le degré de contrôle, comme l’a encore récemment si bien montré Braverman13. Il s’agit là d’un aspect fondamental, mais il n’est pas le seul et il est surtout insuffisant pour établir une relation mécanique entre dégradation des conditions de travail et amélioration des conditions de consommation, comme le fait l’auteur précédemment cité.
Nous croyons au contraire qu’il y a une certaine autonomie entre la consommation et la production, que la nécessité de faire de l’ouvrier un consommateur, tout en répondant à la logique du capitalisme et aux exigences de son développement, n’est pas liée seulement à la reproduction de la force de travail, mais aux besoins d’un marché et à ceux de consommateurs de plus en plus nombreux. La consommation est un élément moteur dans la dynamique du système capitaliste, comme on l’a souvent démontré. Certains sociologues, comme Alain Touraine, ont transposé en termes de rapports sociaux ces exigences et cette évolution du système économique, en élargissant la notion de système de production à l’univers de la consommation. «La consommation n’est plus seulement la reproduction de la force de travail, mais un élément essentiel de la production14.» Donc, au lieu de partir du postulat que la consommation n’est encore que la reproduction de la force de travail, et sans nier l’importance de l’univers classique des rapports de production et des formes d’autogestion des travailleurs à l’intérieur des entreprises, nous affirmons l’autonomie relative de l’univers de la consommation, son dynamisme, l’importance de la relation entre l’usager et le produit qu’il utilise et l’éventuel pouvoir qu’il pourrait détenir sur la production de ce bien. Cela sans nier que cet éventuel pouvoir du consommateur ou de l’usager dépend de son pouvoir économique dans la société, comme le pensait déjà Rousseau lorsqu’il affirmait dans Le contrat social qu’une société démocratique supposait que «nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre».
Participation des usagers et autogestion des producteurs
Mais il y a aussi des raisons spécifiques, positives pour étudier la participation des usagers par rapport à celle des producteurs. Une organisation n’existe pas pour le bien-être de ses membres producteurs. Elle existe d’abord pour produire un certain output, qui doit satisfaire ses clients, ou ses utilisateurs. À moins d’imaginer — ce qui est invraisemblable — que ces deux objectifs soient continuellement similaires et, à la limite, se confondent, il faut admettre des divergences, et même des conflits objectifs d’intérêts, entre les utilisateurs de l’output et les producteurs de l’organisation, quel que soit le système économique. La participation des utilisateurs est donc l’objet d’enjeux spécifiques et différents de ce qui est en jeu dans l’autogestion des producteurs.
Allons plus loin. Ne peut-on pas supposer que le pouvoir technocratique s’appuie sur cette divergence d’intérêts, qu’il monopolise ainsi la définition des besoins des usagers au nom d’une légitimité technique? Une société dominée par les producteurs, même sous forme autogestionnaire, ne risque-t-elle pas continuellement d’être une société technocratique? L’autogestion, non accompagnée d’une participation des utilisateurs, ne contient pas de mécanisme capable d’empêcher la génération constante d’un pouvoir technocratique qui définit, à partir des exigences de la production et des producteurs, ce que doivent être les besoins des utilisateurs, et utilise l’information et la compétence technique pour imposer ses valeurs. Cela ne serait pas nouveau: des anciens prêtres égyptiens aux intellectuels du monde actuel, le débordement de la sphère de compétence technique pour accroître pouvoirs et privilèges a été une constante historique: «Dans l’ancienne Égypte, les grands prêtres qui formaient l’élite prétendaient contribuer au bien du peuple en lisant l’avenir dans les astres15.»
Dans son principe et en tant qu’utopie, la participation des utilisateurs amènerait la fin de la division du travail telle qu’elle est conçue dans la société industrielle. Le contrôle de l’usager, en tant qu’utopie, va au-delà de la participation du producteur, même sous forme autogestionnaire; il constitue une contestation radicale (au sens de Marx: qui va à la racine…) de la société actuelle dominée par les producteurs.
Sans aller aussi loin, on peut facilement admettre comme point de départ que la participation des usagers peut constituer un moyen efficace de lutter, au sein d’une organisation, contre les tendances technocratiques. Cela éclaire la différence entre la participation des producteurs et celle des utilisateurs, et justifie l’intérêt d’une étude spécifique du rôle de ces derniers dans une organisation.
Rappel historique: l’idée de p...