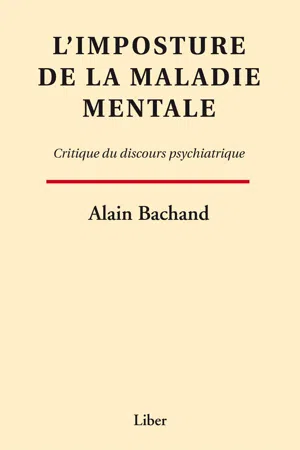![]()
CHAPITRE 1
La schizophrénie
La schizophrénie est considérée, en psychiatrie, comme une maladie. On lui attribue ainsi une étiologie (des causes), des symptômes (des manifestations), un diagnostic (une identification) et un pronostic (une évolution). Elle serait médicalement traitable et devrait être suivie par un psychiatre. En somme, ce serait une pathologie au même titre que le cancer. On pourrait même avancer qu’elle symbolise la psychiatrie tant elle lui est intimement liée.
La schizophrénie se réfère à des comportements bizarres variés, la plupart du temps socialement handicapants. Elle apparaîtrait généralement à la fin de l’adolescence, mais la schizophrénie de type paranoïde serait plus tardive. Les symptômes se manifesteraient parfois brutalement, parfois sur une longue période de temps. Dans la plupart des cas, le sujet négligera de plus en plus ses activités personnelles, professionnelles et sociales. Le schizophrène tend à perdre le contact avec la réalité, ce que l’on peut observer sous diverses formes : discours désorganisé ou incompréhensible, communication difficile ou déconcertante, manque de spontanéité et d’expressivité émotive, croyances insensées, réactions inappropriées, repli sur soi, asocialité, hallucinations auditives. La psychiatrie distingue plusieurs types de schizophrénie et les symptômes varient d’un type à l’autre, parfois même dans le même groupe. Prenons par exemple un cas de schizophrénie paranoïde, principalement caractérisée par un délire de persécution et une folie des grandeurs. Ce cas, décrit dans le manuel de psychiatrie Synopsis of Psychiatry, permettra d’illustrer partiellement ce qu’est la schizophrénie, dans la mesure où chaque cas se manifeste sous des formes qui témoignent de différences significatives.
Un homme de quarante-quatre ans est conduit d’urgence à l’hôpital après avoir frappé une vieille dame. Son trouble psychiatrique se déclare à l’âge de vingt-deux ans. Durant sa première année en droit, il est de plus en plus convaincu que ses compagnons de classe se moquent de lui. Il obtient peu après un emploi comme conseiller financier dans une banque et commence à entendre des voix. Il sera congédié. À vingt-quatre ans, il est hospitalisé pour la première fois et ne travaille pas depuis. Socialement isolé, il s’occupe de lui-même et administre seul un modeste héritage. Cet homme est persuadé que son appartement fait l’objet de surveillance et, selon lui, des réseaux de télévision et ses voisins sont complices dans cette machination. Des caméras cachées dans son appartement suivent toutes ses activités ; lorsqu’il sort, il croit que tout le monde le surveille ; s’il regarde la télévision, il est convaincu que ses moindres gestes, comme aller à la salle de bain, sont commentés par l’animateur. Il pense que ses voisins utilisent des machines visant à le régenter ; l’une d’elles, actionnée par la vieille dame qu’il frappera, est à l’origine des voix obsédantes qu’il entend, une autre insère des rêves érotiques dans son esprit. Selon lui, il y a beaucoup d’argent engagé dans ce travail de surveillance et il lui arrive de penser que tout cela vise à découvrir les secrets de son intelligence supérieure.
On présume que le cerveau des schizophrènes est anormal. Or, la schizophrénie n’est pas universellement reconnue comme une véritable maladie du cerveau. Les manuels de médecine et de pathologie ne la mentionnent pas et les neurologues n’ont rien à dire à son sujet. Pourquoi ? Parce que la schizophrénie, comme maladie du cerveau, n’a pas été établie. En 1999, A. Siebert souligne que toutes les hypothèses sur la schizophrénie en tant que maladie du cerveau ont été réfutées. Il en est encore de même aujourd’hui. Comme le note Boyle, bien que les critères qui définissent la schizophrénie soient arbitraires, qu’il y ait des désaccords au sujet de la distinction entre délire bizarre, qui est une forme de schizophrénie, et non bizarre et qu’aucun marqueur ou anormalité biologique ne lui soit attribué, on persiste à la présenter comme si nous avions acquis une réelle connaissance scientifique à son sujet.
Critique des théories biologiques
Au cours des années 1920, on a observé une tache mauve dans l’urine des patients schizophrènes. On a pensé que cela pouvait être utile dans le diagnostic de la schizophrénie, qu’on cherchait déjà à expliquer par cette anomalie biologique apparente. Or, d’autres chercheurs ont découvert que cette tache était en réalité associée à un métabolite (produit de décomposition résultant de médicaments) provenant des drogues administrées aux patients. Cet exemple illustre la tendance, en psychiatrie, à réduire la schizophrénie à des explications biologiques, sans tenir compte des facteurs contextuels. La corrélation entre la schizophrénie et certaines variables biologiques ne signifie d’ailleurs rien quant à la schizophrénie, car ces variables peuvent être attribuables à d’autres facteurs.
Théories génétiques
On estime qu’environ 1 % de la population souffrira de schizophrénie au cours de sa vie. Toutefois, si un enfant est né d’un parent schizophrène, les risques augmentent jusqu’à 7 % ; s’il est né de deux parents schizophrènes, les risques atteignent 27 %. Si, chez des jumeaux identiques, l’un est schizophrène, il y a de 11 % à 67 % (selon des études répertoriées entre 1963 et 1998) de probabilité que l’autre le soit aussi. Les chiffres varient donc selon les études. Ce qu’il faut retenir, c’est que plus notre lien de parenté avec une personne souffrant de schizophrénie est proche, plus nous avons de risques d’en être atteint. La schizophrénie pourrait être d’origine génétique. Or, aucun examen médical, rappelons-le, ne permet d’identifier les présumés gènes responsables de la schizophrénie. Trois types d’études sont invoquées pour démontrer les bases génétiques de la schizophrénie : les études sur la famille, celles sur les jumeaux et celles sur l’adoption. Elles comportent des failles méthodologiques qui invalident leurs résultats. Loin de prouver la base génétique de la schizophrénie, elles dressent au mieux des constatations statistiques qui ne mènent à aucune conclusion scientifique.
Par exemple, on a tout d’abord cherché à savoir si la schizophrénie était plus fréquente au sein des mêmes familles. L’observation est en effet juste, mais elle peut s’expliquer par des influences environnementales. Ainsi, nous avons tendance à imiter et à partager les attitudes et les pensées de ceux avec qui nous vivons. On aura sans doute plus de chances de devenir mécanicien si l’on vient d’une famille de mécaniciens et on sera plus enclin à partager les positions politiques de nos parents. On n’en conclut pas pour autant que notre métier et nos positions politiques sont d’origine génétique. On a d’ailleurs reconnu les faiblesses méthodologiques de ces travaux sur la famille. C’est pourquoi, toujours pour fonder l’idée de l’origine génétique de la schizophrénie, on s’est tourné vers les jumeaux.
Les jumeaux identiques (monozygotes) sont plus souvent, l’un et l’autre, schizophrènes que les jumeaux non identiques (dizygotes). Si l’un des jumeaux monozygotes est diagnostiqué schizophrène, les risques que l’autre le soit se situent entre 11 % et 67 % ; dans le cas de jumeaux dizygotes, les risques vont de 2 % à 18 % (toujours selon ces mêmes études répertoriées entre 1963 et 1998). Le taux de concordance varie selon les études, mais il reste plus élevé chez les monozygotes.
En dépit de cette concordance, la schizophrénie ne peut pas se comprendre par une cause exclusivement génétique, comme la couleur des yeux, puisque l’un des jumeaux monozygotes peut être diagnostiqué schizophrène sans que l’autre le soit. Le taux de concordance plus élevé chez les monozygotes peut s’expliquer par des facteurs non génétiques. Plus que les dizygotes, ils ont tendance à être traités, dans leur milieu familial, d’une façon similaire et sont ainsi susceptibles d’être exposés aux mêmes influences ; ils entretiennent aussi des liens émotifs plus étroits. Le taux est d’ailleurs plus élevé chez les jumelles identiques qui entretiendraient des liens encore plus étroits et seraint davantage encouragées à se comporter de façon similaire que les jumeaux identiques. De la même manière, le taux de concordance de schizophrénie est plus élevé parmi les jumeaux non identiques que celui qu’on retrouve parmi les frères et sœurs en général, et ce, même s’ils ne sont génétiquement pas plus semblables que ces derniers. Or, chez les jumeaux non identiques, on observe aussi une tendance à partager un même environnement. Dans tous les cas, le taux de concordance de schizophrénie, plus élevé parmi les jumeaux, peut se comprendre par ces similitudes et influences contextuelles.
Le taux de concordance de schizophrénie varie selon les études, mais se situe en moyenne à 22 %. En somme, cela signifie que 88 % des jumeaux identiques ne développent pas en même temps une schizophrénie. Par ailleurs, il y aurait lieu de réduire ce 22 % si on tenait compte des critiques auxquelles ces études sont sujettes. J. Joseph note qu’on a vu, au cours des années, plusieurs études affirmer avoir découvert le gène de la schizophrénie, mais invariablement, on est incapable de les reproduire. Il semble bien que les psychiatres généticiens cherchent des gènes qui n’existent pas.
Est-ce que les études sur l’adoption permettent de mieux dégager les bases génétiques de la schizophrénie ? On peut en douter. On retient deux manières de procéder. Dans un cas, on établit une liste d’enfants adoptés qui ont développé une schizophrénie et on les compare à leurs proches biologiques. Si on constate chez ces proches une tendance à la schizophrénie, on infère un lien génétique. Dans l’autre, on dresse une liste de parents schizophrènes qui ont donné leur enfant en adoption. Si ces enfants adoptés souffrent de schizophrénie, on infère également un lien génétique.
De telles études sont cependant moins significatives que nous pourrions le penser. Prenons par exemple une étude publiée en 1968 sur des enfants adoptés, diagnostiqués schizophrènes à l’âge adulte. Les proches biologiques de trente-quatre sujets diagnostiqués schizophrènes ont été comparés aux proches biologiques de trente-quatre autres sujets, non diagnostiqués schizophrènes mais adoptés par les mêmes familles. Une même famille adoptive avait ainsi un enfant diagnostiqué schizophrène à l’âge adulte et un autre (du même sexe et du même âge) non diagnostiqué schizophrène à l’âge adulte. On a retracé environ cent cinquante proches biologiques d’un côté et de l’autre, le terme « proches biologiques » signifiant ici parents, frères, demi-frères, sœurs et demi-sœurs. Les résultats de cette étude sont peu concluants, puisqu’il n’y aurait eu qu’un seul cas de schizophrénie dans chacun des deux groupes de proches biologiques. Les auteurs de l’étude ont cependant regroupé un ensemble de désordres mentaux (état borderline, personnalité inadéquate, schizophrénie incertaine) sous un vague concept renvoyant à la schizophrénie (schizophrenic spectrum of disorders). En employant un tel concept, on constatait alors que 8,7 % des proches biologiques des enfants adoptés schizophrènes avaient une forme ou une autre de schizophrénie, comparativement à 1,9 % chez les proches biologiques des enfants adoptés non schizophrènes. Cette différence, notent Rose, Lewontin et Kamin, était censée démontrer les bases génétiques de la schizophrénie.
Anomalies biologiques
À l’aide de l’imagerie cérébrale, on a relevé chez certains schizophrènes des anomalies biologiques susceptibles d’expliquer leurs comportements. L’interprétation de ces résultats pose d’importantes difficultés théoriques et techniques puisque les termes comme « cognitif », « mental », « facultés » et « traits » restent mal définis. Il n’en demeure pas moins qu’on tente de localiser ces abstractions sur une image en trois dimensions du cerveau. Ces études doivent être nuancées, voire contestées. On a remarqué par exemple une atrophie du cerveau chez le schizophrène et on suppose, sans preuves à l’appui, qu’elle est un des facteurs responsables de la maladie. Le cerveau est composé de ventricules, espaces creux interconnectés et remplis de fluide cérébro-spinal. Lorsqu’ils s’élargissent, cela provoque un rétrécissement de la masse cérébrale. Cette atrophie, observée chez le schizophrène, démontrerait que la schizophrénie est une maladie du cerveau.
Or, notons d’abord que maints schizophrènes ont des ventricules qui se situent à l’intérieur des limites normales (cela varie de 60 % à 95 %). D’après une étude sur vingt-quatre schizophrènes, trois montraient un élargissement anormal du cerveau, alors que les vingt et un autres n’en présentaient pas. Selon certaines études, les schizophrènes ont en effet des ventricules plus grands, mais les sujets témoins avec lesquels ils ont été comparés avaient, eux, des ventricules plus petits que la moyenne et n’étaient donc pas représentatifs de la population générale. Lors d’un examen des ventricules de schizophrènes et de ceux d’une pop...