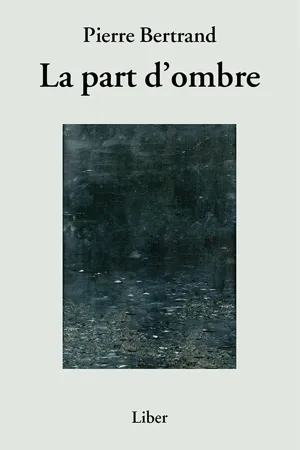![]()
Chapitre 13
Culte de l’image et idéalisme
L’idéalisme a toujours été une tendance importante en philosophie. De l’idée à l’idéal en effet, il n’y a qu’un pas, allègrement franchi dès le départ par Platon. L’idée s’idéalise, c’est-à-dire qu’elle se met, à l’instar de la pensée dont elle est un élément, en position de surplomb. Elle sert de modèle ou d’archétype, à l’aune duquel sera mesurée la réalité sensible ou empirique. L’idée est pure, inconditionnelle, absolue. La pensée se prend pour Dieu ou plutôt elle crée Dieu à son image. «Ce qui devrait être» sert d’horizon à «ce qui est». L’utopie prend le pouvoir: si elle n’est pas réalisable dans cette vie-ci, elle arrivera dans une autre vie! La pensée est spontanément idéaliste. C’est pourquoi elle se berce si aisément d’illusions. Cependant, que nous le voulions ou non, nous sommes forcés d’habiter la réalité, aussi étrange, incompréhensible, injuste et absurde soit-elle. L’idée et l’idéal que l’être humain invoque émanent de son propre esprit. Ce dernier tente ainsi de simplifier le monde, de ramener son étrangeté à quelque chose de familier. La réalité ne se laisse toutefois pas manipuler ainsi. Elle remet en question les idées et les idéaux de la raison, les déjoue, les dépasse.
Peut-être n’est-il pas possible de dire grand-chose de la réalité telle qu’elle est, tellement elle nous laisse bouche bée. Alors parlons d’elle avec sobriété. Il y a souvent plus de savoir dans la contemplation silencieuse que dans beaucoup de discours, qu’ils émanent des religions, des philosophies, voire des sciences. Ces discours font partie de la variété extraordinaire de ce qui est, loin de pouvoir en rendre compte ou raison. Certes faisons-nous l’effort de comprendre ce qui est à notre portée, de manière à pouvoir intervenir au nom de ce que nous jugeons être notre bien. Ne prétendons pas toutefois avoir le fin mot de l’histoire, comme le fait le discours métaphysique, peu importe où il se tient. La véritable grandeur de la pensée ou de la raison consiste à être consciente de ses limites. Le plus souvent, elle les outrepasse, réduisant de ce fait la réalité à sa mesure, même si, ce faisant, elle invoque les notions apparemment les plus élevées, tel Dieu. Celui-ci sonne tellement anthropomorphique dans la bouche de l’homme, loin d’être à la hauteur de l’étrangeté, voire du mystère de la réalité. J’insiste sur la réalité telle qu’elle est afin d’indiquer qu’elle nous échappe et que nous n’avons le plus souvent accès qu’à la réalité telle que nous aimerions qu’elle soit ou telle que, selon nous, elle devrait être. Pouvons-nous voir la réalité, ou ne sommes-nous pas plutôt réduits à n’en voir que des fragments, découpés en fonction de nos besoins, de nos désirs et de nos capacités? Je ne veux pas non plus donner l’impression de tomber dans le mysticisme en insistant trop sur le mystère. Le mysticisme est lui aussi imbu d’idéalisme et très vite ne parle plus de la réalité telle qu’elle est, mais telle qu’interprétée à partir d’un conditionnement religieux ou idéologique. La pensée doit être libre, silencieuse, pour entrer en contact, même furtivement, avec la réalité. Peut-être n’est-il pas vraiment possible de traduire celle-ci en mots, d’où l’insatisfaction que nous éprouvons facilement à l’endroit de tout discours, le trouvant partiel, approximatif, inadéquat, privilégiant un aspect au détriment des autres. Tout discours, même le plus généraliste, comme le discours religieux ou philosophique, demeure spécialisé, ne voyant la réalité que d’un point de vue déterminé. Nous touchons là aussi les limites humaines. Ce ne sont pas ces limites en soi qui font problème, mais plutôt le fait de ne pas les voir et par conséquent de ne pas en tenir compte. Voir les limites et en tenir compte, c’est déjà les dépasser et donner lieu à un autre type d’approche ou de contact avec la réalité, contact qui précède ou accompagne le discours puisqu’il ne peut être complètement pris en charge par lui. Il n’y a rien en cela de mystique, rien d’extraordinaire, puisqu’il s’agit en fait de l’expérience la plus commune, bien qu’elle soit le plus souvent ignorée.
Ce contact avec ce que nous sommes nous rend intensément vivants. Il nous fait toucher la vérité de la réalité dont nous faisons partie. Nous pensons que la vérité s’identifie à la science, seul discours en lequel nous puissions avoir pleine confiance, car objectif. Aussi objectif ou prétendu tel soit-il, le discours scientifique n’est qu’un discours supposant la rencontre du cerveau et du monde. Il est loin d’épuiser la vérité ou la réalité puisque celle-ci inclut le cerveau ainsi que sa rencontre avec le monde. Qui plus est, le discours lui-même, quel qu’il soit, y compris le discours scientifique, fait également partie du problème de la vérité ou de la réalité, loin de pouvoir le résoudre de l’extérieur. Ce que nous sommes fait pour l’essentiel l’objet d’une perception immédiate dans le présent vivant. Cette perception est si intense qu’elle brûle tout discours. Nous ne nous percevons pas dans le but de nous transformer, mais la perception même est transformation, à savoir contact avec la réalité telle qu’elle est ou devient. Ce contact est le plus difficile, bien qu’il soit au point de départ de toute autre entreprise. Ce point de départ est le plus souvent court-circuité, le contact se faisant davantage avec l’illusion qu’avec la réalité, toute mise en discours participant d’une certaine forme d’illusion. Le discours est toutefois inévitable puisqu’il est automatiquement engendré par la pensée ou le cerveau. Encore faut-il ne pas en être dupe et le voir, lui aussi, tel qu’il est. Il n’est pas la vérité ou la réalité, comme il le prétend, servant au contraire fréquemment à la camoufler. La vérité ou la réalité ne se laisse pas saisir ou posséder. Elle nous dépouille au contraire de notre savoir, plus encore de ce que nous sommes et pensons — de ce que nous pensons être. Le contact avec soi, comme d’ailleurs avec le reste de la réalité, se fait dans la sobriété, au cœur d’une certaine qualité de silence.
À l’encontre de tout idéalisme, l’important est de nous voir tels que nous sommes, non pas pour nous juger, nous encenser ou nous condamner, ni même à la rigueur pour nous changer, mais pour être simplement en contact avec ce que nous sommes. En nous voyant, c’est l’humain que nous voyons, car nous ne sommes pas fondamentalement différents les uns des autres. Nous insistons pourtant beaucoup sur la différence, car notre société est construite sur l’individualisme. L’ego a été exacerbé. Cependant l’individualisme touche tout le monde; il est donc collectif! Nous portons tous et toutes en nous l’humaine condition. Encore faut-il entrer en contact avec elle au lieu de nous complaire dans des images. Jésus et Bouddha par exemple sont des individus universels. C’est en cela qu’ils peuvent encore nous toucher. D’autres philosophes ont tendu à une telle universalité, mais la dimension intellectuelle ou théorique a chez eux souvent pris le pas sur la dimension affective ou pratique, ce qui n’est pas le cas avec Jésus et Bouddha. Il ne s’agit toutefois pas de prendre qui que ce soit comme modèle, car chacun a sa propre façon d’entrer en contact avec l’universel. Singularité et universalité ne s’opposent aucunement. Elles sont même inséparables. L’humanité s’incarne dans des individualités. La sensibilité et l’intelligence de chacun sont uniques. Les langues et les cultures sont multiples. Chacun doit donc emprunter son propre chemin le conduisant à l’humain et par-delà l’humain. S’il suit le chemin d’un autre, il erre. Nous ne pouvons avancer vraiment qu’éclairés par notre propre lumière, même vacillante, même obscure. Seule cette lumière immanente nous permet de voir la réalité. Quand cette dernière est éclairée par une lumière extérieure, jouant le rôle d’une autorité, nous sommes aveuglés par elle. Lorsque nous voyons directement ce qui est, aussi insaisissable cela soit-il, ce qui est s’éclaire de l’intérieur. Il apparaît dans son étrangeté, dans sa nouveauté, dans son mystère. La lumière extérieure est plutôt celle de l’image ou de l’idée. La réalité est alors perçue du point de vue de l’image ou de l’idée, fût-elle celle du Bien, comme chez Platon, ou celle de Dieu, comme dans l’ensemble des religions.
Le philosophe peut-il prétendre détenir une vérité que les autres n’auraient pas? D’où la tirerait-il? D’une faculté de penser supérieure à celle des autres? Mais qui nous assure que cette faculté de penser, y compris dans son caractère le plus formel et abstrait, dans les mathématiques et la logique, soit capable d’avoir accès à la vérité? Et qu’est-ce que la vérité? N’est-elle pas toujours une vérité liée nécessairement au point de vue humain? Les mathématiques et la logique n’appartiennent-elles pas au cerveau et à la pensée? Ne sont-elles pas humaines en dépit de leur prétention à l’éternité? Aussi loin veuille-t-il aller dans l’universalité, l’être humain ne doit pas oublier qu’il est lui-même une partie de la nature et qu’il la perçoit — la sent, l’imagine, la pense — de son point de vue. Cela n’enlève rien à la valeur de ce point de vue. Il n’est cependant ni unique ni absolu. Seul le point de vue de Dieu l’est, mais la question se pose: Dieu existe-t-il ou n’est-il qu’une projection de la pensée, exprimant la prétention de celle-ci à être au-dessus de la mêlée? Parler de «vérités éternelles», comme le fait encore un philosophe comme Alain Badiou, c’est à la fois manquer de modestie et faire preuve de naïveté. Un certain rationalisme français a décidément la peau dure. Descartes ne cesse de se réincarner. Les idées claires et distinctes, si elles nous calment, n’en laissent pas moins de côté tout ce qui est obscur et confus, c’est-à-dire la part d’ombre de la réalité, y compris de la réalité humaine. Si l’on reproche aux Allemands d’être trop confus et obscurs, on peut reprocher aux Français d’être trop clairs et distincts. Le rationalisme n’est que l’envers du romantisme. La philosophie doit sortir d’elle-même, cesser d’être une spécialité, pour devenir ce qu’elle était déjà pour les tout premiers philosophes, à la fois une interrogation et une exclamation, une pensée et un poème, une ambitieuse et audacieuse explication ou compréhension et un chant. Elle ne peut être le seul produit de la pensée, faite exclusivement d’idées ou de concepts, mais doit aussi venir des autres parties du corps, des percepts et des affects. En ce sens est-elle un art et doit-elle être liée aux autres arts — la littérature, la musique, le théâtre, le cinéma. Ainsi, la pensée ne se prend pas pour le nombril du monde, mais occupe sa place relative dans le corps. Il est vrai qu’elle est depuis longtemps considérée comme le fleuron de l’humanité, ce qui met l’être humain au-dessus des autres animaux et le rend semblable à Dieu. Pourquoi la pensée occupe-t-elle une telle position hégémonique? Dieu n’est-il pas la pensée toute-puissante, absolue, éternelle, produisant le monde, comme l’avait déjà vu Platon, à partir de ses seules Idées?
Dans le long processus de l’évolution, la pensée a été sélectionnée comme offrant des avantages manifestes aux vivants qui en étaient pourvus. C’est grâce à la pensée que l’homme prend le pouvoir sur les autres animaux. Certes ces derniers ont aussi une pensée, mais moins complexe et sophistiquée que la nôtre. Cependant tout ce qui est bon, lorsque poussé à l’excès, ne devient-il pas mauvais? Quand elle prend trop de place au détriment du reste du corps vivant, la pensée n’aide plus l’être humain à y voir clair. Elle l’aveugle au contraire. Être sous un soleil trop brillant ne nous aide pas à voir. Nous avons besoin d’une part d’ombre et de clair-obscur. Le grand soleil platonicien de l’Idée inflige à l’homme des insolations qui l’abêtissent sous prétexte de le rendre plus intelligent. Il en est de la philosophie comme de tous les autres mouvements de création. La grandeur humaine d’une œuvre dépend de la capacité qu’a l’homme ou la femme de s’y investir tout entier — corps et esprit, forces et faiblesses, percepts, affects et concepts. Une philosophie trop spécialisée, c’est-à-dire trop exclusivement intellectuelle ou rationnelle, trop liée à la connaissance, trop près de la science, si elle satisfait le besoin de clarté, de vérité et de certitude de la pensée, frustre les autres capacités du corps.
La réalité, y compris la réalité humaine, n’est pas géométrique au sens classique du terme. Si géométrie il y a, elle est fractale. C’est dire que la réalité est indéfinie ou incommensurable, bien que la pensée, prise en son sens étymologique de «pesée» — comme d’ailleurs la raison, prise en son sens étymologique de «mesure» —, cherche à la conformer à un modèle de géométrie ou d’harmonie classique. La pensée n’a de la réalité qu’une vision idéale. Pour être comprise ou expliquée, la réalité doit être comparée à un modèle, donc plus ou moins assimilée à celui-ci. Elle est en fait pleine de plis, de fluctuations et d’anfractuosités. Pendant longtemps, aussi bien en peinture, en sculpture, en musique qu’en philosophie, a prévalu la grille ou le modèle chrétien. Aujourd’hui, ne nous leurrons pas, d’autres grilles ou modèles prévalent parfois à notre insu. La réalité est rarement perçue dans ses plis et son chaos. L’art et la philosophie tentent bien de le faire, mais les lignes qu’ils tracent ne se figent-elles pas en de nouvelles figures géométriques et rationnelles? Si nous pouvons entrer en contact avec le chaos, n’est-ce pas à la condition de le transformer immédiatement en cosmos? Dieu lui-même, comme modèle suprême de la pensée, n’a pu faire autrement. Penser et parler peuvent-ils se faire autrement? Ce sont là des attributs essentiels de la réalité humaine, bien que celle-ci ne se réduise pas à eux puisqu’elle demeure en elle-même, comme le reste de la réalité, impensable et indicible. Comment nous approcher de cet impensable et de cet indicible, tout en pensant et en parlant? Telle est la véritable question de l’art, pris ici au sens de tout mouvement de création, peu importe le domaine dans lequel il s’effectue. La philosophie a du mal à s’en approcher, tellement elle est inféodée à la pensée ou à la raison, et tellement elle dépend du langage. La littérature en général et la poésie en particulier, parce qu’elles font davantage appel à la sensibilité du corps entier, sont mieux outillées pour s’en approcher, mais le défi demeure de taille et doit sans cesse être affronté de nouveau, toute réponse trouvée risquant de devenir un nouveau modèle empêchant le contact. Les arts plastiques occupent-ils une position privilégiée puisqu’ils semblent plus loin de la pensée et du langage? Pensée et langage prennent en eux d’autres formes, non moins assujetties à des modèles et non moins contraignantes. Il n’y a pas de voie royale menant à la création, seulement des voies de traverse, puisque c’est en sortant des sentiers battus, en errant, que l’on y accède. S’il est impossible, compte tenu de la nature de la pensée et du langage, de ne pas figer la réalité, peut-être est-il possible de continuer à la suivre en son devenir fractal, en reprenant sans cesse la ligne sinueuse de la création.
Un certain ton rationnel employé en philosophie peut laisser croire que le philosophe n’est pas un homme ou une femme comme les autres, mais un moi transcendantal. Il ne faut cependant pas être dupes du style ou du ton, car, bien que la pensée de chacun se croie séparée, tous les corps vivants participent à la même condition. C’est parce que le créateur y est particulièrement sensible qu’il ne peut pavoiser ou tirer longtemps orgueil d’un quelconque accomplissement. Il est conscient de l’état de danger inhérent à tout vivant. Il se débat dans les problèmes, loin de prétendre avoir les solutions. Ce n’est évidemment pas que le philosophe qui peut donner l’impression de se trouver au-dessus de la mêlée. Le photographe, par exemple, la donne aussi puisque l’appareil technique s’interpose entre lui et son sujet, le protégeant en le mettant dans la position du voyeur. L’appareil assume le contact, l’œil se mettant à son service, l’être vivant demeurant quant à lui à l’écart. L’humanité a soif d’objectivité, car elle croit que celle-ci la met à l’abri. Il y a d’abord eu l’objectivité de Dieu, être impersonnel et universel par excellence, tout-puissant, omniscient, éternel. Dieu ne pouvant parler que par la bouche de l’homme, celui-ci se trouve ainsi lui-même en position de surplomb, adoptant le point de vue de la transcendance. C’est aujourd’hui la science qui joue ce rôle. Elle est porteuse d’une nouvelle objectivité, se faisant cette fois en immanence. Grâce à elle, l’homme adopte le point de vue objectif, non plus de l’esprit absolu, mais de la matière relative. L’extériorité du spécialiste a remplacé la transcendance du prêtre. À côté de la religion et de la science, l’art indique le lien indissoluble entre l’homme et le monde, plus encore entre l’individu singulier et les autres êtres.
Du point de vue de l’art, il est impossible de faire abstraction de l’individualité vivante, contrairement à ce que cherchent à faire la religion et la science. Cela ne signifie pas pour autant que chacun soit enfermé dans sa subjectivité puisqu’au contraire l’art montre que tous les individus sont fondamentalement semblables les uns aux autres, en dépit de la prétention de certains — pas seulement les prêtres et les savants — de se croire au-dessus de la mêlée. L’art nous indique que nous participons tous à la même condition, que personne ne détient le fin mot de l’énigme ou ne jouit d’un pouvoir particulier le mettant à l’abri. L’artiste ne peut faire abstraction de lui-même dans son art puisque ce dernier exige au contraire qu’il s’ouvre à lui-même dans le même mouvement qu’il s’ouvre aux autres et au monde.
La vie en société n’induit-elle pas une essentielle hypocrisie puisqu’il faut apparemment correspondre à des modèles, alors que la réalité de ce que nous sommes ou devenons est en fait tout autre? En nous proposant des modèles, la société nous demande de faire des efforts pour nous y conformer. Quand il s’agit d’élever les êtres humains à l’idée ou à l’idéal, on n’y parvient qu’en détruisant d’abord ce qu’ils sont. La société met l’idéal ou le modèle au-dessus de la réalité, amenant ainsi les individus à être faux, les déconnectant d’eux-mêmes ou les mettant dans une position de porte-à-faux à l’endroit d’eux-mêmes. Les individus éprouvent de la difficulté à se voir tels qu’ils sont, portés plutôt à être vus et à se voir tels qu’ils devraient être. La personne devient masque, personnage, rôle, statut, réputation, image… Elle ne peut s’empêcher de constater qu’elle ne correspond pas à ce qu’elle affiche ou à ce que les autres voient, mais elle n’a pas le choix, elle est prise dans la structure sociale de l’apparence, de la représentation ou du spectacle. Elle se retrouve dans une position de conflit avec elle-même, dans la mesure où tant de traits d’elle-même ne correspondent pas aux images valorisées. Si elle ment aux autres, elle se ment aussi à elle-même. Amoureuse de l’idéal, elle ne peut que détester la réalité, la sienne, celle des autres et celle du monde. L’«autre monde», idéal ou utopique, ne peut advenir que sur la ruine de celui-ci. N’y a-t-il pas quelque chose de nihiliste dans ce refus de l’être humain de se voir tel qu’il est, si peu conforme à l’idéal, au modèle régnant à chaque époque, que ce soit celui de la sainteté, de la sagesse ou de l’excellence? L’être humain est en fait un mélange de tant d’éléments disparates, hétérogènes, certains pouvant être qualifiés de bons, de généreux, de sublimes, d’autres de mauvais, de cruels, d’ignobles. L’être humain est tout à la fois, même si on voudrait le simplifier pour qu’il corresponde davantage aux images aménagées, qu’on puisse le caser dans une catégorie susceptible de rassurer la raison et la logique. Cependant l’être humain, comme le reste de la réalité d’ailleurs, n’échappe-t-il pas fondamentalement au logos — raison ou parole — puisque ce dernier n’en est qu’une partie s’inscrivant dans la multiplicité ou l’hétérogénéité de ce qui est ou devient?
Beaucoup de nos illusions se trouvent ainsi liées au spectacle ou à la représentation. Par exemple, un acteur ou une actrice de cinéma apparaît surhumain. Il prend les dimensions de son image. Nouveau dieu d’une religion païenne, il trône dans le ciel comme une star. En réalité, cet acteur ou cette actrice est un homme ou une femme comme les autres, mais ce caractère commun est complètement gommé au profit de la seule image. Pourquoi donc ce besoin d’idoles? Remontons dans le temps: Jésus était lui aussi un homme comme les autres. On en a fait un dieu, transformant tous les événements...