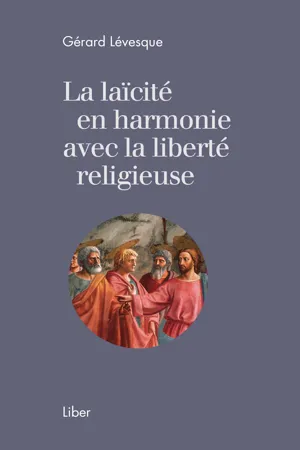
- 208 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Laïcité en harmonie avec la liberté religieuse (La)
À propos de ce livre
Par son langage clair et son argumentation serrée, cet ouvrage est une contribution fondamentale aux débats qui agitent notre société et qui brouillent souvent nos relations au point de les rendre impossibles. L'auteur y soutient qu'une remise en cause de la laïcité de l'État qui la jugerait incompatible avec la liberté de religion est la marque d'une profonde méconnaissance du principe de laïcité. Il montre que seule une conception abusive et absolutiste de la liberté a pu mener à ce qu'on nomme désormais le «gouvernement des juges» et défend qu'en ayant une bonne compréhension de la liberté religieuse, on peut au contraire réaffirmer la légitimité de la laïcité de l'État.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Laïcité en harmonie avec la liberté religieuse (La) par Gérard Lévesque en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politique et relations internationales et Politique. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Chapitre 1
Aux sources de la laïcité
Dans un long entretien au lendemain de la tuerie du 29 janvier 2017 au Centre culturel musulman de Sainte-Foy, les présidents de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles créée dix ans plus tôt, Gérard Bouchard et Charles Taylor, déploraient que le gouvernement n’ait pas donné suite à leur recommandation de mettre en place un plan plutôt que d’improviser chaque fois1. À défaut d’une réflexion de fond sur la laïcité et les questions connexes, d’ailleurs recommandée par la même commission, il faut s’attendre à ce que la moindre velléité de légiférer en matière religieuse soit toujours sujette à controverse tout comme le sont les décisions des tribunaux sur le droit à la pratique religieuse.
On comprend souvent mieux une réalité quand on la saisit à partir de ses commencements et de ses idées initiales. Pour avoir une juste appréciation de la nature et de la portée de la laïcité et de ses rapports avec la religion, il convient d’en rappeler les origines historiques, principalement quant aux visions conceptuelles et doctrinales qui en sont au principe.
La plupart de ceux qui se livrent à cet exercice ne remontent guère loin dans le temps. Certains s’arrêtent même aux dernières décennies. Ceux qui lèvent davantage les yeux remontent à des documents moins récents, par exemple la loi française du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Bill of Rights américain de 1791, l’Habeas Corpus Act de 1679 ou encore la Magna Carta de 1215.
Il est vrai que la question ne s’est pas toujours posée dans les termes actuels des rapports entre la laïcité et la religion. Le mot laïcité n’est d’ailleurs apparu qu’au dix-neuvième siècle. Pourtant la réalité qu’il désigne est infiniment plus ancienne, comme l’atteste son étymologie grecque ( laos ) et latine ( laicus ). La question portait alors sur les rapports entre pouvoir politique et pouvoir religieux. On se souviendra que le philosophe Socrate fut condamné à mort pour sa prétendue « impiété ». L’acte d’accusation précisait qu’il était coupable de ne pas croire aux dieux reconnus comme au service de l’État et de corrompre la jeunesse avec ses idées philosophiques sur la transcendance et le divin. Sa méthode de réflexion critique dérangeait l’ordre politique établi ; l’instrumentalisation des tribunaux fit le reste. Avant même que le mot n’existe, on est bien là aux sources vives de la laïcité et des énormes vagues auxquelles elles donneront lieu tout au long de l’histoire de la civilisation occidentale.
C’est dans les écrits de Platon, disciple de Socrate, que l’on trouve les premières tentatives de traiter rationnellement du rapport entre le politique et le religieux. La réflexion philosophique distinguera alors ce qui relève du mythique et du religieux de ce qui est du domaine de la rationalité, philosophique, politique, éthique et juridique. Le dialogue platonicien intitulé Euthyphron, du nom d’un devin de l’époque, est particulièrement significatif à cet égard. Mais ce sera davantage la pensée du disciple de Platon, Aristote, que l’on retiendra à ce sujet dans les siècles suivants, en raison de sa plus grande précision et du réalisme de ses conceptions philosophiques et politiques.
Tout en reconnaissant ce premier apport, le philosophe et historien des idées Frédéric Lenoir met davantage l’accent sur l’autre racine de la pensée occidentale en matière de laïcité et de liberté de religion, à savoir le message de celui qu’il appelle le « Christ philosophe », autrement dit du christianisme.
Pourquoi la démocratie et les droits de l’homme sont-ils nés en Occident plutôt qu’en Inde, en Chine, ou dans l’empire ottoman ? Parce que l’Occident était chrétien. [L]e Christ enseigne aussi une éthique à portée universelle : égale dignité de tous, justice et partage, non-violence, émancipation de l’individu à l’égard du groupe […], liberté de choix, séparation du politique et du religieux […]. Quand, au quatrième siècle, le christianisme devient religion officielle de l’Empire romain, la sagesse du Christ est en grande partie obscurcie par l’institution ecclésiale. Elle renaît mille ans plus tard, lorsque les penseurs de la Renaissance et des Lumières s’appuient sur la « philosophie du Christ », selon l’expression d’Érasme, pour émanciper les sociétés européennes de l’emprise des pouvoirs religieux et fonder l’humanisme moderne2.
L’Occident chrétien constitue le patrimoine religieux de la civilisation occidentale en matière de laïcité. Le porte-parole le plus crédible et le plus autorisé de la religion chrétienne est le Christ, son fondateur. Nous retirerons un grand avantage de ses propos, notamment en ce qu’ils permettent de faire ressortir une différence de civilisation entre la pensée occidentale et l’islamisme. C’est cette différence civilisationnelle qui devrait ultérieurement éclairer les rapports entre laïcité et religion et les perceptions différentes au sujet de la démocratie et les droits de l’homme nés en Occident. Parce que l’Occident était chrétien.
Entre Dieu et César :
trois séparations plutôt qu’une
trois séparations plutôt qu’une
Frédéric Lenoir décrit le contexte historique à partir duquel s’est rendu jusqu’à nous le précepte bien connu selon lequel il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu :
Jésus prend acte de l’existence du pouvoir politique […] il n’interdit pas au publicain de percevoir les impôts du peuple au profit des Romains ; il lui demande simplement de ne pas prendre plus que la juste mesure […]. La justice des hommes n’est pas celle de Dieu et les lois qui confondent les deux sphères, telle cette loi biblique qui prescrit la lapidation de la femme adultère, n’ont aucune valeur à ses yeux. Le message de Jésus est en fait une dénonciation de la confusion entre les champs du religieux et du politique […]. C’est dans cette optique que Jésus demande de voir une pièce d’argent avant de se positionner sur la légitimité du paiement de l’impôt à César. […] Et Jésus dit alors : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu3. »
La dénonciation de la confusion entre domaine religieux et domaine politique implique à notre avis trois séparations spécifiques entre l’État et l’Église au sein de la philosophie du Christ4. Il est instructif de les distinguer et de les retenir toutes les trois, d’autant plus que deux d’entre elles sont à tort généralement passées sous silence. Elles concernent la vie politique, la vie courante et la vitalité de la foi.
Le premier volet du principe de la distinction entre César et Dieu est celui qui retient habituellement le plus l’attention. Il a trait à la distinction entre la religion et la politique, au sens de gouvernance ou de direction de la cité, et est communément identifié au principe de la séparation de l’État et de l’Église, ainsi nommé en raison de son origine chrétienne, voire catholique. En raison de son universalité, il vaudrait mieux parler à son sujet de séparation de l’État et de la religion — ou des religions.
Pour illustrer ce sens coutumier du principe relatif à la distinction entre ce qui relève de César et de ce qui relève de Dieu, on a avantage à le situer dans le contexte historique où il a été formulé pour la première fois. « Jésus a vécu à une époque où la situation politique du peuple juif n’était pas facile. Le peuple vivait sous la domination des Romains après avoir été conquis au quatrième siècle par les Grecs5. » La gouvernance politique et l’administration de la vie publique au sein de l’État juif est sous l’autorité des Romains. Ce pouvoir de l’occupant empêche le sanhédrin, l’instance religieuse suprême composé des grands prêtres, de diriger la vie publique et politique comme il aurait voulu le faire guidé par le seul code religieux de la Torah. Aussi espérait-on un messie capable de conduire à une libération nationale. Et les tenants de l’autorité religieuse pouvaient souhaiter que l’ascendant que Jésus exerçait sur les foules aurait pour effet que le peuple se révolterait. L’effigie de César est donc le symbole de l’autorité politique romaine. Le principe de la séparation entre César et Dieu consiste ainsi à reconnaître que la gouvernance politique de la cité ne relève pas des instances religieuses.
Le deuxième volet a trait à la séparation entre la vie courante et les rituels religieux. C’est celui dont relèvent en particulier les demandes dont nous sommes aujourd’hui familiers d’accommodements pour motif religieux. De nos jours, en effet, la laïcité est confrontée non pas tant à l’influence directe du pouvoir religieux dans la gouvernance de la cité, mais aux impératifs des pratiques cultuelles et à leurs conséquences dans l’administration de la vie courante. À l’époque de Jésus, la gouvernance politique et administrative qu’ambitionnent les autorités religieuses juives vise à assurer le respect des prescriptions de la Torah — celles-là mêmes justement que Jésus invoque pour dénoncer la confusion entre le religieux et le politique. De façon plus concrète, ce deuxième volet de la séparation entre César et Dieu concerne les rapports, dans la sphère publique, entre les activités du culte et les faits et gestes de la vie courante.
Les pharisiens sont préoccupés par l’observance de la totalité des préceptes de la Torah. Ils sont si préoccupés par cet idéal de pureté « qu’ils appliquent la pureté sacerdotale à la vie quotidienne » […]. Il faut savoir que le culte au Temple exigeait des règles de pureté très strictes. […]. Les pharisiens appliquent à la vie quotidienne les mêmes rituels de purification. Par exemple, les purifications exigées avant les repas reprenaient cet esprit. […] Les Évangiles rapportent à cet effet quelques scènes où Jésus ne se lave pas les mains au début du repas. Cela lui vaut d’ailleurs des reproches très sévères. « Pourquoi tes disciples [… ] prennent-ils leur repas avec des mains impures ? » Ces épisodes montrent comment Jésus prend ses distances avec une pratique rituelle très importante. […] L’attitude de Jésus montre […] qu’il sait distinguer entre ce qui est essentiel pour la vie de la communauté et les rituels qui procurent une fausse sécurité […]. Il fallait du cran de la part de Jésus pour prendre des libertés face à des coutumes bien ancrées dans la tradition […]. Nous constatons ici que l’enseignement de Jésus témoigne d’une réelle opposition qui a été vécue dans l’histoire6.
On peut penser aussi aux épisodes où Jésus marque nettement la séparation entre le domaine religieux et l’administration des activités économiques ou financières qui occupent depuis toujours une large part des activités de la vie courante. Ainsi, à un homme qui lui demande de régler un différend entre lui et son frère concernant une dispute d’héritage, situation ô combien réelle et fréquent...
Table des matières
- CP Laicite
- CP Laicite-1
- CP Laicite-2
- CP Laicite-3
- CP Laicite-4
- CP Laicite-5
- CP Laicite-6
- CP Laicite-7
- CP Laicite-8
- CP Laicite-9