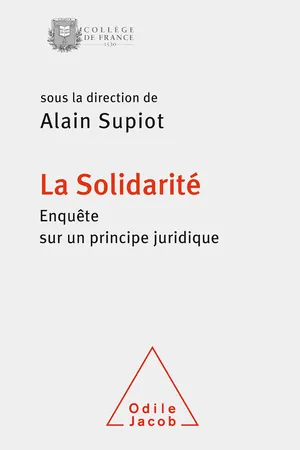
- 368 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
La solidarité n'est ni assurance ni assistance. Elle ne divise pas le monde entre ceux qui donneraient sans recevoir et ceux qui recevraient sans avoir rien à donner : tous contribuent selon leurs capacités et reçoivent selon leurs besoins. Le droit européen a récemment hissé la solidarité au rang de principe fondamental, à l'instar de la liberté, de l'égalité et de la justice. Dans le même temps, l'idéologie libérale en promeut le démantèlement méthodique, considérant qu'une « grande société » fondée sur l'ordre du Marché « n'a que faire de la "solidarité" » (F. Hayek). La question se pose donc de savoir si la solidarité est le témoin provisoire d'un ordre juridique condamné à disparaître ou bien l'un des ferments de sa recomposition. L'enquête conduite dans ce livre vise à y répondre. Elle commence par retracer l'histoire du concept de « solidarité », depuis son apparition en droit romain jusqu'à sa moderne diffusion en biologie, en sociologie et en droit social. Elle se poursuit en examinant cette notion d'origine européenne au prisme d'autres civilisations. Explorant les évolutions politiques et législatives les plus récentes, elle met enfin en évidence l'extrême actualité du principe de solidarité dans toutes les grandes régions du monde. Alain Supiot est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités ». Contributions de Gilbert Achcar, Mohammad Ali Amir-Moezzi, Anne Cheng, Roberto Fragale Filho, Xiang Feng, Jean-Pierre Laborde, Danouta Liberski-Bagnoud, Charles Malamoud, Mohamed Mahmoud Mohamed Salah, Pierre Musso, André Pichot, Michael J. Piore, Alain Rauwel, Jean-Noël Robert, Supriya Routh, Pierre Rodière et Alain Wijffels.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à La Solidarité par Alain Supiot en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Social Sciences et Essays in Sociology. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
TROISIÈME PARTIE
ACTUALITÉ DE LA SOLIDARITÉ
Évolutions récentes de la solidarité aux États-Unis1
par MICHAEL J. PIORE
L’expression de « solidarité sociale » n’est pas couramment employée aux États-Unis, mais il y existe une attention permanente à la cohésion sociale et à ses conditions d’existence. Dans cette mesure, la question de la solidarité fait bien l’objet de débats et de discussions, malgré un vocabulaire légèrement différent. Il semble que l’on puisse repérer deux grandes étapes, singulièrement différentes, dans l’histoire de la solidarité sociale aux États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première période – une ère de solidarité – s’étale sur les trois premières décennies d’après-guerre et s’est caractérisée par une forte redistribution des richesses, ainsi que la continuation par l’État providence des réformes ayant suivi la crise de 1929 et des programmes du New Deal lancé par Franklin D. Roosevelt. Dans les décennies plus récentes, à partir de 1980, la culture américaine s’est montrée plutôt favorable à l’individualisme, lequel représente, à bien des égards, l’antagonisme de la solidarité sociale, dans la pratique et en tant qu’objectif de politique publique. Cette seconde période a été marquée, en termes de redistribution des richesses, par un niveau d’inégalités similaire à celui du début du XXe siècle, ainsi que par un déclin manifeste de la syndicalisation et de la négociation collective, qui a engendré une diminution du nombre d’adhérents aux syndicats et une perte de leur pouvoir. Le pays s’est rallié à une idéologie libérale de marché. Le discours politique, à droite comme à gauche, a clairement pris le marché compétitif comme modèle d’organisation des activités sociales et économiques. Le pays est également intervenu fermement auprès d’agences internationales pour encourager d’autres nations à adopter des politiques publiques favorables au marché ; nous n’avons pas hésité à user de notre considérable pouvoir pour les motiver en ce sens. Dans d’autres secteurs, l’action publique a délaissé la solidarité sociale. Pendant cette seconde période, le système d’immigration, modifié dans les années 1960 pour que soient supprimés ses fondements raciaux, a été un facteur d’accroissement du nombre de travailleurs non déclarés, lesquels sont concrètement exclus de la vie civique. De nombreuses communautés locales contribuent à cette marginalisation en instaurant des législations restrictives et souvent pénales qui complètent les règles fédérales relatives aux droits et devoirs des étrangers vivant aux États-Unis. Les estimations sont variables, mais le nombre de travailleurs sans papiers étrangers aux États-Unis représente entre 5 et 7 % du salariat2. Dans les années 1990, le système d’assistance publique – créé dans les années 1930 au titre des mesures de l’État providence – fut complètement réformé dans le but de supprimer les allocations permanentes aux pauvres et de forcer jusqu’aux parents célibataires de jeunes enfants à travailler.
Les chiffres de la redistribution des revenus sont particulièrement révélateurs. Dans les décennies immédiates de l’après-guerre, les augmentations de revenus furent orientées par les politiques publiques – ainsi, une politique des revenus fut explicitement mise en œuvre pendant pratiquement vingt ans. Les augmentations en pourcentage de revenus redistribués furent relativement uniformes et révélèrent les évolutions de la productivité du travail. Dans les années 1980, les revenus au sommet de la répartition ont commencé à diverger – et ils ont divergé de façon significative et quasiment continue durant les trente années suivantes. Par exemple, le revenu des dirigeants des trois cent cinquante entreprises les plus importantes aux États-Unis, qui dépassait le salaire moyen de 25 % environ en 1980, le dépasse désormais de 231 %3. Les ménages les plus aisés se sont enrichis de 275 % après prélèvements fiscaux et transferts de revenus sur la période 1979-2007, alors que le gain n’a été que de 40 % pour les 60 % constituant la classe moyenne américaine. La situation des foyers les plus pauvres a été marquée par une régression absolue4. Le pourcentage de revenus gagnés par 1 % des familles les plus riches a augmenté, passant de moins de 8 % en 1980 à 14 % en 2010 ; pour les 0,01 % les plus riches, il a augmenté de 2 à 8 %. La part de ce 1 % supérieur est à peu près équivalente à celle qu’on trouvait à la veille de la crise de 19295.
Pour autant, comparée à la situation actuelle, la solidarité apparente dans l’après-Première Guerre mondiale masquait des exclusions sociales considérables. La législation sociale des années 1930 a résulté d’un compromis, au sein du Parti démocrate au pouvoir, entre l’aile urbaine et progressiste du Nord et le Sud rural et conservateur qui contrôlait des comités parlementaires essentiels. Du fait de ce compromis, la plupart des travailleurs noirs furent de facto exclus et les institutions racistes du Sud ne furent pas affectées. La législation portant sur l’immigration était biaisée en faveur de l’Europe et au détriment des populations du reste du monde qui n’étaient pas blanches. La société était dominée par la figure masculine, avec un idéal de la femme au foyer. Bien qu’un nombre croissant de femmes pût accéder à des emplois, ceux-ci restaient fortement limités (secrétaires, infirmières, institutrices, standardistes), avec peu de pouvoir, des salaires plus faibles et un statut social inférieur à celui des hommes. D’autres groupes sociaux – tels que les personnes handicapées, les gays ou les lesbiennes – n’étaient pas reconnus du tout.
Dans la période la plus récente, le pays a activement cherché à inclure ces groupes dans la norme sociale, sur la base de l’égalité. Ainsi, si la répartition des richesses et le statut social sont examinés du point de vue de ces groupes autrefois désavantagés et socialement stigmatisés, une gigantesque révolution sociale a eu lieu, dans le sens d’une société plus ouverte. Cette révolution est du même ordre que celle qui, dans les années 1930, vit apparaître l’État providence et l’organisation syndicale des travailleurs. Interrogées sur leur situation économique et sociale par rapport à celle de leurs parents, les personnes appartenant à ces groupes auparavant exclus témoignent d’un sentiment massif de progrès. La proportion du salaire moyen hebdomadaire des femmes relativement aux hommes est passée de 60 % en 1980 à 80 % en 2009. Les femmes, qui étaient quasiment exclues des emplois prestigieux tels que les professions médicales ou juridiques, ont désormais un accès égal à ces formations professionnelles6. Les populations immigrées, si elles comparent leur situation à celles des personnes restées dans leur pays d’origine, ont bénéficié de progrès similaires. Les équipements publics ont fait l’objet d’investissements majeurs pour permettre un accès aux personnes handicapées. Les gays et les lesbiennes, pratiquement ignorés au lendemain de la guerre, sauf à l’occasion de chasses aux sorcières et de mauvaises blagues, se voient reconnaître le droit au mariage, l’accès au service militaire, ainsi qu’une protection fréquente contre la discrimination dans l’accès à l’emploi. En dépit d’un large débat autour d’une réduction des pensions des personnes âgées, le système fédéral de versement des pensions n’a pas été modifié. Il est biaisé dans le sens d’une surcompensation de l’inflation, de sorte qu’une part croissante du produit intérieur serait versée aux personnes âgées, même si leur proportion au sein de la population était amenée à stagner (mais en réalité, elle augmente). Il est ironique de relever que le seul groupe social qui n’a pas bénéficié de ces effets économiques égalitaires est la population noire, alors que ses combats ont servi de modèle à la mobilisation des autres groupes sociaux. Le revenu moyen des Noirs par rapport aux Blancs a stagné dans les trente dernières années (après une augmentation dans les années 1970). Ce résultat découle d’une divergence qui ne cesse de s’accroître entre la redistribution des richesses pour la moitié supérieure de la population noire – redistribution qui a relativement augmenté pendant la période – et pour sa moitié inférieure, dont les revenus relatifs ont décru. De plus, l’élection d’un président noir a fondamentalement modifié le statut social des Noirs aux États-Unis et a évidemment attisé leur désir de progrès social. Au même moment, et toujours en dépit de l’impression générale de reflux de l’État providence, des avancées significatives ont également eu lieu. La plus importante d’entre elles est la loi surnommée « Obamacare », qui a promis une couverture maladie à une portion substantielle des personnes qui n’étaient pas assurées jusqu’alors, ainsi qu’un crédit d’impôt sur les revenus modestes du travail (earned income tax credit). Tout en éliminant les subventions aux pauvres, le pays a créé un mécanisme de subventions salariales lié au système fiscal, qui semble améliorer la situation des personnes qui travaillent effectivement par rapport à ce qu’elle était avant ces réformes.
Comprendre le paradoxe : le libéralisme
Pour cerner ces évolutions – et résoudre l’apparente contradiction et les tensions internes, au cours des deux périodes, entre solidarité sociale et quête de reconnaissance de la part de certains groupes sociaux –, une clé d’analyse peut se trouver dans l’idéologie individualiste et libérale du pays. Une telle idéologie favorise la logique du marché concurrentiel pour des raisons à la fois politiques et économiques. En termes économiques, le marché est censé être efficient et, à titre secondaire (même si l’argument est moins convaincant sur le plan théorique), facteur de progrès économique. Politiquement, le marché est associé à une décentralisation du pouvoir qui protège les libertés individuelles. M...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Introduction
- Première partie - Histoire de l’idée de solidarité
- Deuxième partie - La solidarité au prisme des civilisations
- Troisième partie - Actualité de la solidarité
- Présentation des auteurs
- Table