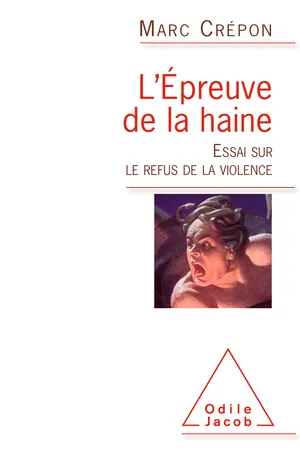
- 272 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
La violence n'a pas subitement surgi dans nos vies avec les attentats de janvier et de novembre 2015. Aucune de nos relations, qu'elles soient familiales, scolaires, professionnelles, morales ou politiques, n'y échappe. Mais la terreur instaurée par les attaques terroristes est une épreuve sans précédent. D'abord parce qu'elle provoque la hantise de la répétition : nous savons qu'à la terrasse d'un café, dans une salle de spectacle ou dans les transports en commun, la violence peut à nouveau frapper. La peur, le désir de vengeance et de justice accompagnent notre volonté d'en finir avec ce que nous considérons comme le mal radical. Comment pourrait-il en aller autrement ? Et qui nous le reprocherait ? Mais le risque est alors d'autoriser les emportements, les jugements précipités, les décisions aveugles et, finalement, de répondre à la violence par la violence. Faire face à la haine est un défi pour nos sociétés. Dans ce livre courageux, à contre-courant de bien des discours actuels, et convoquant toutes les ressources de la philosophie, Marc Crépon défend le principe du refus de la violence, du refus de consentir à son œuvre et à la culture de destruction qui l'accompagne. Les grandes figures de la non-violence que furent Jaurès, Romain Rolland, Martin Luther King et Mandela nous offrent des modèles et prouvent que la terreur n'est ni invincible ni fatale. Normalien, agrégé de philosophie, Marc Crépon est directeur de recherches au CNRS et dirige le département de philosophie de l'École normale supérieure. Il a notamment publié Le Consentement meurtrier.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L' Épreuve de la haine par Marc Crépon en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Philosophie et Histoire et théorie de la philosophie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
SECONDE PARTIE
Vaincre la haine.
Jaurès, Rolland, Gandhi,
King, Mandela
CHAPITRE I
La patrie, une idole meurtrière ?
Nous avons vu dans la première partie de ce livre qu’il était important de se concentrer, de façon critique, sur ces mots qui constituent d’autant plus des catalyseurs de la violence et de la haine que leur pouvoir de fascination est réel. Le premier qui s’impose est difficile à traduire, d’une langue à l’autre, en dépit des apparences, tant ses connotations, surchargées d’histoire, sont chaque fois différentes : patrie, Heimat, Vaterland, homeland, country, rodina, etc. Ces traductions ont pourtant un foyer commun : le sacrifice que partout, au moins depuis deux siècles, on n’a cessé d’exiger pour son salut et sa sauvegarde, comme un devoir sacré. À défaut d’en écrire ici l’histoire, on s’arrêtera sur un moment particulier de son exaltation, pour ne pas dire de son embrasement : la Première Guerre mondiale. Dans les années qui la précèdent, la controverse, politique et philosophique, dont fait l’objet son invocation fait apparaître au grand jour l’inquiétude croissante suscitée par la montée des tensions internationales. Elle divise les esprits, traçant en France une ligne de partage entre ceux qui désirent sinon réclament la guerre pour venger l’affront de la défaite et reprendre aux Allemands l’Alsace et la Lorraine, et ceux qui récusent dans le patriotisme qui en résulte un chauvinisme belliqueux n’exprimant rien de moins que les intérêts d’une classe dominante associant la bourgeoisie à l’armée, accusée d’être exclusivement à son service et à ses ordres. Dès le 1er août 1914, les cartes sont néanmoins rebattues et ceux qui, la veille encore, voyaient dans l’idée de patrie l’un des socles de l’idéologie bourgeoise ne tardent pas à céder à la contagion qui fait de son salut la raison dernière des exigences morales et politiques réunies pour imposer aux citoyens le sacrifice de leur vie comme un devoir sacré. C’est pourquoi les premières voix qui s’élèvent pour dénoncer la guerre, à commencer par celle de Romain Rolland, n’ont pas de souci plus urgent que celui de démythologiser la notion de patrie et de restituer à l’expérience démultipliée de la mort sa vérité propre contre la rhétorique qui la dissimule derrière le masque glorieux d’un sacrifice universellement consenti. Voilà ce qui en fait une notion controversée ! Elle apparaît vitale et sacrée pour les uns, liberticide et mortifère pour les autres.
Il s’ensuit toute une série de questions. Quel sens fallait-il lui donner, à la veille de la guerre, quand certains, comme Jaurès, espéraient jusqu’au dernier moment qu’il serait possible de l’empêcher ? Quelle a été tout au long du siècle, quelle est aujourd’hui encore la part de ses « usages » idéologiques ? Quels calculs se dissimulent derrière son appel ? Peut-on réduire la « patrie » aux intérêts particuliers de ceux qui parlent en son nom ? Nous les poserons, au fil conducteur d’une lecture croisée de trois figures majeures de cette controverse entre 1914 et 1918 : Jaurès, Rolland et Alain, avec le souci de montrer combien les termes mêmes dans lesquels ils les posent n’ont rien perdu de leur pouvoir d’interpellation.
– I –
Le double sens de la patrie
C’est à l’occasion de sa proposition de loi sur l’organisation de l’armée, publiée en annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 1910 et, peu de temps après, sous la forme d’un ouvrage intitulé L’Armée nouvelle que Jaurès expose sa conception de la patrie et sa défense d’un patriotisme modéré, et néanmoins nécessaire, qui ne doive rien aux emportements belliqueux qui secouent alors une partie de la classe politique. Les données de la question sont alors les suivantes. D’un côté, la droite nationaliste n’a que ce mot à la bouche qu’elle décline sous tous les modes ; de l’autre, une partie des socialistes, avec à leur tête Gustave Hervé, font profession d’un antimilitarisme et d’un antipatriotisme systématiques, au prétexte que le prolétariat n’a que faire de la « patrie », aux mains des classes possédantes qui les exploitent, avec l’appui d’une armée, dont la répression du mouvement ouvrier constitue l’une des fonctions privilégiées. Tout le travail de Jaurès est d’échapper à cette alternative, en montrant qu’il ne saurait y avoir de justice sociale et de réforme de la société progressiste, sans que la paix et la sécurité soient assurées et qu’en conséquence le prolétariat ne devrait pas rester étranger au souci de la « défense nationale ». La paix, en d’autres termes, est trop nécessaire à la justice pour que la « défense », la « patrie » et avec elles les questions de politique internationale soient abandonnées aux mains d’une armée de classe ou de caste et à ses illusions chauvines. Ainsi l’engagement des prolétaires sur les questions internationales et militaires est-il nécessaire pour que la guerre, si elle devait avoir lieu, ne soit pas déclarée sans remplir quelques conditions. La première serait qu’elle ne fasse pas l’objet d’un calcul politique aventurier ; la seconde, qu’on se soit assuré au préalable que toutes les chances de préserver la paix ont été épuisées, de telle sorte que la « patrie », qui s’y résoudrait malgré elle, serait couverte, écrit-il, d’un « verdict d’approbation de la conscience universelle20 ».
C’est pourquoi le leader socialiste en appelle à un nouveau patriotisme, qu’on pourrait dire « négatif », bien qu’il n’emploie pas lui-même cette expression, pour rendre compte de la torsion qu’il impose à l’idée de patrie. Il faut noter tout d’abord que, si l’idée reste nécessaire, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’épargner à la nation les « convulsions de la guerre », mais au moins autant l’« humiliation de la servitude ». Voilà l’idée maîtresse de Jaurès, celle qui l’oppose aux antipatriotes et aux antimilitaristes de son temps. Au-delà de la Première Guerre mondiale, elle fait signe, tous pays confondus, vers la résistance des partisans à l’occupant pendant la guerre de 1939-1945, et elle rappelle à l’avance le sens que ceux et celles qui n’accepteront pas de voir leur pays envahi par des troupes étrangères, asservi à la loi de l’ennemi, donneront au « patriotisme ». On aurait tort, autrement dit, de ne voir dans l’attachement à sa « patrie » qu’une construction artificielle, une illusion, l’effet d’une propagande redoutable, au service d’une agressivité chauvine se moquant de la paix ou encore le nœud gordien d’un tissu de mensonges orchestrés par des fauteurs de guerre. Il est vrai sans doute que le concept a pu servir de prétexte pour cimenter la « solidarité de toutes les puissances d’autorité » et qu’au temps de l’affaire Dreyfus, dont le souvenir ne quitte jamais la pensée de Jaurès lorsqu’il s’interroge sur la place de l’armée dans la société, la « défense » et l’« amour » de la patrie, érigés en principe absolu, au détriment de la justice et de la vérité, furent la source intarissable d’un « déluge de mensonges, d’injures et de fanatisme21 ». Pour autant, on ne saurait renvoyer le concept de « patrie » aux oubliettes de l’histoire, pas plus qu’on ne doit l’enterrer avec les cendres du militarisme. Si loin d’être une idée épuisée, il s’agit au contraire, comme il l’écrit, d’une « idée qui se transforme et s’agrandit », c’est, en effet, que, moins que jamais, les prolétaires, dont l’émancipation est en marche, ne sont prêts à « subir passivement » le joug d’une domination extérieure, dont ils savent bien intuitivement que, loin de les libérer, elle ne pourrait signifier pour eux qu’un « accroissement de servitude ».
La vérité est que partout où il y a des patries, c’est-à-dire des groupes historiques ayant conscience de leur continuité et de leur unité, toute atteinte à la liberté et à l’intégralité de ces patries est un attentat contre la civilisation, une rechute en barbarie. Dire que les prolétaires étant serfs du capitalisme, ne peuvent subir par l’invasion, par la conquête, une aggravation de servitude est un enfantillage22.
C’est la raison pour laquelle, continue-t-il, il ne faut pas prendre trop au sérieux la phrase du Manifeste du Parti communiste, selon laquelle « les ouvriers n’ont pas de patrie ». Si Marx a pu formuler un tel énoncé, c’est, en effet, faute d’avoir compris que la patrie ne se réduisait pas nécessairement au partage de la propriété foncière. Si tel était le cas, on aurait pu convenir que son invocation et le souci de la « défendre » se résument dans le soutien de ce partage inégal et de la domination de fait qu’il traduit. Les prolétaires qui auraient souscrit à son « idole » n’auraient jamais été que les dupes du régime d’oppression que cette domination légitime. C’est la théorie que défend à la même époque Gustave Hervé, contre les idées duquel une grande partie de L’Armée nouvelle est dirigée. Mais la patrie, pour Jaurès, n’a pas pour fondement des « catégories économiques exclusives ». « Elle tient par ses racines, écrit-il, au fondement même de la vie humaine23. » De quoi s’agit-il ? De rien de moins que ce qu’on appellerait aujourd’hui, dans des termes plus contemporains, « une individuation psychique et collective ». Sans doute l’appartenance que fonde la « patrie » est-elle transitoire, en aucun cas elle ne saurait constituer le dernier mot des règles de solidarité qui sont appelées à lier les hommes les uns avec les autres. Mais l’internationalisme ne saurait exister non plus sans reconnaître cette forme d’individuation collective intermédiaire que désigne la notion de « patrie » ; ou, plutôt, il ne saurait l’ignorer sous peine d’en abandonner l’usage et l’invocation à la perception régressive, vengeresse et réactive que le nationalisme et le patriotisme le plus virulent se font de sa nécessité. Aussi – et ce n’est pas nier son existence que de l’admettre – faut-il reconnaître que la lutte des classes n’est pas, tant s’en faut, la seule forme de conscience collective, la seule forme de communauté et de partage qui régit la vie des individus ; sauf à se complaire dans la dénégation de la réalité et de l’histoire. Voilà in fine ce qui donne sens à la notion de patrie : elle se concrétise dans cette synthèse passive qui permet à chacun d’être un individu, avec d’autres et en même temps qu’eux, en l’attachant à une langue, à des lieux, à des habitudes communes. Quoi qu’en dise l’idéologie, on ne peut faire comme si cette synthèse et l’attachement qu’elle produit n’existaient pas ; et on ne saurait en minimiser la force. Cela n’a l’air de rien, mais nous sommes en 1910, quatre ans à peine avant que ne s’impose, un peu partout en Europe, l’idée qu’il est juste de « mourir pour sa patrie » – et ce que Jaurès explique à ceux qui ne veulent pas l’entendre et qui s’imaginent encore que des principes abstraits suffiront à l’emporter sur la contagion patriotique, ce n’est au bout du compte rien d’autre que la puissance redoutable et en partie incontrôlable de l’attachement qui rend possible la guerre :
L’âme individuelle soupçonne à peine tout ce qui entre en elle de vie sociale par les oreilles et par les yeux, par les habitudes collectives, par la communauté du langage, du travail et des fêtes, par les tours de pensée et de passion communs à tous les individus d’un même groupe que les influences multiples de la nature et de l’histoire, du climat de la guerre, de la religion, de l’art ont longuement façonné. […] C’est le mystère, c’est le prodige des âmes individuelles qu’elles soient à la fois impénétrables et ouvertes. Tout le groupe historique dont elles font partie, dont elles sont solidaires les affecte sans cesse et les émeut, souvent à leur insu. C’est seulement dans les grandes crises, quand un grand événement remue toute la profondeur et toute l’étendue d’un groupe humain que cette solidarité se révèle pleinement elle-même24.
C’est peu dire que Jaurès n’aura de cesse durant les années qui précèdent le conflit – et jusqu’au 31 juillet 1914 – de faire en sorte que la guerre pressentie ne soit pas ce « grand événement » qui ranime la « solidarité » au fondement de la patrie. Car il ne faut pas s’y tromper. Si l’auteur de L’Armée nouvelle ne parle pas le même langage que Freud qui analysera dès 1915, avec une lucidité sans pareille, le pouvoir de sublimation et d’idéalisation lié à l’appartenance, il ne laisse aucun doute sur le caractère terrifiant des forces qui entrent en jeu dans l’attachement à la patrie. Ce sont, dit-il, « des forces instinctives et par là même immenses à la fois et redoutables », et il n’hésite pas à ajouter, comme un signe prémonitoire de tous les emportements sanglants du XXe siècle, qu’« elles prennent l’être humain par une action insensible de tous les jours », se confondant avec « ses habitudes organiques elles-mêmes, avec la façon de parler, de regarder, de marcher, de sourire, de penser25 ». On ne saurait être plus précis ni décrire avec plus de finesse ce qu’a de menaçant et d’explosif toute forme d’appartenance, aussi nécessaire soit-elle dans ce qui fait par ailleurs sa grandeur. Ce qu’explique Jaurès, avec une lucidité implacable, est dans le fond très simple. Avant même de parler d’internationalisme et de cosmopolitisme, avant même d’idéaliser la communauté internationale, la paix, l’appartenance à un monde commun (la patrie du monde ou le monde comme patrie des travailleurs), il faut savoir d’où l’on part et reconnaître comme une donnée première et incontournable (qui n’est pas seulement une construction politique ni l’effet d’une idéologie quelconque) ce qu’il appelle des « forces grandioses et bonnes, mais aussi pleines de périls et de troubles26 ». Pleines de menaces inavouées, les forces de l’attachement à la « patrie » le sont, parce que, si leur origine dans la synthèse passive de notre individuation collective n’a rien d’arbitraire, il n’en demeure pas moins, comme le montrent toutes les guerres, qu’elles sont infiniment manipulables et susceptibles d’être instrumentalisées au profit d’intérêts particuliers. C’est alors que ces « forces de solidarité » se retournent en puissances réactives et meurtrières. Dès qu’elle se voit instrumentalisée, la « solidarité », sous les atours de la « patrie », devient exclusive. Elle s’apparente, comme Jaurès n’hésite pas à le dire à « un grand égoïsme collectif » – celui-là même qui constitue l’un des moteurs les plus puissants des guerres et que résume, au milieu de tant d’« entraînements aveugles » et de « maximes brutales », cette formule lapidaire, foyer de tous les consentements et de toutes les complaisances envers le crime : « Qu’il ait tort ou raison, c’est mon pays27. »
On conçoit du même coup le pari et la promesse intenables du leader socialiste, dont la guerre signifiera l’échec le plus dramatique : ils tiennent tout entier dans la nécessité que l’attachement de chacun à sa patrie se dépasse dans la reconnaissance d’une commune « patrie humaine », qu’il désigne également sous le nom de « patrie universelle du travail affranchi ». L’amour de la patrie n’a de sens que s’il permet de transcender toute forme d’égoïsme individuel ou collectif, en s’étendant au-delà de ses frontières. Cette idéalisation d’une appartenance sublimée dans une fraternité universelle qui la déborde et la déporte hors d’elle-même est une absolue nécessité. Et il importe de la rappeler comme la condition de toute paix durable. Mais en même temps – et c’est un point capital qui fait toute la singularité et la lucidité de l’auteur de L’Armée nouvelle – ce « haut idéal », les prolétaires, gagnés à la dimension internationale de leur émancipation, ne sauraient le projeter « dans le vide » ni le réaliser ailleurs que dans une « nation autonome ». Parce que le socialisme ne saurait se couper de la vie de ceux dont il entend défendre le droit à une émancipation égale,...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Avant-propos
- PREMIÈRE PARTIE - L’expérience de la violence
- SECONDE PARTIE - Vaincre la haine. Jaurès, Rolland, Gandhi, King, Mandela
- Conclusion - Répondre de la haine et de la violence
- Remerciements
- Table