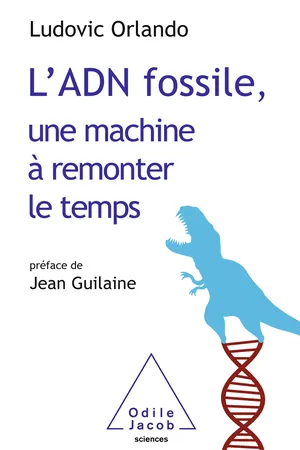
eBook - ePub
L' ADN fossile, une machine à remonter le temps
Les tests ADN en archéologie
- 256 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Cuvier reconstituait un squelette à partir d'une dent. Deux siècles plus tard, sur la base d'un minuscule fragment d'os, et grâce à des méthodes génétiques de pointe, la découverte de l'homme de Denisova bouleverse le lignage humain en lui ajoutant une espèce qui ne survit que par les traces laissées dans notre ADN. La paléontologie et l'archéologie sont devenues moléculaires. Plus fort que Jurassic Park, où le passé revit dans la fiction, avec le séquençage de l'ADN, la paléogénétique s'est inventé une vraie machine à remonter le temps, inaugurant un extraordinaire voyage scientifique. Ludovic Orlando en est un pionnier. Son livre montre comment la génomique, grâce aux progrès fulgurants de la génétique, jette un éclairage inédit sur l'évolution de l'homme — ses migrations, ses sociétés et même ses langues —, mais aussi sur les grandes épidémies du passé, l'évolution du cheval et sa domestication, la naissance de l'agriculture, etc. C'est passionnant comme un roman policier : on résout des énigmes, de l'origine de la tortilla au mystère de l'extinction du mammouth et de l'ours des cavernes. C'est politique, aussi : déconvenue des suprémacistes blancs apprenant que l'homme de Cheddar, ancêtre emblématique des Britanniques, avait la peau noire ; usage biaisé de données génétiques contre les Palestiniens ; révélations sur un guerrier viking qui se révèle avoir été… une femme. Avec la paléogénomique, science d'avenir révélant un passé qui a des enjeux pour le présent, Ludovic Orlando nous entraîne dans une aventure scientifique éblouissante, aux confins du monde et dans la profondeur des temps. Ludovic Orlando est docteur en paléogénétique, directeur de recherche au CNRS, et dirige le centre d'anthropologie et de génomique de Toulouse à l'université Paul-Sabatier. Il est l'auteur du séquençage du plus ancien génome connu à ce jour, a été le premier à caractériser un épigénome ancien et à reconstituer l'histoire génomique de la domestication du cheval. Jean Guilaine est professeur émérite au Collège de France, spécialiste du Néolithique.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L' ADN fossile, une machine à remonter le temps par Ludovic Orlando en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences physiques et Géologie et sciences de la Terre. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
De simples molécules au premier génome ancien
Du séquençage du génome humain à une société génomique
Le génome humain a été déchiffré pour la première fois à l’aube des années 2000, en 2001 pour être précis. L’entreprise venait couronner plus de quinze années de recherches de centaines de chercheurs de par le monde, aussi bien dans le domaine académique que dans le domaine privé. C’est d’ailleurs Francis Collins, directeur du National Institutes of Health, l’équivalent américain de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France – l’Inserm –, et Craig Venter, alors président de Celera Genomics, une société vouée au décryptage de l’information génétique portée par les organismes vivants, qui figuraient aux côtés de Bill Clinton pour célébrer à grand renfort de presse ce qui apparaissait alors comme « la plus fabuleuse carte jamais produite par l’humanité ». Et pour cause : nous connaissions désormais l’information génétique portée par chacune de nos vingt-trois paires de chromosomes. Soit une phrase qui, de bout en bout, s’étend sur près de 3 milliards de C, A, G et T, ces quatre lettres qui constituent notre alphabet génétique et portent tout autant le message encodé dans nos 22 000 gènes que ces vastes étendues qui les séparent, et parfois participent à leur expression, mais parfois aussi passent pour n’avoir aucune fonction claire. Le projet apparaissait pharamineux à ses débuts, à la fin des années 1980, mais, au prix d’efforts colossaux et d’un budget global estimé aux alentours des 3 milliards de dollars, l’humanité s’était dotée d’une information cruciale qui bientôt nous ferait progresser dans la compréhension des mécanismes du vivant, leurs dérèglements et ainsi nous aiderait à fourbir de nouvelles armes dans notre lutte contre les maladies.
Vingt années plus tard, nous sommes en mesure d’apprécier à quel point tout cela n’était en fait que le début d’une plus vaste entreprise car ce sont les génomes de plusieurs millions d’entre nous qui ont aujourd’hui été entièrement séquencés. Il est d’ailleurs aujourd’hui fréquent que nous fassions analyser nos génomes dans l’espoir pour certains de remonter aux origines de leurs ancêtres ou pour d’autres d’évaluer les risques qu’ils encourent de développer telle ou telle autre maladie. Ou lorsque nous espérons retrouver nos parents quand nous sommes nés sous X, ou que nous tentons de remonter la piste de tel ou tel autre criminel lorsque nous sommes en charge d’une enquête. Si autant d’applications sont désormais entrées au cœur de nos vies, c’est que la technologie d’hier a su faire peau neuve et que des techniques véritablement révolutionnaires – et dites de nouvelle génération – ont vu le jour. Notre capacité à séquencer l’ADN n’a en fait jamais été aussi grande, et avec des coûts déjà inférieurs à 1 000 dollars par individu nous voyons désormais poindre dans les pays occidentaux une société où nous serons tous bientôt séquencés, et où une médecine de précision pourra ajuster ses traitements en fonction du patrimoine génétique de ses patients.
Séquencer nos ancêtres et les espèces disparues
Ce que l’histoire ne dit pas, c’est qu’avec les technologies de séquençage de nouvelle génération une autre révolution a également vu le jour : celle qui permet d’accéder à l’information génétique d’individus disparus depuis de nombreuses générations, et même à celle d’espèces éteintes, bref, de voyager dans le temps ! Sous ses airs apparents de science-fiction, l’histoire est pourtant bien réelle. En fait, le premier génome d’un individu ancien a été séquencé dès le mois de février 2010. Il s’agissait d’un homme qui mourut sur la côte ouest de la pointe du Groenland il y a environ 4 000 ans. Quelques mois plus tard à peine, en mai, c’était au tour de l’homme de Neandertal d’être séquencé, celui-là même qui jadis peuplait un territoire s’étendant depuis l’Europe occidentale jusqu’aux confins de la Sibérie du Sud, mais qui disparut voilà près de 40 000 ans. Cette même année encore, on découvrit dans la grotte de Denisova – une grotte de l’Altaï sibérien – un minuscule fragment osseux. Ce n’était qu’une tête d’épingle pour ainsi dire, mais elle contenait suffisamment d’ADN pour dévoiler les traces génétiques d’une humanité disparue : les denisoviens. Différente de la nôtre et cousine lointaine de Neandertal, elle était jusque-là passée entre les mailles du filet et restait inconnue des anthropologues.
Depuis ces travaux pionniers, ce sont plusieurs milliers d’hommes et de femmes du passé dont le génome a pu, au moins en partie, être décrypté par ces archéologues d’un nouveau genre, que l’on appelle volontiers des archéologues moléculaires ou des paléogénéticiens. Et l’aventure ne se limite pas à notre seule espèce ou à nos ancêtres plus ou moins proches : elle s’étend à toutes les branches du vivant, depuis les espèces les plus emblématiques de la préhistoire, comme le mythique mammouth à poil laineux, jusqu’à celles que nous avons éradiquées de la planète à force de chasse inconsidérée, comme le pigeon migrateur, ou celles encore, microscopiques, qui ont déclenché les épidémies parmi les plus meurtrières de notre histoire, avec en tête de file la bactérie responsable de la peste noire, Yersinia pestis. En réalité, les technologies de séquençage de dernière génération nous ont offert une nouvelle manière de retracer l’évolution des espèces et de remonter le fil de leur histoire, pour y faire bien souvent des découvertes inattendues et ainsi révolutionner notre connaissance du passé.
L’ADN fossile ou ADN ancien
Qu’il arrive que l’ADN soit préservé dans les vestiges anciens n’est pas un fait nouveau. Le premier voyage génétique dans le temps avait eu lieu dès 1984, lorsque des chercheurs américains réussirent à décrypter une partie de l’ADN d’une espèce de zèbre disparue – le zèbre couagga, dont le dernier spécimen s’était éteint au zoo d’Amsterdam en 1883. Il est vrai que l’information obtenue alors était somme toute limitée, puisqu’il n’avait été possible de lire qu’à peine 229 lettres de l’ADN de l’animal, soit même pas un millionième de son génome. Pas grand-chose, une poussière en somme, l’équivalent en fait d’à peine 400 mètres par rapport à la distance nous séparant de la Lune. Mais le tour de force n’en était pas moins prodigieux : les chercheurs venaient d’isoler des molécules d’ADN à partir de tissus qui avaient été taxidermisés il y a près d’un siècle ! Très vite, d’autres allaient s’essayer à l’exercice et viser des époques toujours plus reculées : qui des momies égyptiennes vieilles de plusieurs milliers d’années, qui des squelettes de tigres à dents de sabre vieux de plus de 10 000 ans, qui des insectes englués dans l’ambre depuis près de 20 millions d’années et qui bientôt des dinosaures, dont l’âge dépasse les 65 millions d’années !
Mais il fallut vite déchanter car l’ADN des dinosaures et autres créatures antédiluviennes s’avéra d’une tout autre origine que celle qui était espérée. Il s’agissait en fait de fragments d’ADN d’organismes bien vivants qui avaient contaminé les expériences mais qu’on n’avait pas su débusquer à temps. Ils provenaient tantôt d’espèces microscopiques, tantôt des manipulateurs eux-mêmes. Le coup fut dur, mais pas fatal car il restait que l’ADN du zèbre couagga ainsi que celui du mammouth à poil laineux, de l’ours des cavernes et d’autres icônes du bestiaire paléolithique étaient eux bien réels. Certes, ces derniers étaient beaucoup plus jeunes que les lointains dinosaures, mais ils dataient tout de même de plusieurs dizaines de milliers d’années. L’espoir d’importantes découvertes restait donc entier. À l’euphorie initiale et à la course à l’ADN le plus vieux allait donc succéder une période plus rigoureuse où les paléogénéticiens apprendraient à faire leurs gammes. En particulier, à mettre en place des infrastructures de laboratoire leur permettant d’éviter les contaminations expérimentales, à recopier les rares traces d’ADN préservées dans les vestiges en un nombre de molécules suffisamment grand pour en faciliter l’analyse, et à ne pas introduire dans l’information génétique du passé des erreurs techniques liées au processus de copie et aux limites des techniques de séquençage disponibles alors.
De l’étudiant en biologie à l’archéologue moléculaire
C’est à cette époque, à la fin des années 1990, que j’entendis parler d’ADN ancien pour la première fois. Au travers d’un de ses articles, Tomas Lindahl, prix Nobel de chimie, bien connu pour ses travaux sur la dégradation et la réparation de l’ADN, m’apprenait qu’on venait de séquencer des fragments d’ADN de néandertalien. Je l’ignorais. L’article de Lindahl avait tout pour séduire le jeune étudiant en biologie moléculaire à l’École normale supérieure de Lyon que j’étais alors. Il avait sa dose de termes savants décrivant l’ensemble des modifications qu’accumule l’ADN après la mort, faute de bénéficier de cellules vivantes pouvant les réparer. L’auteur y cultivait aussi son goût pour la mise en scène quand il indiquait que des années de négociation avaient été nécessaires avant d’obtenir l’autorisation d’échantillonner un fragment d’os néandertalien et de le détruire en vue de son analyse génétique. Mais surtout il m’apprenait que la science avait désormais dans son attirail technologique de quoi manipuler les rares molécules d’ADN qui survivent parfois dans les fossiles. Pour tout dire, c’était presque trop beau pour être vrai. Tous les ingrédients étaient réunis pour que j’attrape le virus : le voyage dans le temps, des espèces disparues et une bonne dose de technologie. Impossible de résister. Je serais donc paléogénéticien.
La réalité du métier devait vite se révéler beaucoup plus terre à terre car ce que j’avais oublié dans le discours de Lindahl, c’est que, dans la grande majorité des cas, les analyses génétiques nous laisseraient bredouilles, faute d’ADN encore préservé. Il faudrait donc répéter les tentatives un nombre incalculable de fois avant d’espérer pouvoir obtenir des résultats fiables et décrypter des bribes de l’information génétique d’espèces éteintes. Me voici donc, trois années de thèse plus tard, avec près de 300 fossiles réduits en poudre, plus de 800 tentatives d’amplification de courts fragments d’ADN et plusieurs milliers de réactions de séquençage à mon actif, au bord de l’épuisement, mais très fier d’avoir pu enrichir notre connaissance de quelque 60 000 lettres de l’information génétique portée jadis par des ours des cavernes, des rhinocéros à poil laineux et autres chevaux natifs des Amériques.
À bien y regarder, ce n’était finalement pas grand-chose, c’était même dérisoire. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’un laboratoire d’ADN ancien puisse générer en une année des centaines de milliards de séquences anciennes et reconstruire avec elles les génomes de centaines d’individus anciens. En 2019, par exemple, mon laboratoire a généré un volume de séquences équivalant à près de 30 millions de fois le contenu génétique déchiffré dans ma thèse ! Si le chiffre en dit peut-être long sur mes propres capacités expérimentales, il témoigne surtout de l’étendue du changement technologique qui s’est opéré en deux décennies. Car Lindahl lui-même, dans son article de 1997, ne se référait encore à rien de plus que les 378 lettres de l’ADN néandertalien que le groupe de Svante Pääbo venait alors de séquencer. Ce même groupe dut attendre 2010 et les technologies de nouvelle génération pour venir à bout des quelque 3 milliards de lettres restantes.
Une technologie révolutionnaire
Voyons donc ce qui a changé depuis. Au milieu des années 2000, le monde des technologies de séquençage de l’ADN allait connaître une profonde révolution avec l’essor de tout nouveaux instruments. Bien qu’ils exploitassent des approches différentes, ces derniers avaient pour point commun de pouvoir générer de très nombreuses réactions de séquençage en parallèle en des temps records et d’être limités quant à la taille des séquences obtenues – quelques dizaines de lettres consécutives, tout au plus une centaine. Certes, cela représenterait une vraie limite pour ceux qui sont habitués à manipuler des longues molécules d’ADN frais. Mais, pour ceux qui manipulaient de l’ADN ancien, qui subsiste au mieux à l’état de modestes fragments, la technologie semblait taillée sur mesure.
À en croire les spécificités de ces nouveaux instruments, nous pourrions donc obtenir des séquences néandertaliennes par millions en à peine quelques jours, là où les techniques en vigueur peinaient à en produire quelques dizaines dans le même intervalle. Et là où ces mêmes technologies nécessitaient que chacun des fragments d’ADN soit amplifié un à un, entraînant irrémédiablement l’épuisement des extraits avant même que des portions significatives des génomes anciens ne puissent être recouvrées, la nouvelle génération réussissait le pari de les amplifier toutes ensemble, en une seule et même réaction. Son principe était en effet révolutionnaire : il consistait à opérer par la construction de ce qu’on appelle une banque d’ADN, qui incorpore toutes les molécules présentes en son sein, et peut être amplifiée ad libitum pour fournir autant de matière de séquençage que nécessaire. L’astuce : on colle aux extrémités de chacune des molécules une paire de fragments d’ADN synthétiques de séquence connue, qui permettra d’amorcer le travail de recopiage nécessaire à l’amplification. Sans cela, il faudrait invoquer des paires d’amorces différentes pour amplifier chaque molécule une à une. Ainsi, construire l’une de ces banques revient à pouvoir recopier chaque élément de son contenu à volonté, en une seule réaction, et ainsi à immortaliser la ressource qui par conséquent ne s’épuiserait quasiment plus jamais, ou lorsque l’effort de séquençage consenti aura été suffisant pour en séquencer tout le contenu. Un principe non seulement astucieux mais aussi très approprié, lorsqu’il s’agit d’individus disparus ou d’espèces éteintes que l’on ne peut plus échantillonner à l’envi.
Séquencer le génome du mammouth et de Neandertal
C’est sur le mammouth à poil laineux que cette technologie a été déployée pour la première fois, à partir d’ossements restés piégés dans le pergélisol sibérien pendant des dizaines de milliers d’années. Et le résultat serait à la hauteur des espérances : sur un peu moins de 30 millions de séquences, près de la moitié ressemblaient suffisamment au génome de l’éléphant d’Afrique, une espèce relativement proche, qu’il était possible de les y repositionner avec exactitude. Près de 13 millions des lettres qui constituaient l’information génétique d’une espèce dont l’extinction remonte grosso modo à la construction des premières pyramides d’Égypte venaient ainsi d’être décryptées. Certes, le chemin serait encore long pour combler les quelques milliards restants mais une seule expérience avait suffi à générer plus de séquences anciennes que l’histoire entière de la discipline. Un nouveau champ venait donc de naître, celui de la paléogénomique, la science des génomes anciens.
Très vite, l’expérience fut répétée sur des vestiges osseux néandertaliens dans l’espoir de rééditer cet exploit. Cependant, ces entreprises allaient connaître un succès, disons, plus mitigé. L’écrasante majorité des séquences obtenues ne ressemblait à rien de connu ou, alors, à des microbes présents dans le sol. En fait, seuls quelques pour cent des séquences trouvaient une correspondance dans notre propre génome, pourtant plus proche parent des néandertaliens. Avec de tels nombres, ce n’était guère plus qu’un million de lettres de l’information génétique néandertalienne qui venaient d’être découvertes. Il en faudrait trois mille fois plus pour la décrypter dans sa totalité. L’étude touchait là du doigt une des limites fondamentales de l’analyse génétique des vestiges archéologiques : ils regorgent très souvent de l’ADN de bien d’autres espèces que celle que l’on souhaite étudier, en particulier ces myriades de microbes qui vivent dans le sol et réussissent à se frayer un chemin au sein même des fossiles. De fait, l’expérience initiale sur le mammouth avait eu bien de la chance car la fraction microbienne n’était pas encore devenue la fraction majoritaire. Mais, pour les ossements néandertaliens, la situation était tout autre : l’essentiel des molécules incorporées dans les banques d’ADN provenait du sol et était d’origine microbienne. Séquencer le contenu de la banque au hasard, en aveugle et sans tri, conduirait à caractériser le génome de ces microbes bien avant celui des néandertaliens.
D’autant que l’étude révélait une seconde difficulté, peut-être encore plus problématique : les vestiges néandertaliens contenaient une seconde source de contamination, non pas microbienne mais bien humaine cette fois, probablement introduite par les différentes générations d’archéologues, d’anthropologues et autres scientifiques qui ont découvert, manipulé et étudié ces vestiges. Cela ne faisait pas l’ombre d’un doute. Pour s’en rendre compte, il suffisait de regarder certaines portions de notre ADN à la loupe. Celles où nous portons quasiment tous (mais pas tous) la même lettre, et où le chimpanzé et les autres grands singes portent une lettre différente. En de tels endroits du génome, un changement génétique, autrement dit une mutation, apparut très tôt dans notre histoire évolutive et fut transmis à la plupart d’entre nous. Une contamination d’origine moderne aura donc de grandes chances de porter cette lettre tandis que les néandertaliens, membres d’une lignée parallèle à la nôtre, ne la porteront quant à eux vraisemblablement pas. La proportion des deux types de lettres retrouvées dans les séquences générées à partir d’un vestige néandertalien peut donc donner une idée de la contamination d’origine moderne présente dans un échantillon. Eh bien, selon les échantillons considérés, le chiffre pouvait flirter avec les 100 % ! La balance se révélerait en fait favorable pour seulement deux des six échantillons initialement étudiés, l’un de la grotte de Vindija en Croatie...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Préface
- Chapitre 1 - De simples molécules au premier génome ancien
- Chapitre 2 - Sur les pas de nos ancêtres
- Chapitre 3 - La part de Neandertal en nous
- Chapitre 4 - L'humanité de Denisova enfin dévoilée
- Chapitre 5 - Repousser la barrière du temps
- Chapitre 6 - Sur les traces des grandes épidémies de l'histoire
- Chapitre 7 - Nous et nos écosystèmes microbiens anciens
- Chapitre 8 - Au-delà de nos gènes, notre profil épigénétique
- Chapitre 9 - Au-delà de nous, nos animaux domestiques
- Chapitre 10 - Au-delà de nous, nos plantes domestiques
- Chapitre 11 - Comprendre et tirer les leçons des extinctions passées
- Chapitre 12 - La mémoire des environnements passés
- Chapitre 13 - Quand le passé rencontre le temps présent
- Chapitre 14 - Quand les cultures rencontrent les molécules : quelle archéologie aujourd'hui ?
- Bibliographie
- Pour en savoir plus
- Table