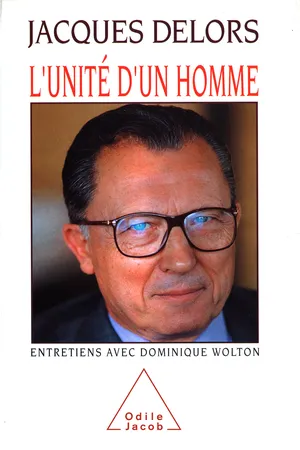
eBook - ePub
L' Unité d'un homme
Entretiens avec Dominique Wolton
- 398 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
L' Unité d'un homme
Entretiens avec Dominique Wolton
À propos de ce livre
« J'espère qu'à travers un parcours jalonné tantôt par une action modeste et militante, tantôt par une participation importante aux événements, le lecteur bénéficiera d'un supplément de clarté sur notre histoire commune. Il verra, tout au moins je l'espère, que certaines des innovations que j'ai proposées sont toujours d'une brûlante actualité et, pour certaines, porteuses d'avenir. » (J. D.)
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L' Unité d'un homme par Jacques Delors,Dominique Wolton,Dominique Wolton en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politics & International Relations et Political Biographies. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
QUATRIÈME PARTIE
L’ambition européenne
CHAPITRE 1
La relance de la construction européenne (1985-1989)
Objectif 1992
DOMINIQUE WOLTON : Jacques Delors, dans votre direction à la tête de la Commission européenne, quatre grandes actions peuvent être distinguées : la mise en place de l’Acte unique en juin 1985 ; le renforcement de l’Union économique et monétaire, en juin 1988 ; le lancement de l’Union politique, à partir d’avril 1990, qui aboutira au traité de Maastricht et le Livre blanc, accepté en décembre 1993. S’y ajoutent un certain nombre d’initiatives concernant l’Europe sociale.
Pouvez-vous rappeler ce qui différencie ces quatre étapes qui ont marqué votre intervention, votre action, votre responsabilité à la tête de la Commission ?
JACQUES DELORS : Lorsque je suis arrivé, fin 1984, j’étais assez familier des mécanismes de la construction européenne, puisque j’y avais été associé depuis longtemps. D’abord en tant que syndicaliste, ensuite comme haut fonctionnaire, dans les années soixante, par ma présence au cabinet du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, puis dans les années soixante-dix, comme expert. Enfin, j’ai été membre du premier Parlement européen élu au suffrage universel en 1979 et élu, à ce titre, président de la Commission économique et monétaire. L’Europe m’était familière. La base de ma réflexion et de mon action était simple. La construction européenne n’a jamais été, ne sera jamais un long fleuve tranquille. En 1984, celle-ci avait à peine trente ans d’âge et, durant ces vingt-sept années, avaient alterné des périodes de dynamisme, la plus notable étant celle qui va du traité de Rome à 1963, des périodes de crise, dont les deux plus célèbres sont celles provoquées par le général de Gaulle avec la chaise vide, pour des raisons institutionnelles, et l’autre, initiée par Margaret Thatcher, portait sur la contribution financière de la Grande-Bretagne. Durant ces vingt-sept ans, il y avait aussi eu des phases de stagnation.
Nous étions dans l’une de ces phases, mais j’arrivais avec un atout : au Conseil européen de Fontainebleau, François Mitterrand, qui à l’époque assurait la présidence, avait réussi à régler les contentieux qui s’étaient accumulés depuis le « I want my money back » de Margaret Thatcher. Plus d’une dizaine de problèmes restaient en suspens et le président de la République, par un engagement personnel et des contacts bilatéraux, avait dégrippé la situation. La question posée était donc celle d’une relance, mais comment ? À ce moment-là, j’avais en tête les objectifs que l’on retrouvera ensuite et qui pouvaient fournir matière à un redémarrage : une défense commune, sujet aujourd’hui d’actualité après le défilé de l’Eurocorps le 14 juillet 1994 ; l’union monétaire, la monnaie unique qui n’était pas une nouveauté puisque, en 1970, il y avait eu le rapport du Premier ministre luxembourgeois, M. Werner, qui traçait les lignes d’un projet devant aboutir à une monnaie unique. Ce beau projet allait être mis en pièces par le détachement du dollar par rapport à l’or et la première hausse spectaculaire des prix du pétrole ; la réforme institutionnelle afin de rendre la Communauté à la fois plus efficace et plus démocratique. Ces trois objectifs, je les ai « testés » au second semestre 1984, après ma nomination, auprès des neuf chefs de gouvernement, puisque à l’époque nous étions dix.
DW : Lequel de ces trois objectifs avait le plus de chances d’être accepté ?
JD : Aucun de ces projets ne recueillait l’unanimité. Par conséquent, j’ai dû me rabattre sur un objectif plus pragmatique correspondant aussi à l’air du temps, puisque à l’époque il n’était question que de dérégulation, de suppression de tous les obstacles à la compétition et au jeu du marché.
DW : Cela n’a pas beaucoup changé depuis...
JD : Si, un peu, on le verra par la suite. Je leur ai dit : « Le traité de Rome prévoyait la création d’un Marché commun. Et si enfin on le faisait ? » Compte tenu de l’air du temps, cette proposition a recueilli l’accord unanime des dix États membres de la Communauté.
DW : Cela alliait l’idée de la dérégulation et celle des pères fondateurs.
JD : Oui. C’était dans le traité. Nos dirigeants avaient vis-à-vis de l’objectif des pères fondateurs une forme d’obligation et, d’autre part, chacun sentait que nos économies étaient engourdies, fractionnées, accablées de réglementations et d’obstacles aux échanges. Je suis donc parti de cet objectif. Bien sûr, à l’époque, ceux que j’appellerais, sans connotation péjorative, les « fédéralistes » ont trouvé que j’étais plus pragmatique que visionnaire, mais j’avais là un moyen de remettre la mécanique en marche à condition de fixer une date limite.
DW : Quand vous arrivez en janvier 1985, quelle est votre plus grande surprise ?
JD : Aucune. Ayant participé à la vie communautaire comme haut fonctionnaire ou comme expert, je connaissais la maison et beaucoup de ses responsables personnellement. Dans ces conditions, je n’avais pas le sentiment d’être étranger à l’ambiance de la Commission.
DW : Même dans les trois ou quatre premiers mois ? Dans quel état était la Commission quand vous êtes arrivé ?
JD : Il y a toujours un exercice difficile qui est la répartition des portefeuilles, puisque je rappelle que le président de la Commission n’est que le primus inter pares. Dans un État national, le Premier ministre choisit ses ministres en fonction de sa conception du gouvernement et des qualités des uns et des autres. En ce qui me concerne, je devais composer avec chacun, et je me rappelais que mes prédécesseurs avaient eu à affronter ce qu’on appelait la « nuit des longs couteaux », longue tradition de la maison, au cours de laquelle il fallait, la lassitude aidant, d’innombrables heures de discussion pour aboutir à un résultat. Durant cette nuit, les chefs de gouvernement téléphonaient au président de la Commission pour insister pour que soit attribué tel ou tel portefeuille à l’un de leurs nationaux. J’ai donc voulu éviter cela. J’avais vu chaque commissaire en tête à tête et nous avons réparti les portefeuilles de manière paisible, à la satisfaction de tous. À l’époque, les membres de la Commission arrivaient là avec le même sentiment que moi : la construction européenne est sortie de sa crise, mais elle n’avance pas. Par conséquent, au fur et à mesure que l’on allait faire des progrès, la cohésion de la Commission allait s’accroître. C’est l’ambiance de la première Commission que j’ai eu à présider de 1985 à 1988.
DW : Quand vous avez fait le tour des dix chefs d’État et de gouvernement entre juillet 1984 et janvier 1985, ceux-ci ressentaient-ils la nécessité de relancer la construction européenne ? Y avait-il un sentiment d’urgence ?
JD : Oui, ils voulaient avancer. Ils cherchaient une idée, une voie, une stratégie. Par conséquent, c’était à moi de leur proposer.
DW : Ce sera l’objectif 1992, c’est-à-dire la mise sur pied de l’Acte unique. Comme vous l’avez dit, vous optez pour l’objectif initial du Marché commun, suscitant ainsi l’adhésion des chefs de gouvernement, et vous allez mettre en œuvre votre méthode « un homme, un calendrier, un objectif, un mécanisme ». Finalement, entre le sommet de Milan, en juin 1985, et le sommet de Luxembourg, en décembre 1985, on arrive au Livre blanc.
JD : J’annonce l’objectif 1992, c’est-à-dire le Marché unique, avec bien d’autres propositions, lors du débat d’investiture en janvier et ensuite je charge un de mes collègues, lord Cockfield, de rédiger le Livre blanc, c’est-à-dire le cahier des charges pour réaliser le grand Marché sans frontières.
DW : L’adoption aura lieu en décembre 1985. Pourquoi lord Cockfield n’est-il pas tellement reconnu ? Pourquoi a-t-il, pour le moment, disparu de la mémoire ?
JD : Cet homme formidable, d’une très grande culture et d’une expérience professionnelle remarquable, est en même temps un homme discret, entièrement au service de sa tâche. Une fois le Livre blanc adopté, il restait un problème : construire la législation nécessaire pour permettre la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, et pour supprimer tous les obstacles aux échanges. Il y avait l’obstacle du vote à l’unanimité par le Conseil des ministres, qui a souvent bloqué des projets, comme j’en ai fait moi-même l’expérience, avec, par exemple, le projet refusé pour la création d’une société de droit européen. Dès les premiers mois, j’ai donc sensibilisé les gouvernements à l’idée qu’ils devraient se mettre d’accord, au moins pour s’abstenir, chaque fois qu’un texte serait voté. Cela pouvait être fait par convention, sans modifier le traité, même si ma préférence était pour une modification du traité.
Au total, je voulais faire reposer la construction européenne sur trois piliers : la compétition qui stimule ; la coopération qui renforce ; la solidarité qui unit. Parallèlement, je jouais à l’honnête courtier pour faciliter la bonne fin des négociations de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal. Dans ce sens, j’ai testé l’idée de solidarité, en proposant des programmes intégrés méditerranéens, pour calmer les appréhensions des régions du Sud qui craignaient la déstabilisation de leurs économies par l’entrée de l’Espagne et du Portugal.
DW : Comment se sont passés les deux conseils de Milan et de Luxembourg, qui ont joué un rôle essentiel dans la relance européenne ? Comment vous y êtes-vous pris pour passer outre la semi-objection britannique et les hésitations italiennes ? Rétrospectivement, l’impression est que ce fut simple, mais il suffit de se souvenir des différentes crises européennes intervenues depuis pour se rendre compte combien il est difficile d’avancer d’un pas. Comment avez-vous fait ?
JD : Quand je suis arrivé à Milan, j’avais dans mon dossier une formule permettant d’obtenir des décisions sans modifier le traité. Mais quelle ne fut pas ma surprise de constater que les Allemands et les Français avaient élaboré un texte ambitieux, qui intégrait le marché intérieur et qui voulait aller vers une Europe politique. Ce texte ne m’avait pas été soumis auparavant. Je l’ai étudié et me suis aperçu que c’était un plan Fouchet numéro trois. Cette formule peut paraître obscure au lecteur, mais il suffit de rappeler que, dans les années soixante, lorsque le général de Gaulle était opposé aux visées supranationales du Benelux et de l’Allemagne, on avait chargé M. Fouchet d’élaborer un schéma institutionnel qui satisfasse le général de Gaulle. La première version n’a pas été acceptée par nos partenaires et la seconde, de guerre lasse, a fini par obtenir leur accord. Au dernier moment, le général de Gaulle a renforcé ce projet dans le sens intergouvernemental, et ce fut l’échec. Or le texte préparé par les collaborateurs du chancelier Kohl et de François Mitterrand ressemblait à la philosophie du plan Fouchet. Je l’ai expliqué aux intéressés, ils n’ont pas insisté.
À partir de là, nous avons commencé à examiner les propositions de la Commission, notamment celles sur le Livre bl...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Des mêmes auteurs
- Copyright
- Avant-propos
- Introduction
- Première partie - L’engagement social
- Deuxième partie - La société
- Troisième partie - La démocratie et la responsabilité
- Quatrième partie - L’ambition européenne
- Cinquième partie - La permanence des valeurs
- L’unité d’un homme
- Chronologie européenne
- Table