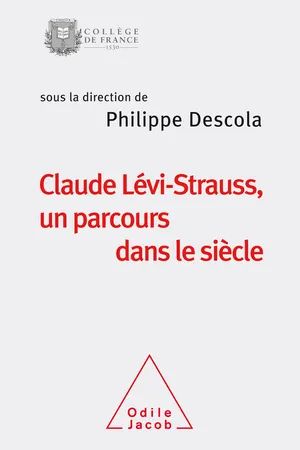
- 304 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Claude Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle
À propos de ce livre
Ce livre réunit les contributions au colloque organisé au Collège de France en novembre 2008 à l'occasion du centenaire de Claude Lévi-Strauss (1908-2009). Au cours de cette longue vie, ponctuée par une trentaine de livres et plus de quatre cents articles, Claude Lévi-Strauss a refondé l'anthropologie en France. Nous commençons à peine aujourd'hui à mettre en valeur ses réflexions sur la nature de la vie sociale, sur le destin des peuples, sur le procès de connaissance ou sur l'émotion esthétique, dont quelques philosophes se sont emparés afin d'en examiner les conséquences dans l'ordre d'un remaniement des concepts dont nous nous servons pour comprendre le monde et sa chatoyante diversité. Ce centième anniversaire de Claude Lévi-Strauss offrait l'occasion de revenir sur le parcours intellectuel d'un auteur devenu un classique et dont les contributions, pour attachées qu'elles soient à une austérité scientifique sans concession, ont néanmoins su séduire un vaste public. Philippe Descola est professeur au Collège de France (chaire d'Anthropologie de la nature), directeur d'études à l'EHESS, et il dirige le Laboratoire d'anthropologie sociale. Il est notamment l'auteur des Lances du crépuscule (1993) et de Par-delà nature et culture (2005). Contributions de M. Bloch, M. Carneiro da Cunha, D. Fabre,R. Hamayon, F. Héritier, L. de Heusch, C. Imbert, P. Maranda, M. Mauzé, M. Sahlins, C. Severi.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Claude Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle par Philippe Descola en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Tecnologia e ingegneria et Biografie in ambito scientifico e tecnologico. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
ISBN de l'eBook
9782738180315IV
Superstructures
et infrastructures
et infrastructures
Anthropologie de l’art abstrait
Enjeux de l’image dans la pensée
de Claude Lévi-Strauss
Enjeux de l’image dans la pensée
de Claude Lévi-Strauss
par Carlo Severi
« L’œuvre d’art est en elle-même un acte de connaissance et de jugement. Il faut donc transférer le concept de connaissance esthétique de la théorie à l’œuvre. »
Carl EINSTEIN,
Totalität, I, 1914.
On ne trouve pas, dans l’œuvre de Claude Lévi-Strauss, d’« anthropologie de l’art », au sens que nous donnons à ce terme aujourd’hui. L’étude des images, toujours menée à partir des œuvres elles-mêmes, jamais à partir de théories esthétiques, ne constitue nullement pour lui une sous-discipline de l’anthropologie sociale. Il s’agit, au contraire, d’un travail d’analyse qui porte sur l’objet même de l’anthropologie. On pourra lire dans son œuvre des textes sur les arts asiatiques ou océaniens, des lectures d’œuvres de Clouet ou de Poussin, des remarques sur Greuze, Delvaux, Manet, les surréalistes, les cubistes ou les impressionnistes. Les références aux arts plastiques y sont si nombreuses qu’on a pris l’habitude de distinguer, d’une part, l’ethnologue, qui étudierait, en utilisant un langage relativement technique, les arts des Indiens du Brésil ou de ceux de la côte du Nord-Ouest de l’Amérique du Nord, et, d’autre part, le connaisseur passionné, qui commenterait, de manière plus rapide, les œuvres de tel ou tel artiste occidental. On oublie ainsi que, dès La Pensée sauvage (1962), l’art est reconnu par Lévi-Strauss comme un des grands thèmes soumis à la réflexion anthropologique, au même titre que le mythe, le jeu ou le rituel. La grande richesse des thèmes artistiques évoqués dans son œuvre ne témoigne donc pas seulement de son immense érudition. Elle renvoie à l’ambition d’universalité qui anime toute sa pensée. Pour lui rendre hommage, je vais essayer ici d’apprécier l’enjeu de cette ambition, qui vise à définir « toujours et partout, le type même de l’œuvre d’art1 » et tenter d’en montrer quelques développements possibles.
*
Dès la fin des années 1950, Lévi-Strauss se distingue, en tant que théoricien de l’art, de ses contemporains. En 1957, André Breton publiait un long essai, en grande partie consacré aux arts non occidentaux, sous le titre L’Art magique. À la connaissance scientifique, qui, selon lui, « prétend toujours étendre sa domination sur toute invention humaine2 », le fondateur du Surréalisme opposait une « conscience lyrique » universelle permettant une compréhension directe de tout art. Primitif ou moderne, naïf ou exotique, l’art répond en tout temps et en tout lieu, selon Breton, à un instinct « lié à la pérennité de certaines aspirations humaines d’ordre majeur3 ». Sans s’y identifier directement, la magie répond donc « aux mêmes aspirations que la pratique de l’art ». Partout « l’œuvre obéit à ses lois propres : qu’elle décide ou non de s’adapter à des fins magiques, on ne saurait oublier que c’est de la magie même qu’elle tire son origine ; se voudrait-elle purement réaliste, rien ne peut faire qu’elle ne lui doive le plus clair de ses ressources ».
Contre ce qu’il appelait une « civilisation de professeurs » qui, pour expliquer la vie de l’arbre, « ne se sent tout à fait à l’aise que lorsque la sève s’en est retirée », il fallait donc reconnaître que « tout art est magique, au moins dans sa genèse4 ». Lorsqu’il parle de magie, Breton se réfère avant tout aux « disciplines hermétiques de la tradition occidentale », dont il défend longuement l’influence sur l’art européen. On ne pourra jamais comprendre – écrit-il – Victor Hugo, Baudelaire ou Mallarmé sans se référer à Éliphas Lévi et à la tradition ésotérique qu’il représente. On aurait tort de croire, toutefois, que l’ésotérisme magique aurait été un phénomène propre à l’Occident. À ses yeux, la tradition des mages hermétiques n’a fait que traduire, en des termes qui nous sont familiers, une conception qu’on trouve partout dans le monde. Éliphas Lévi formulait ainsi ce « dogme unique » :
Le visible étant toujours la manifestation de l’invisible […] la vérité se trouve, dans les choses appréciables et visibles, en proportion exacte avec les choses inappréciables à nos sens et invisibles à nos yeux5.
Le développement de la civilisation et le progrès des techniques n’ont jamais, selon Breton, pu extirper de l’âme humaine « l’espoir de résoudre l’énigme du monde et de détourner à son profit les forces qui le gouvernent ». L’instinct qui conduit à la manipulation magique du monde reste donc bien vivant, en Occident et ailleurs. Les « peuples sauvages » ont « beaucoup moins perdu que nous la charge magique qui justifie leur existence ». C’est pourquoi – conclut-il – « la précarité de leurs ressources fait aujourd’hui contraste avec la luxuriance de leur art6 ».
En appendice à l’introduction de L’Art magique, Breton publiait une « enquête », constituée d’une série de questions adressées, selon ses propres mots, « à quelques-uns des esprits les mieux qualifiés » de son temps. Certaines questions reprenaient explicitement les thèses défendues dans l’introduction : pouvait-on affirmer que « la civilisation n’a dissipé la fiction de la magie que pour exalter, dans l’art, la magie de la fiction » ? La magie répondait-elle à un « besoin inaliénable de l’esprit » ? D’autres questions concernaient plus spécifiquement la relation entre art moderne et pensée magique : de son « long stationnement sur les voies de garage de l’imitation » – écrivait Breton –, l’art d’aujourd’hui pourrait-il sortir autre, grâce à une réhabilitation de la magie ? Pouvait-on, au sein de l’art moderne, qualifier des œuvres, ou des artistes (Rousseau, De Chirico, Kandinsky, Chagall, Duchamp) de « magiques » ? Ou bien fallait-il aller au-delà du domaine de l’art, et identifier un rôle magique, lié par exemple à la mémoire, joué par certains objets dans la vie quotidienne ?
Ethnologues, philosophes, historiens de l’art, artistes ou écrivains, les interlocuteurs choisis par Breton donnaient des réponses très différentes à toutes ces questions. Certains, comme Heidegger, mettaient en doute les critères conceptuels qui conduisaient Breton à opposer l’art « magique » à l’art « religieux », ou même à l’art « classique » ou « baroque ». On confondait ainsi, selon le philosophe, des « catégories nommant des périodes historiques de l’art, avec des catégories d’ordre théorique, ou métaphysique », qui visaient plutôt à qualifier sa nature7. D’autres, comme Jean Paulhan, critiquaient la facilité avec laquelle la notion de magie était évoquée dans le questionnaire :
Je ne vois guère le moyen de confronter utilement deux choses aussi dissemblables qu’une magie personnellement éprouvée et une magie supposée, sur des preuves infiniment légères, à telle ou telle époque, au sein de telle ou telle culture8.
De nombreux auteurs s’accordaient toutefois sur un point : un « art magique » existe, qui traverse les époques et les cultures du monde. Les œuvres illustrant le livre de Breton – des tableaux de Bosch, d’Arcimboldo, de François Nomé, de Paolo Uccello ou de Goya ; des masques africains ou océaniens ; des œuvres de De Chirico, Kandinsky, Dalí, et de Max Ernst – en offraient, selon les souhaits de l’auteur, des témoignages éclatants.
Parmi les textes publiés en appendice à cette introduction, une réponse se démarquait nettement des autres : celle de Claude Lévi-Strauss. Aux questions posées par Breton, l’anthropologue, qui avait longuement étudié les arts amérindiens, répondait par une série de réflexions concernant aussi bien les modalités de l’enquête que l’existence même d’un « art magique ». De quel art parle-t-on – écrivait Lévi-Strauss –, de quelle magie ? Et, surtout, de quelle société ?
À travers l’histoire et selon les sociétés, l’art et la magie se sont sans doute par moments accompagnés, par moments séparés, ou bien leurs chemins se sont croisés. Mais, pour en comprendre la relation, il faudrait d’abord définir la situation dans les termes de chaque société considérée.
Et il ajoutait :
Ce n’est point parce qu’elle prend la magie au sérieux que votre enquête me gêne. Mais plutôt parce qu’elle pose les termes d’art et de magie dans une acception si vague, qu’elle rend impossible une réflexion sérieuse sur ce sujet. […] Au lieu de circonscrire les termes, et de partir d’une définition possible, par exemple celle de la magie comme un ensemble d’opérations et de croyances qui prêtent à certains actes humains la même valeur qu’à des causes naturelles […], vous donnez aux termes d’art et magie leur plus faible valeur sémantique, c’est-à-dire que vous les placez à un niveau où le sens se dissout9.
Cette déclaration fit date, et marqua pour longtemps, à Paris, les relations qui pouvaient s’établir entre l’anthropologie sociale et le monde de l’art. Il s’agissait à l’époque, pour une ethnologie qui venait à peine de s’affirmer, de faire face à l’esthétique « primitiviste ». Les avant-gardes littéraires et artistiques, tout en se passionnant pour les arts « primitifs », cultivaient en réalité une grande méfiance vis-à-vis de toute approche anthropologique de l’art. Selon l’esthétique primitiviste, qui postulait l’universalité du langage de l’art, n’importe quel objet pouvait être compris indépendamment de la signification qu’il revêtait dans la société où il avait été conçu. Breton, qui, en réponse aux remarques de Lévi-Strauss, dénonçait « l’intolérance et l’arrogance d’une ethnologie aujourd’hui militante, qui croit devoir défendre ce qu’elle considère comme son patrimoine exclusif10 », était loin d’être le seul à soutenir cette idée. L’exemple de cette orgueilleuse ignorance avait été donné par Picasso lui-même, qui avait déclaré : « Je ne sais rien des sculptures africaines de ma collection : je les regarde, et je sais tout ce qu’il faut savoir. » Au XIXe siècle, l’ethnocentrisme occidental avait sérieusement mis en doute l’universalité de l’art. À l’époque des avant-gardes, le « primitivisme » admettait l’existence d’un art universel, mais refusait d’en développer l’analyse. Dans l’un comme dans l’autre cas, une anthropologie de l’art n’avait pas sa place.
La passion, presque la colère, qui vibre dans la réplique de Lévi-Strauss à Breton – lequel, pour sa part, déplorait l’étonnante « mauvaise humeur11 » de l’ethnologue – n’est pas seulement liée aux circonstances d’une polémique personnelle. Elle rappelle, certes, les critiques que le grand anthropologue formulait, à la même époque, contre ceux qui, comme Roger Caillois, « préféraient le style à l’analyse » dans l’étude des faits sociaux. Mais elle révèle aussi certaines racines du projet de Lévi-Strauss, pour qui la réflexion sur l’art a toujours été un enjeu essentiel. Dans Tristes tropiques, par exemple, l’étude des graphismes Caduveo est pour lui l’occasion de définir un concept de style qui étend énormément l’enjeu de l’analyse des formes. Ainsi, remarque-t-il, l’ensemble des coutumes d’un peuple « est toujours marqué par un style », et c’est par le style qu’on peut reconnaître que ces coutumes forment des systèmes.
Je suis persuadé que ces systèmes n’existent pas en nombre illimité, et que les sociétés, comme les individus, dans leurs jeux, leurs rêves ou leurs délires, ne créent jamais de façon absolue, mais se bornent à choisir certaines combinaisons dans un répertoire idéal qu’il serait possible de reconstituer12.
En faisant l’inventaire de toutes les coutumes observées par les ethnologues, mais aussi
de toutes celles qui sont imaginées dans les mythes, ou évoquées dans les jeux des enfants et des adultes, les rêves des individus sains ou malades et les conduites psychopathologiques, on parviendrait à dresser une sorte de tableau périodique comme celui des éléments chimiques, où toutes les coutumes réelles ou simplement possibles apparaîtraient groupées en familles, et où nous n’aurions plus qu’à reconnaître celles que les sociétés ont effectivement adoptées13.
Le défi de l’universalité de l’art en tant que lieu d’exploration de la pensée formelle est ainsi lancé : si l’analyse structurale est correctement menée, l’étude d’un masque amérindien doit pouvoir faire apparaître des éléments abstraits, qui pourront s’appliquer à d’autres manifestations artistiques, et donc aussi à l’œuvre d’un artiste occidental, qu’il s’agisse d’un portrait de Clouet, d’un tableau d’histoire de Greuze, d’une toile de Poussin ou de l’œuvre d’un contemporain. Lévi-Strauss admet que tout art est lié à l’émotion esthétique. Il admet aussi que cette expérience peut être universelle. Mais l’expérience de l’art reste, à ses yeux, mystérieuse : qu’est-ce qui fait l’efficacité d’une œuvre, pourquoi ce sentiment d’admiration, et ce plaisir que nous associons à la perception de certaines œuvres ? Le point de départ de cette réflexion est le Portrait d’Élisabeth d’Autriche de François Clouet (ILLUSTRATION 1, en hors texte) :
Regardons ce portrait et interrogeons-nous sur les raisons de l’émotion esthétique très profonde qu’y suscite inexplicablement la reproduction fil par fil, et dans un scrupuleux trompe-l’œil, d’une collerette...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Claude Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle
- I - Terrains
- II - Du local au global
- III - Parenté et mythologie
- IV - Superstructures et infrastructures
- V - Logiques de la connaissance
- VI - Retour à l’homme
- Présentation des auteurs
- Dans la même collection