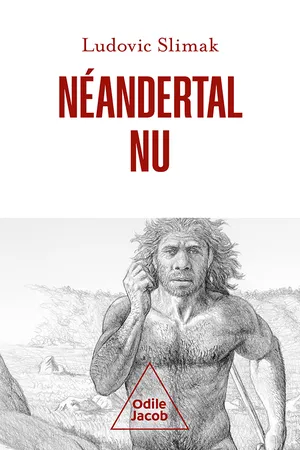
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Et si nous nous étions fourvoyés sur ce que fut l'homme de Néandertal?? Dans un véritable récit de voyage, Ludovic Slimak retrace son parcours de chercheur et nous entraîne dans une étonnante enquête archéologique. Pendant trente ans, il a inlassablement traqué ce qu'il appelle la créature. Créature, comme l'un de ces êtres qu'on apercevrait de loin, dans les brumes, sans vraiment savoir ce qu'il est, sans vraiment savoir le qualifier. Son périple nous emmène en mille détours depuis les étendues glacées du cercle polaire jusque sur les traces d'étonnants cannibales vivant dans de profondes forêts tempérées méditerranéennes. Se confrontant aux vestiges de l'homme de Néandertal, il décrit une créature inattendue et dont la nature pourrait bien nous avoir totalement échappé. Constat d'échec?? Serions-nous incapables de concevoir une intelligence trop divergente de la nôtre?? La créature humaine est décryptée d'une plume vive, parfois sarcastique, qui affronte sans détour nos fantasmes et nos projections sur cette humanité éteinte. Cette créature humaine, c'est Néandertal, bien sûr. Mais c'est nous, aussi, dont un portrait inattendu émerge de ce regard croisé à travers les millénaires. Ludovic Slimak est l'un des meilleurs spécialistes des sociétés néandertaliennes. Chercheur au CNRS et auteur de plusieurs centaines d'études scientifiques sur ces populations, il a dirigé des missions archéologiques de l'équateur au cercle polaire. Il a pisté inlassablement Néandertal depuis trente ans pour enfin nous livrer son regard sur la créature. Un regard dissonant, dérangeant, qui interroge profondément la nature de cette humanité, tout autant que notre manière de la concevoir et les raisons de son étonnante extinction.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Néandertal nu par Ludovic Slimak en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences physiques et Géologie et sciences de la Terre. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Chapitre II
Une odyssée boréale
Des peuples du mammouth aux peuples de la baleine
Un monde de glaces ?
Les présentations sont faites.
Vous savez désormais que nul ne devrait parler de Néandertal sans l’avoir côtoyé de très près, là où il vécut, dans les immensités sauvages et dans les recoins de falaises où les subtils témoins de sa matérialité furent fossilisés, et surtout pas dans les tiroirs d’un musée. C’est pourtant dans un tiroir que commence l’une des premières histoires que je souhaite évoquer avec vous et qui me relie à ces sociétés éteintes. Un tiroir de l’Institut de la branche ouralienne de l’Académie des sciences de Russie, dans la cité boréale de Syktyvkar, en République komie, petite république polaire dans l’angle nord-est de l’Europe. C’est dans les immenses territoires de la Russie que fut découverte l’intégralité des sites archéologiques nous renseignant sur les premiers peuplements des territoires polaires. Nous voilà amorçant des recherches sur Néandertal... directement sur le cercle polaire arctique européen. Quelle étrange idée.
Ce sont pourtant les conditions climatiques polaires qui ont le mieux caractérisé les environnements dans lesquels se sont développées les sociétés néandertaliennes dans les espaces continentaux européens et il faut remonter au-delà du centième millénaire pour que les archives climatiques enregistrent des conditions tempérées beaucoup plus favorables et des climats mondiaux tempérés et qui furent même durant une dizaine de millénaires bien plus chauds que les températures terrestres actuelles. Avant les glaces et les immenses steppes herbacées, il y a une centaine de millénaires, l’Eurasie tempérée accueillit donc une immense forêt primaire, sans limites réelles, étendues infinies dans lesquelles aucun arbre ne fut jamais coupé... Ces immensités-là dépassent l’imagination et nous nous confronterons dans les chapitres suivants, pour nous réchauffer, à ces peuples de la forêt, à ces néandertaliens des bois que la recherche scientifique commence à peine à discerner vraiment.
Pour l’heure, l’Eurasie est faite d’étendues englacées et Néandertal, durant des dizaines de millénaires, et jusqu’à son extinction, sera bien une créature polaire. Mais il y a polaire et polaire... et dans les espaces boréaux russes, les recherches archéologiques permettent de démontrer que quelques très rares sociétés du Paléolithique colonisèrent les territoires arctiques alors même que la planète était plongée en pleine période glaciaire.
Lors de cette phase climatique les températures terrestres globales s’effondrent. Durant des dizaines de millénaires les trois sœurs scandinaves, Norvège, Suède, Finlande, sont figées dans la glace, recouvertes par de puissants inlandsis. Les périodes les plus froides voient le front de ces immenses glaciers se développer et recouvrir l’essentiel de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, ne laissant libre de l’emprise des glaces que l’extrémité sud des îles Britanniques. Le niveau des océans est alors bien plus bas, d’immenses quantités d’eau étant absorbées par la formation de ces étendues glacières. La Manche n’est plus un détroit maritime mais une large vallée où le fleuve Manche rejoint l’océan Atlantique bien plus à l’ouest, entre l’actuelle Bretagne et la Cornouaille...
Il n’est pas impossible que les populations du Paléolithique se soient aventurées sur les vastes étendues englacées du nord de l’Europe, mais il n’en reste à ce jour aucun indice archéologique. Étonnamment, un peu plus à l’est, et jusqu’au-delà du cercle polaire, dans l’actuelle République komie, les espaces polaires ne furent jamais englacés. L’immense fleuve Pechora, qui se déverse au nord dans l’océan Glacial arctique, va néanmoins se trouver un temps bloqué par ces masses glaciaires, créant un gigantesque lac. Mais il ne pourra résister à la pression colossale de ces masses d’eau et finira par céder, libérant définitivement ces territoires polaires qui ne seront jamais englacés, pas plus que les étendues boréales sibériennes. Comment expliquer que dans ces espaces hypercontinentaux qui comptent aujourd’hui parmi les régions polaires les plus froides de l’hémisphère Nord, aucun inlandsis ne se soit développé durant la dernière ère glaciaire ? Il semblerait que la réponse à cette situation paradoxale soit assez simple. Les puissants glaciers qui couvrent l’Europe, de l’Irlande à la Finlande, créent une véritable barrière naturelle coupant les territoires polaires continentaux de l’océan Atlantique. Les précipitations, qui viennent essentiellement de l’Atlantique, sont récoltées par ces vastes étendues englacées et ne franchissent jamais cette énorme barrière de glace.
Le climat polaire du Grand Nord eurasien est alors très froid, mais très sec, et se trouve libre des emprises glaciaires. Outre que les terres se trouvent dégagées, elles présentent à la belle saison un biotope extraordinaire et particulièrement propice à la vie. Dans les étendues polaires et sibériennes les troupeaux de proboscidiens vont se développer en grand nombre créant cet environnement si singulier que nous reconnaissons aujourd’hui sous l’appellation de steppes à mammouths.
Vivre dans le froid, vivre du froid
L’un des enseignements inuits peut se résumer ainsi : le froid n’est jamais un problème pour l’homme. L’accès aux protéines, les ressources alimentaires basiques représentent l’unique facteur limitant pour les expansions humaines. Notre corps est d’ailleurs très peu sensible au froid lorsqu’il est sec, et c’est bien un froid sec, probablement aride même, qui caractérise ces espaces polaires eurasiens de la dernière ère glaciaire. En termes de ressenti, de nos jours, il fait plus froid en février à Saint-Pétersbourg par – 16 oC que par – 30 oC dans les terres continentales de Sibérie. Mes recherches en zone polaire m’ont amené à expérimenter la réaction de mon propre métabolisme lorsque durant plusieurs semaines je fus quotidiennement confronté à des températures de – 25 oC. Après quelques jours, probablement moins de dix jours, je constatais que mon corps ne souffrait plus du froid et que je pouvais passer une journée complète à marcher dans la taïga sans réellement endurer l’expérience du froid. Mon métabolisme s’était rapidement calibré et ajusté en quelques jours seulement, de telle sorte que ces températures me paraissent normales, sinon agréables. Plus étonnant encore, j’ai participé à différentes missions entre le Sahel, le désert de Gobi ou la corne de l’Afrique, communément sous des températures torrides. Mon métabolisme est ainsi fait que, même dans des conditions de températures assez extrêmes, mon corps ne transpire pas, ou très peu. Et voici qu’au cœur du mois de février, dans les espaces polaires européens, après une journée de marche dans la neige, lorsque je rentrais dans mes appartements chauffés entre 18 et 20 oC, je me mettais à transpirer, à transpirer jusqu’au bout des doigts ! Mon métabolisme s’était calibré sur – 25 oC, une température qui ne me dérangeait en rien, et l’atmosphère familière tempérée m’était devenue étouffante. Étonnant constat quant aux adaptations de nos corps, constat qui a des implications importantes sur nos perceptions des expansions humaines vers les espaces boréaux. Il est ainsi commun de lire, même sous la plume de très bons chercheurs, que la simple colonisation des moyennes latitudes de l’Eurasie par des populations issues des environnements africains était probablement le révélateur de capacités d’adaptation technologiques, nécessitant le développement technique de protections contre le froid, et sociales, par la mise en place de réseaux d’entraide robustes. C’est donc grâce à ses développements technologiques et par l’organisation singulière de leurs sociétés que nos ancêtres auraient réussi à conquérir les environnements et les climats les plus rigoureux de la planète. Ces théories supposent d’accorder une place centrale aux capacités inventives et aux stratégies humaines, palliant un métabolisme plus spécifiquement adapté aux régions tropicales. Il s’agit probablement d’une idée préconçue qui ne prend pas en compte les propriétés biologiques étonnantes des métabolismes humains. Il est probable que ces conceptions du monde soient erronées et ne nous renseignent ni sur notre réalité biologique, ni sur l’organisation précise de ces lointaines sociétés du Paléolithique. Ces perceptions, ces regards, fussent-ils scientifiques dans leurs démarches, pourraient bien être, avant tout, prisonniers de conceptions du monde et de l’homme qui ne renvoient pas aux lointaines sociétés de la préhistoire mais qui parlent surtout de nous, Occidentaux d’aujourd’hui, et de notre propre incapacité à nous projeter dans des réalités qui nous sont tout à fait étrangères. C’est sur cette base même qu’ont émergé au tournant des années 2000 différentes théories concernant l’extinction des populations néandertaliennes. Constatant l’absence de sites néandertaliens au-delà du 55e parallèle nord, des chercheurs émirent l’hypothèse que ces populations n’auraient su s’adapter aux hautes latitudes européennes, limitées par leurs technologies ou leur incapacité à construire les réseaux d’entraide permettant de s’affranchir des contraintes environnementales les plus extrêmes. Les populations néandertaliennes n’auraient pu coloniser que les latitudes moyennes et n’auraient pas su affronter les changements climatiques affectant leurs biotopes dans les derniers millénaires de leur existence. L’extinction néandertalienne découlerait alors d’un simple changement climatique et d’une incapacité de s’adapter à de nouveaux biotopes. Les différentes hypothèses sur l’extinction néandertalienne reposent systématiquement sur la conjonction de différents facteurs puisque aucun ne semble pouvoir expliquer à lui seul la disparition d’une population humaine. Les hypothèses autour de cette mystérieuse extinction reposent systématiquement sur des conjonctions de facteurs environnementaux ou écologiques, qui ne prennent en compte que de manière très secondaire l’impressionnante expansion d’Homo sapiens à travers les espaces eurasiatiques. Qu’on les prenne une à une ou qu’on les considère dans leur ensemble, ces propositions apparaissent bien fragiles. Qui peut réellement croire que Néandertal se soit évaporé comme neige au soleil ? Les données de la colonisation des très hautes latitudes remettent directement en question les théories climatiques et la question des limites adaptatives de ces populations humaines. Les métabolismes humains ne réagissent en rien comme ceux des plantes, face aux changements de climat. À l’expérience, les corps humains se montrent remarquablement adaptables, ubiquistes, et se révèlent capables d’affronter assez aisément toute la gamme des environnements planétaires. La question de la confrontation des populations humaines archaïques aux environnements polaires n’engage pas seulement notre regard sur les humanités éteintes, mais aussi notre conception de notre propre humanité et de ses capacités adaptatives. C’est l’enseignement de Wim Hof, « Iceman », l’« homme de glace », comme l’ont dénommé les Anglo-Saxons... Wim Hof réalisa, au cœur de l’hiver 2007, un semi-marathon de 21 kilomètres sur le cercle polaire, pieds nus et en short. Quelques mois plus tard, il attaquait l’ascension de l’Everest par son versant tibétain sans réel équipement pour se protéger du froid. Wim Hof représente désormais un véritable sujet d’étude pour les chercheurs travaillant à la compréhension du métabolisme humain. L’un des enseignements de Wim Hof, qui n’est pas un superhéros mais un homme de chair et de sang, est que le corps humain s’adapte remarquablement bien au froid, et que nos propriétés métaboliques ne sont probablement en rien déterminées par la question de nos origines biologiques, que l’on sait africaines et tropicales. Nous restons, là aussi, très probablement piégés dans des projections, des fantasmes, des peurs, naturelles, certes, mais qui résistent difficilement à l’expérimentation.
Les sociétés du Paléolithique n’ont sans doute pas eu besoin de capacités technologiques ou sociales remarquables pour affronter l’ensemble des biotopes de la planète. Le corps, seul, fait probablement une grande part du travail...
Face aux immensités polaires
Les espaces polaires représentent une clef remarquable pour aborder l’organisation et la structure de ces lointaines sociétés du Paléolithique. En 2006, je me décidai à partir pour la Sibérie occidentale afin d’y présenter mes recherches sur les dernières sociétés néandertaliennes au Congrès archéologique nordique. Cette aventure allait finalement me mener durant quelques années sur les flancs occidentaux et sibériens de l’Oural polaire, sur les traces des tout premiers peuplements boréaux. On y croise aujourd’hui, perdus dans des immensités sauvages, datchas, taïga polaire et anciens goulags où s’est réfugiée, plus qu’ailleurs peut-être, une certaine mélancolie de l’âme slave, enchâssée dans des barres de béton, échouée dans d’immenses vestiges industriels, cadavres rouillés des idéaux soviétiques. Ces carcasses de fer et de pierre ne m’enchantaient guère, mais il y séjourne une profonde humanité, touchante, troublante. Je voulais la vivre, aussi. Et puis... les espaces boréaux m’avaient toujours attiré. Néandertal était-il, ou pas, une créature polaire ? N’avait-il pas passé l’essentiel de son existence sous les affres de la dernière glaciation ? Mais que venaient faire les anciennes sociétés du Paléolithique en zone polaire durant les phases climatiques les plus rigoureuses alors enregistrées sur terre en un million d’années ?
Les plus grands spécialistes russes des sociétés nordiques étaient rassemblés pour quelques jours à Khanty-Mansiïk, dans l’Ouest sibérien, dans le cadre de ce congrès nordique. Nous étions fin septembre et les premières neiges commençaient à couvrir les berges de l’Ob, l’un de ces immenses fleuves du nord dont la démesure est à l’échelle de la Sibérie. Rien de commun avec les paysages qui nous sont familiers en Europe occidentale. L’Ob traverse toute la Sibérie, du nord au sud, et son bassin couvre, seul, trois millions de kilomètres carrés, presque autant que celui du Nil, le plus long fleuve au monde, l’équivalent de près de cinq fois la superficie de la France... Mais ces mesures, ces démesures, ne sont que le reflet précis des immenses étendues sauvages qui naissent sur les flancs européens de l’Oural et ne meurent pas avant les lointaines berges du continent américain.
Les chercheurs russes ont développé dès le milieu du XXe siècle une école pionnière de l’archéologie paléolithique, mettant en place des stratégies de recherche qui ne furent importées que bien plus tard en Europe occidentale, par André Leroi-Gourhan en particulier, personnage d’une rare densité intellectuelle dont les intérêts réunissaient l’archéologie, l’ethnologie et la philosophie dans une pensée globale. Leroi-Gourhan avait été profondément marqué par les grands programmes de recherche archéologique développés par les Soviétiques. Les territoires russes sont en grande partie recouverts de lœss, puissantes épaisseurs de limons déposés par les vents, qui ont fossilisé à très grande vitesse les habitats des chasseurs du Paléolithique, préservant les vestiges de vastes campements de ces populations nomades. À ces réservoirs archéologiques très étendus, les Soviétiques avaient adapté des méthodes ambitieuses de grands décapages révélant, comme si les chasseurs du Paléolithique venaient de quitter les lieux, les sols paléolithiques jonchés d’outils de silex parfois enchâssés dans de véritables charniers d’ossements de mammouths. Ces programmes de recherche soviétiques ont imprimé une marque profonde à l’archéologie mondiale, même si les recherches ne sont heureusement plus poussées par la mégalomanie du système soviétique. De nos jours la recherche russe, légataire de ce patrimoine archéologique exceptionnel, reste remarquablement dynamique, mais pour les archéologues la tâche est ici presque insurmontable. Comment gérer et préserver l’intégralité d’un patrimoine dispersé de l’Europe jusqu’à l’Amérique ? La Russie est de très loin le plus vaste pays du monde, sa population qui ne représente qu’un peu plus du double de la population française gère un huitième des terres émergées mondiales. Ce territoire est près de deux fois plus important que celui des autres pays les plus étendus, Canada, États-Unis, Chine. Imaginez que la moitié de ces terres sont constituées d’immenses forêts primaires. Ces étendues boréales représentent près du quart des forêts mondiales et constituent le plus grand espace forestier sauvage de la planète, loin devant les forêts équatoriales. Les populations y sont de nos jours principalement localisées dans quelques grandes cités, sortes de colonies humaines dans des océans de verdure vierge et dont l’exploitation forestière est anecdotique comparée aux superficies en présence. La Sibérie, et plus encore ses étendues polaires, représente désormais avec l’Antarctique les seuls espaces planétaires restés sauvages de toute éternité. Il existe encore un Far East, vierge, comme il a existé un Far West, immense. À n’en pas douter, ici, est la dernière vraie frontière.
Une course contre le temps
Face à ces immensités, comment gérer le patrimoine archéologique colossal enfoui sous des étendues infinies de lœss ? Dans les hautes terres boréales, ces vestiges sont conservés dans des sols gelés depuis des milliers d’années. Mais sous ces latitudes les changements climatiques s’expriment sous nos yeux de manière accélérée, entraînant la fonte des sols et libérant leurs trésors archéologiques. Les chairs millénaires, les bois, les cuirs, les tissages, les tissus, les vanneries, les filets, rentrent à nouveau dans le cycle naturel de la putréfaction qui les avait épargnés depuis le Paléolithique. Si mammouths et rhinocéros peuvent être reconnus par les habitants épars des étendues sibériennes, trappeurs ou éleveurs de rennes du Grand Nord, qu’advient-il dans ces étendues sauvages des corps des chasseurs du Paléolithique ? Ici, c’est incroyable, les plus belles découvertes sont parfois réalisées par des enfants nostalgiques jouant sur les berges des fleuves, ou par des artistes en quête d’ivoire pour leurs sculptures merveilleuses. Comme ça, au bord des ruisseaux, dans les marais, émergeant des glaces préhistoriques à peine fondues. La suspension des effets du temps due à la congélation n’a aucune raison de ne concerner que les faunes sauvages et non les dépouilles humaines. Il est probable que ces corps du Paléolithique ont déjà émergé des glaces, retournant à leurs cycles de décomposition. Il faut aussi envisager qu’un certain nombre de ces corps du lointain paléolithique ont déjà été retrouvés par les populations locales, et que leur destin fut peut-être alors d’être enterrés décemment, sur place, ou au cimetière le plus proche. Si tel est le cas, ils gisent aujourd’hui sous une croix d’épicéa ou de mélèze...
Avec la fonte des sols boréaux, figés par la glace depuis la dernière ère glaciaire, nous sommes confrontés à un paradoxe cruel. La déprise du permafrost révèle les sites archéologiques jusque-là cachés, mais entraîne en même temps leur destruction rapide et inexorable. Au cœur des immenses territoires nordiques les sites sont invisibles, enfouis sous d’épais couverts de lœss qui atteignent communément une dizaine de mètres d’épaisseur. En l’absence de route, impossible d’amener des engins de creusements, pelles mécaniques et bulldozers. Les sites ne sont généralement révélés que par les creusements naturels des plus larges cours d’eau sibériens. L’action des flots libère, sur ses berges, ossements et silex qui sont emportés par les flots en contrebas, au bord des lits des rivières, révélant l’existence de sites qui furent scellés durant des dizaines de milliers d’années. Mais, au moment précis où les sites sont révélés, il ne leur reste plus que quelques saisons avant d’être emportés par le courant puissant de ces vastes fleuves, parfois de manière spectaculaire. Mes collègues russes ont vécu cette étrange expérience. Leurs équipes profitaient des quelques semaines de beaux jours au cœur des espaces polaires sibériens pour dégager de remarquables fossiles archéologiques pris dans la glace depuis près de tre...
Table des matières
- Page de titre
- Copyright
- Sommaire
- Introduction
- Chapitre I Néandertal, en nos âmes et consciences
- Chapitre II Une odyssée boréale
- Chapitre III Des cannibales dans la forêt ?
- Chapitre IV Rites et symboles ?
- Chapitre V De l’esthétique néandertalienne
- Chapitre VI Comprendre la créature humaine
- Conclusion Libérez la créature...
- Suggestions de lectures