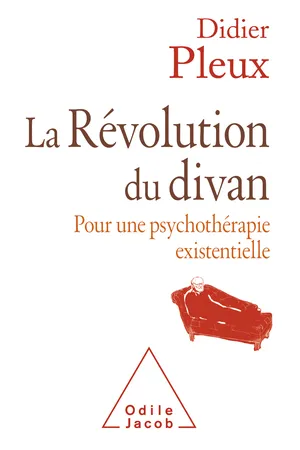
- 288 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
« Beaucoup de patients ne comprennent pas l'intensité des émotions qu'ils ressentent quand ils vivent une déconvenue relationnelle, un accident de vie, un problème de santé, une séparation, une rupture sentimentale, voire un deuil. Aider à mieux vivre ne semble pas suffire. La psychothérapie se doit d'aider à mieux "être" dans le réel. Et pour cela il est parfois nécessaire de connaître son histoire, avec les blessures et les bonheurs qui nous ont construits… À la psychanalyse traditionnelle, symbolique, parfois occulte, doit répondre une psychothérapie fondée sur la responsabilité et la liberté individuelle de construire son existence. Je vous propose dans ce livre une nouvelle psychothérapie existentielle. » D. P. Un livre clair et original, une nouvelle voie pour se reconstruire et progresser dans la vie. Didier Pleux est docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien, psychothérapeute et auteur de référence pour les sujets d'éducation. Il dirige l'Institut français de thérapie cognitive. Il est l'auteur de livres qui sont de très grands succès parmi lesquels : De l'enfant roi à l'enfant tyran, Peut mieux faire, Exprimer sa colère sans perdre le contrôle, Un enfant heureux, Les Adultes tyrans, Les 10 Commandements du bon sens éducatif.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à La Révolution du divan par Didier Pleux en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Psychologie et Psychologie appliquée. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
Faut-il oublier la psychanalyse freudienne ?
Fin d’un combat ?
Juillet 2010… Michel Onfray fait l’objet d’une pétition visant à l’interdire d’antenne sur France Culture pour la diffusion annuelle de sa Contre-histoire de la philosophie, un cours qu’il dispense chaque année dans son Université populaire de Caen. Cette demande de censure n’aboutit pas, mais elle passe inaperçue en dépit de la signature de personnalités dites « éminentes » à défaut d’être démocrates. Nous alertons les médias. Le magazine Le Point mis à part, nous obtenons pour toute réponse un grand silence autour de cette affaire. Est-ce si surprenant ?
Déjà son livre Le Crépuscule d’une idole avait soulevé une majorité de critiques négatives, des insultes et néanmoins aucun débat digne de ce nom. En France, on ne peut pas critiquer impunément la psychanalyse freudienne. Le philosophe savait qu’il s’attaquait à la dernière grande religion de notre culture et que la réplique serait forte. Il ne pouvait cependant pas soupçonner que les contradicteurs préféreraient l’anathème voire les éructations au débat d’idées. Nous avions échangé sur le sujet et quelques mois avant la parution du Crépuscule je lui avais confié mes « histoires non freudiennes ».
Il y aura bientôt quarante ans déjà…
J’étais éducateur dans un foyer d’action éducative (un internat de semi-liberté selon l’appellation de l’époque) qui recevait des adolescents délinquants multirécidivistes. Je suivais en même temps un cursus universitaire de psychologie à la faculté de Caen. Très vite, je pris la mesure de l’écart qui existait entre l’enseignement universitaire et mon quotidien avec les jeunes en difficulté dont je m’occupais. La réalité d’éducateur spécialisé m’aidait à confronter les enseignements théoriques que je recevais à ce que je vivais dans la réalité.
Nous étions au milieu des années 1970, j’étais déjà fasciné par cette contradiction très présente entre le « discours » psychologique alors en vogue et le « faire ». Notre génération était souvent plus soucieuse de refaire le monde en échangeant des idées que d’appliquer les séduisantes nouvelles philosophies de vie. La théorie l’emportait sur la pratique : le verbe avant le faire. J’avais un ami de lycée qui poursuivait de brillantes études de sociologie. Il savait me tenir des propos très éloquents sur le « pourquoi » de la délinquance juvénile et considérait notre travail « éducatif » à côté de la plaque, complètement en décalage avec l’hypothèse sociologique de la nécessaire révolution sociale, étape essentielle pour venir à bout des comportements dyssociaux.
« La délinquance est engendrée par le capitalisme » et, par conséquent, elle ne disparaîtrait qu’avec l’anéantissement de la société libérale d’alors. Oui, certains jeunes qui nous étaient confiés venaient bel et bien de milieux très défavorisés, mais pas tous. Je m’interrogeais : la « dyssocialité vraie », pour reprendre l’expression de R. Mucchielli, pouvait-elle s’expliquer par la seule variable sociologique ou politique ? La vraie délinquance se définissait non seulement par un déficit social mais aussi par une carence culturelle et éducative. J’essuyai mes premières critiques : en croyant bien faire, en tentant d’éduquer des adolescents en perdition, en vivant avec eux une soirée sur deux, un week-end sur deux, je n’étais, au final, qu’un suppôt du pouvoir capitaliste. Mes accusateurs ne faisaient rien, restaient dans le verbe, mais ils avaient pour eux la « vérité théorique » ; mon « faire avec » éducatif – les activités de loisirs ou d’autres occupations comme le rattrapage scolaire que je proposais – ne semblait pas avoir beaucoup de poids face aux certitudes livresques de mes détracteurs. Et lorsque naïvement, je demandais à mes conseilleurs « politiques » de venir me donner un coup de main pour encadrer telle ou telle activité de week-end avec les jeunes du foyer, la réponse fusait : « À quoi bon, c’est une goutte d’eau dans une mare… Réinsérer les délinquants n’est qu’une entreprise de collaboration avec le pouvoir… » Que ne l’ai-je entendu ?
Moi qui avais toujours cru être « de gauche », surtout en vivant mon idéal « social » avec ce métier d’éducateur, et j’étais taxé de « collabo », d’homme de « droite » ! Incroyable !
Lorsque Onfray reprend l’expression de Jankélévitch et parle d’hapax existentiel, je crois que cette époque en fut un : je voyais constamment cette dichotomie entre ceux qui « font » et ceux qui « parlent ». Je décidai alors de mener une lutte incessante pour que ceux qui « font » soient écoutés et compris de ceux qui « parlent ». Cette démarche que je décidai n’était nourrie d’aucune haine farouche pour ce qui est « intellectuel », puisque j’allais moi-même faire un doctorat de psychologie, mais par une vigilance permanente à une forme de cohérence et de devoir d’efficacité pour que les « penseurs » ne l’emportent jamais sur les acteurs. L’agir confronté au discours. Pas question en effet que les gens de terrain stigmatisent les idées. J’avais le simple projet de toujours faire la synthèse entre la théorie et la pratique. C’était, pour parler simple, la formule de Louis Casali, ce directeur de foyer qui m’employait et qui fut mon premier mentor : « habiter sa parole ». Cet homme engagé savait que l’authenticité ne pouvait dissocier le mot de l’acte : un programme que son équipe éducative allait bien vite oublier.
Nous étions, je l’ai dit, au milieu des années 1970, et la psychanalyse allait entrer dans ma vie. Je l’avais bien sûr connue, comme tout le monde, en classe de terminale, avec la lecture des livres de Freud, et je me passionnais, comme tout adolescent lassé des cours de philo, pour cette histoire de sexualité qui répondait à mes fantasmes d’alors. Sa Psychopathologie de la vie quotidienne m’avait séduit. Nous étions en 1969, la liberté sexuelle faisait ses premiers pas et les « romantiques » de mon espèce se réfugiaient encore dans les livres. Mais c’est surtout pendant l’année du service militaire que je commençai à dévorer les livres de Freud, j’avais besoin de quitter la réalité pour tenir le coup et le maître de la psychanalyse m’offrait cette échappatoire. C’est à cette époque que je décidai de m’engager dans l’éducation spécialisée et d’étudier concomitamment la psychologie ; j’en saurai toujours gré à Freud d’avoir suscité ma vocation.
Vers la moitié des années 1970, j’obtenais une licence, puis une maîtrise de psychologie à la faculté de Caen et, parallèlement, le diplôme d’État d’éducateur spécialisé à l’Institut des travailleurs sociaux d’Hérouville-Saint-Clair. À l’université, la psychanalyse était enseignée comme un catéchisme. Je réalisai très vite que tous les cours de « psychopathologie » ne traitaient que de la psychanalyse freudienne et qu’il s’agissait, pour obtenir de bons résultats, de restituer tout simplement les concepts que l’on nous avait dictés : la puissance de l’inconscient, le complexe œdipien, l’interprétation symbolique… Nul besoin donc de perdre du temps à écouter la grand-messe universitaire, je ne rencontrais jamais de pensée dissidente ; lors des examens annuels, il suffisait de restituer la voix des maîtres.
Ainsi, en DESS de psychopathologie à l’université René-Descartes-Paris-V, j’ai le souvenir très précis des conditions d’obtention de la valeur dite du « test de Rorschach ». Une éminente professeure avait annoté de fort belles appréciations sur la copie d’un devoir qu’un de mes amis lui avait rendu plusieurs années auparavant. Cette analyse d’un protocole du test de Rorschach avait suscité chez cette enseignante des commentaires dithyrambiques sur certains passages soulignés en rouge. Je les repris, intégralement, le jour de mon propre examen pour l’analyse d’un nouveau test qui n’avait, bien sûr, rien à voir avec celui de mon ami. Je peaufinai l’ensemble avec deux ou trois affirmations lues dans l’ouvrage de ce même « professeur auteur » et le tour fut joué : mention bien !
Mais, soyons juste, dans mes chères études, j’ai rencontré un enseignant qui n’avait rien d’un quelconque inféodé aux théories freudiennes. Ce second personnage, déterminant pour mon parcours, fut Jean Drévillon, professeur érudit qui, à l’époque, restait intelligemment rebelle aux idées reçues en psychologie. Il allait beaucoup m’influencer et me guider dans ma recherche doctorale. Subtil, il savait orienter ses étudiants vers la « psychologie du développement ». Il espérait sans doute susciter des vocations pour que la psychologie soit plus réaliste, touche au « quotidien » et contribue, en s’actualisant, à offrir un véritable mieux-être. Sans contester ouvertement la psychanalyse, il se devait d’être assez diplomate pour préserver ses terres de liberté, mais c’est au travers de ses commentaires que je comprenais qu’il existait une issue aux dogmes que ses collègues enseignaient…
En témoigne cette appréciation obtenue à l’écrit d’une valeur de licence où il était demandé de traiter de la « crise d’adolescence ». J’avais rédigé une diatribe contre l’absence des parents, sur ce manque d’« adultes significatifs » à cette période de la fin de l’enfance. J’avais conclu à une « crise d’adulte », liée à la responsabilité parentale et non à une problématique liée à l’adolescence : « Idée originale qui ne manque pas de pertinence », avait-il conclu. Plus tard, lors de la soutenance d’un mémoire de maîtrise, il avait accepté mon hypothèse qu’il existait un parallèle entre les personnalités « dyssociales » (les délinquants) et le refus des frustrations, les contraintes liées aux exigences de la réalité. Nous étions alors en 1978, j’allais reprendre cette hypothèse pour la thèse de doctorat et cette recherche sur l’importance de la tolérance aux frustrations dans les apprentissages qui allaient devenir, au fil des années, ma constante préoccupation : ne jamais oublier l’interaction entre plaisir et réalité et son lien avec les différentes pathologies mentales. Je remercie ce cher professeur Drévillon qui dut batailler pour m’autoriser à soutenir une thèse jugée « pas du tout psychologique » par des universitaires qui refusaient d’intégrer le jury… Il trouva un professeur roumain qui donna son accord, nullement choqué de lire une thèse qui évoquait les comportements humains dans leur observation réelle et non dans leur analyse symbolique ou psychanalytique. La faculté de Caen était terre freudienne et il n’était pas question d’accorder des diplômes à de supposés dissidents. Jean Drévillon aimait la contradiction, il fut le seul résistant. Après sa retraite, les dogmatiques reprirent le pouvoir. Il y a quelques années, les responsables de recherche de cette même université de Caen refusèrent un projet de doctorat à l’une de mes collègues psychologues sous prétexte que le sujet n’était pas d’obédience… psychanalytique ! Elle choisit de rejoindre l’équipe du professeur Ruzinek de Lille…
Revenons aux années 1970, quand le foyer dans lequel j’intervenais en tant qu’éducateur bascula subrepticement dans la psychologie analytique et abandonna peu à peu son action éducative.
Si, jusque-là, l’éducation primait sur tout le reste – nous osions même employer le terme « rééducation » – petit à petit les « psys » de l’institution prirent le pouvoir. Nous, les éducateurs, qui ne percevions que la réalité d’un comportement, nous apprenions peu à peu, avec les interprétations de nos psys, qu’il y avait toujours un sens caché derrière le tangible. Un jeune délinquant insultant l’était parce qu’il « transférait » sur nous sa haine de l’image paternelle, s’il entaillait les pneus de la voiture du directeur c’était pour « signifier » sa révolte et sa volonté de liberté, si, de retour de famille, il quémandait de la nourriture avant l’heure du repas, c’était pour se « remplir affectivement ». Nous n’avions donc rien compris jusque-là et ces interprétations nous montraient à quel point le « bon sens » habituel était stupide : non, il n’était pas possible de « voir » ce qui est « caché », il nous fallait apprendre à « décoder » et seul le langage psychanalytique allait dessiller nos yeux.
Dans ce foyer Henri-Guibé de Caen, nous avions la chance de rencontrer d’éminentes personnalités. Je me souviens de cette visite de Michel Lemay, psychiatre français de renommée internationale, qui travaillait au Québec. Son intelligence remarquable, ses analyses et ses argumentations brillantes étaient des plus convaincantes, mais lorsqu’il s’agissait d’évoquer l’origine des comportements délinquants, nous entendions toujours la même hypothèse : il n’y a pas de délinquance juvénile sans qu’il y ait, à l’origine, une carence affective. Son livre J’ai mal à ma mère affirmait à chaque page ce lien entre l’absence d’affectivité maternelle et les futurs passages à l’acte délictueux. Cette hypothèse a d’ailleurs toujours autant d’adeptes : beaucoup croient en effet que si un jeune commet des actes incivils, s’il « délinque », c’est qu’il a souffert dans sa prime enfance de carences affectives profondes et en particulier de l’absence d’amour maternel. Je voyais pourtant autre chose dans mon travail d’éducateur. Certes, des jeunes correspondaient tout à fait au profil de « carencé affectif », mais c’étaient, en général, ceux qui se nourrissaient le plus de notre aide et qui abandonnaient la délinquance assez vite. En revanche, les plus « difficiles » avaient souvent une mère qui ne les avait aucunement carencés mais, au contraire, les avait survalorisés, surprotégés, adulés. En un mot, dans la petite enfance de nos adolescents « dyssociaux », je voyais surtout un monde de « reines mères » qui avaient enfanté des enfants-rois avec des dénominateurs communs bien identifiables comme père absent, manque de toute autorité et, surtout, absence d’éducation.
Ce déterminisme de l’origine des pathologies dans la petite enfance a la vie dure et, quand il s’agit de « délinquance », les clichés sont bien vivants ! Ces conclusions hâtives omettent tout simplement le fait que la plupart des enfants carencés ou abusés ne répètent pas les comportements subis, comme le veut la légende : j’ai été battu, je deviendrai violent à mon tour, j’ai été abusé, je serai donc abuseur. Les « résilients », qui sont majoritaires, ne sont que rarement évoqués et c’est pourtant là que se trouve l’ébauche d’une réponse. Si certaines victimes d’un passé aberrant s’en sortent, s’ils deviennent résilients (relisons Boris Cyrulnik), à quoi est-ce dû ? Et si cela signait que, face aux aléas et aux souffrances de la vie, chaque individu a la possibilité de faire un choix existentiel ? Cette hypothèse se construisait lentement en moi et c’est cette direction que j’allais suivre quand je deviendrais psychothérapeute. J’appréhendai ainsi la psychopathologie en questionnant la part de responsabilité de celui qui souffre, de celui qui « agit » sa souffrance, mais aussi de celui qui fait souffrir l’autre. Si cette responsabilité n’est pas apparemment toujours consciente, comment s’est-elle déclenchée, comment peut-on aider non seulement à comprendre le « pourquoi » mais surtout comment aider à dépasser des dysfonctionnements psychiques, ces « causes » de malheur pour soi et les autres ? Ce sont là les véritables enjeux de toute entreprise d’aide psychologique ou psychothérapique : aider celui qui souffre à faire la part des choses entre ses déterminismes biologiques, familiaux, sociaux et sa propre responsabilité d’être humain de décider de son existence.
SACRO-SAINT INCONSCIENT
À cette époque, quand j’échangeais sur cette présence « réelle » des mères de nos « délinquants », quand je rappelais qu’elles avaient de l’affection pour leur progéniture, et que je ne voyais pas de « carence » chez nos adolescents, la réponse fusait : le « manque » s’est construit au-delà de la réalité vécue, tout se passe ailleurs.
Cet « ailleurs » séduisait notre équipe éducative, il nous faisait entrer dans le monde parallèle de l’inconscient de nos adolescents, dans l’espoir d’y voir ce que l’on ne pouvait pas naturellement percevoir… S’inscrire dans le monde magique de la psychanalyse était flatteur, nous devenions plus intelligents !
J’avais appris à l’université l’imagination romanesque de Freud, et a contrario de certains collègues, la « psychanalysation » de notre foyer d’action éducative ne me subjuguait pas du tout. Je me permis, bien au contraire, de contester les hypothèses « psy » de plus en plus prégnantes. En France, notre institution était la première à organiser des « groupes psy » pour jeunes délinquants. Il s’agissait de groupes de psychothérapie « Rêve éveillé dirigé de Desoille » où nos ados étaient censés s’exprimer librement, par l’imaginaire, par la parole, sous forme d’associations libres ou par le dessin, pour dévoiler symboliquement aux deux psychothérapeutes la réalité de leur inconscient… Le retour du refoulé ainsi joué participerait au changement de comportements tant espéré. J’étais invité à quelques séances, mais je fus rapidement mis de côté, j’avais l’impudence de demander, après les séances, quel était le lien entre ces savantes interprétations et la réalité des comportements, voire des changements espérés.
Mes questions étaient mal reçues, il apparaissait que je n’y comprenais rien, j’avais pourtant la formation adéquate pour saisir l’insaisissable… Devant mon insistance à savoir comment ces « groupes psy » fonctionnaient dans le réel, la réponse fut mon exclusion définitive des séances. Cependant, d’un naturel tenace, je poursuivais mes questionnements, les répliques étaient toujours les mêmes : « Il se passe quelque chose de plus fort que le réel, nos ados...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Introduction
- Chapitre 1 - Faut-il oublier la psychanalyse freudienne ?
- Chapitre 2 - La psychanalyse freudienne est-elle « hors sujet » ?
- Chapitre 3 - Pour une psychanalyse « actuelle » et « concrète »
- Chapitre 4 - La force du conscient…
- Chapitre 5 - Pour une psychothérapie existentielle
- Chapitre 6 - La psychothérapie cognitive est-elle existentielle ?
- Chapitre 7 - La déconstruction existentielle
- Chapitre 8 - La reconstruction de soi
- Conclusion
- Table
- Du même auteur chez Odile Jacob