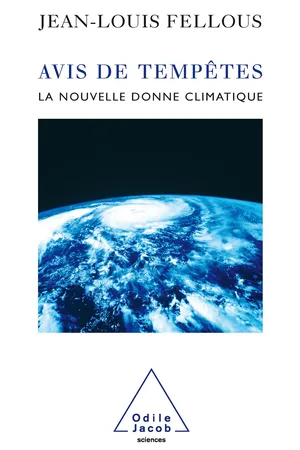
- 336 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Un spectre hante le monde : celui du changement climatique. Qu'en est-il vraiment ? Allons-nous vers un réchauffement global ? À quelle échéance ? Quelles en sont les causes ? Quelles en seront les conséquences sur notre vie et celle de nos enfants et petits-enfants ? Pour mieux comprendre les phénomènes qui donnent son visage au climat de la Terre ; pour faire le point des certitudes qui entourent la question de son altération durable ; pour réfléchir à une action concertée à l'échelle mondiale. Parce qu'il est peut-être encore temps... Jean-Louis Fellous a été président du Comité mondial des satellites d'observation de la Terre et secrétaire du Comité national français des recherches sur les changements globaux. Il est directeur des recherches océaniques à l'IFREMER.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Avis de tempêtes par Jean-Louis Fellous en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Biological Sciences et Environmental Science. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Annexe 1
Les grands programmes spatiaux
relatifs au climat
relatifs au climat
Il n’est pas question ici de recenser la totalité des programmes spatiaux concernant le climat, mais de donner une idée des grandes orientations adoptées par les principales agences spatiales, et de montrer l’originalité de certaines approches.
Les États-Unis : NASA, NOAA et USGS
À tout seigneur, tout honneur. À plusieurs égards, les États-Unis ont été les pionniers de l’observation de la Terre, les rôles se partageant entre la NASA, chargée de la recherche et du développement des nouveaux systèmes, et la NOAA, responsable de la définition et de la mise en œuvre des systèmes opérationnels météorologiques GOES (deux satellites géostationnaires) et TIROS (deux satellites en orbite polaire héliosynchrone du matin et de l’après-midi). À côté des programmes civils, le ministère de la Défense (DoD) utilise ses propres satellites météorologiques en orbite polaire, les DMSP, dont certaines données sont déclassifiées au bout d’un certain temps, et l’US Navy expérimente des systèmes de télédétection océanique, comme les satellites Geosat. Le tout dans une furieuse ambiance de compétition, qui aboutit parfois à tuer des programmes civils au profit de projets du DoD, ce qui faisait dire au professeur Carl Wunsch, éminent océanographe du MIT : « Ils veulent classifier la Terre ! »
Les États-Unis, lassés de supporter seuls l’effort de maintenir deux satellites météorologiques civils (et deux satellites militaires) en orbite polaire, ont profité au début des années 1990 des discussions autour de la station spatiale internationale et de la concertation au sein du G7 pour amener l’Europe à partager le fardeau. Celle-ci s’est engagée à fournir un des deux satellites en orbite polaire, celui du matin (heure locale de passage à l’équateur : 9 h 30), les Américains continuant d’approvisionner le satellite de l’après-midi (13 h 30), tout en partageant l’effort au niveau des instruments, de manière à garantir la cohérence des observations. Ce système, initialement prévu pour 2003, doit entrer en service d’ici la fin 2005, en raison de retards et d’incidents de développement des systèmes.
Plus récemment, la possibilité d’une convergence entre les filières météorologiques civiles et militaires américaines s’est matérialisée, après de nombreuses tentatives avortées, et l’on s’achemine vers la mise en place à l’horizon 2010 du système NPOESS (National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System), étudié conjointement par une équipe mixte NASA-NOAA-DoD. Le système global d’observation météorologique en orbite polaire comportera alors trois satellites, deux NPOESS américains (5 h 30 et 13 h 30) et le METOP européen (9 h 30).
La NASA a placé une haute priorité sur son programme scientifique d’observation de la Terre, baptisé successivement Habitabilité globale de la Terre, Mission vers la planète Terre, et plus récemment Entreprise Sciences de la Terre, au gré des modes verbales. On doit à la NASA de nombreuses innovations : la mission Seasat, première expérimentation de capteurs actifs pour l’observation océanique, précurseur des satellites Topex/Poséidon et ERS, de l’instrument NSCAT, de QuikScat ; la mission UARS, qui a apporté des mesures d’une qualité et d’une longévité exceptionnelles sur la chimie et la dynamique de la haute atmosphère ; TRMM (en collaboration avec le Japon), première mission de mesure des précipitations par radar embarqué sur satellite ; et enfin, l’ambitieux programme EOS. Initialement conçu dans le contexte de la station spatiale internationale, sur fond de plates-formes prétendument visitables et réparables en orbite, prévues pour fonctionner pendant quinze ans, ce projet a réussi à capter un budget formidable, et évolué ensuite vers un système de trois plates-formes, Terra, Aqua et Aura, dont les lancements s’échelonnent entre 1999 et 2002. Chacune de ces plates-formes emporte une cargaison d’instruments innovants, délivrant quotidiennement vers le sol des gigabits (milliards d’informations élémentaires) de données, et dont les mesures complémentaires permettent une étude multidisciplinaire des phénomènes climatiques.
Très soucieuse de coopération internationale, la NASA accueille sur ses missions des instruments passagers fournis par des partenaires, le Canada, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, et donne libre accès aux données acquises pour toute la communauté scientifique mondiale, un bon moyen au passage pour drainer vers les États-Unis les meilleurs chercheurs et les étudiants les plus brillants, formés en Europe, en Chine ou en Inde, et qui vont renforcer les équipes universitaires américaines. Un nouveau concept de « coopérative » a été lancé par la NASA, avec le projet GPM (Mesure globale des précipitations). Se fondant sur le succès de TRMM, qui combinait les observations d’un radar et d’un radiomètre hyperfréquences passif, à partir d’une plate-forme en orbite basse à faible inclinaison, elle suggère de former une constellation de huit satellites en orbite polaire, dont un minisatellite doté d’un radar, et sept microsatellites emportant des radiomètres passifs identiques. Le radar permettrait d’étalonner les mesures passives, comme TRMM l’a démontré, et l’ensemble assurerait une couverture planétaire avec la résolution spatiale et temporelle requise pour l’observation de phénomènes aussi intermittents et fragmentés que les pluies. La « coopérative » serait constituée par les contributions volontaires de plusieurs pays, chacun contribuant, qui un ou plusieurs satellites, qui une station de réception, qui des moyens d’étalonnage et de validation au sol.
Le plan stratégique de la NASA (« À la découverte de notre maison planétaire »), publié au début de l’année 2001, est complètement organisé autour des questions du changement climatique, et de l’application des sciences de la Terre à la solution des problèmes pratiques de la vie sur la Terre. Pas moins de 23 missions sont programmées au lancement de 1999 à 2003, avec quelques premières attendues : un lidar pour la détermination du profil vertical des nuages et des aérosols (Calipso, en coopération avec le CNES), des radars pour la cartographie tridimensionnelle des nuages (Cloudsat), pour la détermination fine de la topographie des terres émergées (SRTM, en coopération avec l’Allemagne, qui a volé sur la navette spatiale au début 2000), et encore Triana, un satellite d’imagerie placé au point de Lagrange L11, à un million de kilomètres de la Terre, permettant de surveiller en permanence la face éclairée de la Terre, et dont les images seront disponibles en temps réel sur Internet !
On peut critiquer la NASA, et certains ne s’en privent pas. J’ai entendu de nombreux collègues américains se plaindre de son goût pour le spectaculaire (« Dire qu’elle a travaillé si longtemps et dépensé tant d’argent pour être seulement capable de poser des questions ! »), de son inconstance (« Elle change de plan stratégique tous les ans ! »), des échecs, de la disproportion entre le coût des engins spatiaux et les moyens budgétaires et humains disponibles au sol pour la recherche (ce n’est pas une spécialité américaine). Force est cependant de reconnaître les succès remarquables de cette agence, qui tire véritablement les efforts mondiaux dans ce domaine.
Quelques mots enfin à propos d’une autre agence, l’USGS, un peu l’équivalent de notre Institut géographique national et de notre Bureau de recherches géologiques et minières réunis, qui hérite désormais de l’exploitation des satellites Landsat, dont le dernier exemplaire, Landsat 7, lancé en 1999, fournit une couverture globale de la Terre à partir de ses caméras optique et infrarouge, avec une résolution de 30 mètres. L’avenir de la filière Landsat n’est pas assuré, l’administration hésitant entre la poursuite d’un financement public, le transfert total ou partiel à l’industrie privée — qui n’est guère partante, vu l’atonie du marché — et la recherche d’une coopération internationale. Ce type d’imagerie à résolution fine, comparable à celle des satellites SPOT-1 à SPOT-4, concurrencé par la nouvelle génération de satellites à résolution métrique, intéresse une « clientèle » avant tout publique, peu solvable, et le produit de la vente des images ne permet en aucun cas de récupérer l’investissement, tout au plus de couvrir les frais d’exploitation.
L’idée se répand de plus en plus que ce service devrait être assimilé à celui des satellites météorologiques, payés par les contribuables et contribuant au bien public. L’élargissement de l’assiette des contributeurs, par l’internationalisation de ces systèmes, pourrait alors aider à en assurer la pérennité. Cette idée fait son chemin, mais elle ne débouchera sans doute pas avant une dizaine d’années, en raison des illusions persistantes çà et là sur la réalité du marché de l’imagerie satellite, des concurrences industrielles et des fiertés nationales. C’est pourtant, à mon avis, la voie du bon sens et de l’avenir, dans le cadre d’un système financé à parité par l’Europe et les États-Unis, à l’image du système météorologique en orbite polaire.
L’Europe
Le tableau européen ne brille pas par sa simplicité. Première grande agence spatiale en Europe, le CNES, « agence française de l’espace », a été à l’origine de l’effort européen, avec le développement de la famille de lanceurs Ariane, dont elle assure la responsabilité du développement pour le compte de l’Agence spatiale européenne, l’ESA (European Space Agency). Tous les grands pays européens se sont dotés d’une agence spatiale : le DLR en Allemagne, qui regroupe les activités aéronautiques et spatiales ; l’ASI italienne, qui fait montre de grandes ambitions, malgré la minceur de ses effectifs ; le BNSC britannique, réduit à un bureau de petite taille, mais s’appuyant sur de puissants centres de recherche techniques et scientifiques. Ailleurs, des ministères assurent la gestion de la participation de leur pays à l’ESA, qui rassemble quinze pays membres2, et a passé des contrats d’association avec plusieurs autres pays. Naturellement, rien n’est simple, et la carte des pays membres de l’ESA ne recouvre pas celle des quinze pays membres de l’Union européenne. C’est l’un des dossiers auxquels travaillent l’ESA et l’Union européenne, avec l’ambition de faire rapidement de l’ESA l’agence spatiale de l’Europe.
L’Agence spatiale européenne (ESA)
Les programmes de l’ESA en matière d’observation de la Terre couvrent d’abord la météorologie, avec la famille METEOSAT, suivie d’un programme METEOSAT de deuxième génération (MSG), la responsabilité des opérations ayant entre-temps été transférée à l’agence européenne EUMETSAT, qui assure également la maîtrise d’ouvrage des futurs satellites polaires METOP, dont la maîtrise d’œuvre est confiée à l’ESA. D’autre part, l’ESA, qui n’est à y regarder de près qu’un mécanisme financier de répartition permettant à ses membres d’entreprendre des programmes hors de portée de chaque État en soutenant leur industrie nationale, ne dispose pas pour l’observation de la Terre d’un programme obligatoire permettant de maintenir un effort cohérent. L’exécutif de l’ESA propose aux États membres des programmes optionnels, qui ne sont engagés que s’il se trouve une majorité de participants prêts à y investir un montant suffisant. S’ajoute à cela une méfiance des autres États européens à l’égard de la France, première puissance spatiale européenne, suspectée de dicter sa loi, non seulement sur le terrain des lanceurs, mais aussi celui des systèmes orbitaux. D’où le refus essuyé par celle-ci lorsqu’elle avait proposé en son temps d’européaniser le système SPOT. Ce mécanisme pervers et cette hostilité latente ont conduit l’ESA à se concentrer sur l’imagerie radar, là où la France mettait l’accent sur l’imagerie optique, et à proposer des systèmes spatiaux « attrape-tout », capables de plaire simultanément aux quatorze pays membres, au détriment de missions optimisées autour d’un objectif scientifique précis. Malgré ces contingences, le programme de satellites radars à finalité océanique ERS a été une réussite, quelque critiquable qu’en ait été le montage. Assez curieusement, sa réussite a été davantage du côté de l’observation radar des terres émergées et des glaces ou de la mesure de l’ozone stratosphérique par l’instrument GOME sur ERS-2, que du strict point de vue de l’océanographie, sa mission principale à l’origine ! On ne peut que se féliciter du succès d’ENVISAT, monstre de 8 tonnes, embarquant dix instruments sophistiqués, décidé dans l’euphorie des plates-formes géantes, cent fois retardé, finalement lancé le 1er mars 2002, et qui aura coûté à l’Europe 2,4 milliards d’euros. Jusqu’au magnifique lancement par Ariane 5, auquel j’ai eu le privilège d’assister depuis Kourou, et à la mise en service impeccable du satellite et des instruments, je n’ai pu me défaire d’une impression de froid dans le dos en pensant aux risques d’un échec prématuré.
Une situation nouvelle règne à l’ESA depuis 1999, date à laquelle le conseil de l’ESA au niveau ministériel a décidé, à l’instigation de la France, d’engager un nouveau programme dit « enveloppe », permettant d’assurer un choix de missions sélectionnées sur la base de leur mérite scientifique, et une continuité du programme à opposer aux décisions au coup par coup qui était précédemment la règle.
Le programme Planète vivante
Dès sa première phase (1999-2002), ce programme dénommé « Planète vivante » a vu l’engagement de la mission GOCE, qui va permettre la détermination fine du géoide terrestre aux grandes longueurs d’onde, complétant les observations altimétriques, et permettant de séparer les grands courants océaniques des inhomogénéités du champ de gravité de la Terre. Cette mission sera suivie d’AEOLUS, un lidar à effet Doppler qui permettra pour la première fois la mesure d’une composante du profil de vent dans l’atmosphère, le rêve des météorologistes et des dynamiciens. D’autres missions de taille plus modeste, mais non moins ambitieuses sur un plan scientifique, sont aussi décidées : CRYOSAT va cartographier les calottes polaires, SMOS mesurer l’humidité des sols et la salinité superficielle des océans, deux grandeurs jusqu’ici hors d’atteinte de l’observation spatiale. Ce programme se profile donc comme une grande réussite, et place l’Europe en bonne place pour éclairer par l’observation spatiale les incertitudes du climat.
Une deuxième phase du programme Planète vivante a été proposée en novembre 2001, pour cinq ans, avec de nombreux projets en perspective. La première phase avait été souscrite en 1999, pour un montant d’environ 610 millions d’euros. Le succès du programme permettait d’espérer une croissance significative de ce montant. Lors d’un colloque tenu à Grenade fin octobre 2001, destiné à recueillir l’avis de la communauté scientifique européenne sur le choix des prochaines grandes missions du programme, une déclaration fut adoptée unanimement par les quelque 250 chercheurs présents, qui demandait en substance aux ministres réunis en novembre à Edimbourg, pour le Conseil qui procède tous les 3 ou 4 ans aux grands arbitrages, de donner enfin aux sciences de la Terre un budget et un statut analogues à ceux dont jouissent les autres sciences spatiales, astronomie et étude du système solaire. Ces disciplines disposent (et c’est fort bien) d’un programme obligatoire, doté d’un niveau de fin...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Préface
- Préambule
- Remerciements
- Première partie - Les coulisses du climat
- Deuxième partie - Le constat
- Troisième partie - Les outils
- Quatrieme partie - Les impacts
- Conclusion - Il n’y en a qu’une, c’est la Terre !
- Annexe 1 - Les grands programmes spatiaux relatifs au climat
- Annexe 2 - La déclaration d’Amsterdam sur le changement global (juillet 2001)
- Bibliographie sommaire
- Glossaire des principaux termes techniques et abréviations
- Index