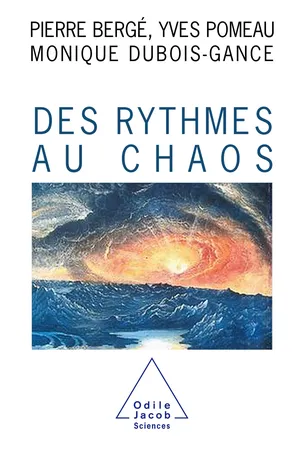
- 296 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Des rythmes au chaos
À propos de ce livre
L'essor prodigieux de la science contemporaine laisse penser que les phénomènes de la nature sont prédictibles. Cette maîtrise du futur, réelle dans bien des domaines, a cependant des limites. Même les systèmes dynamiques les plus simples peuvent manifester une évolution chaotique. Pourquoi ce chaos ? Intervient-il dans notre environnement quotidien et quelles en sont les conséquences ? Comprend-on mieux aujourd'hui la nature du hasard ?Pierre Bergé et Monique Dubois-Gance sont chercheurs physiciens au Commissariat à l'énergie atomique. Yves Pomeau est directeur de recherche au CNRS.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Des rythmes au chaos par Pierre Bergé,Yves Pomeau,Monique Dubois-Gance en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Physical Sciences et Atomic & Molecular Physics. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
Autrefois le temps
« Le temps, cette image mobile de l’immobile éternité. »
Jean-Baptiste ROUSSEAU (d’après PLATON)
En 1817, Germaine Necker, baronne de Staël, confiait, à l’approche de la mort et alors qu’elle avait seulement cinquante et un ans, que la vie lui avait paru longue tant elle avait créé à travers l’écriture et vécu d’événements divers au cours d’une existence mouvementée.
La notion du temps qui passe est variable d’un individu à l’autre. Pour chacun, elle change selon l’âge ou le moment. Au cours de notre vie, l’enfance est une période bénie où le temps paraît s’étirer longuement, quasi immobile (en était-il de même au début de l’humanité ?) ; puis, il s’accélère avec les années. Suivant nos actions ou nos émotions, nous pouvons avoir l’impression que le temps s’emballe ou, au contraire, qu’il ralentit, d’autant plus si nous sommes passionnés par ce que nous vivons. On parle ainsi de temps psychologique. Mais notre notion du temps n’est pas seulement liée à notre vie intérieure. Elle varie aussi avec notre culture, car elle se nourrit de la mémoire collective et de ses repères objectifs. Ces repères ont beaucoup évolué depuis le début de l’humanité. Le temps a donc une histoire.
Le temps immobile
Les hommes de l’Antiquité n’avaient probablement pas la même notion du temps que nous, mais, à l’échelle d’une vie humaine, les repères essentiels étaient les mêmes que les nôtres, c’est-à-dire le jour et l’année. L’activité, principalement agricole, était rythmée par le lever et le coucher du Soleil et par la succession des saisons qui conditionnaient les travaux. C’est ainsi que le calendrier égyptien n’avait que trois saisons : l’inondation (la période des crues du Nil), l’été et l’hiver.
Ces repères, jour, année, etc., tiraient leur origine des premiers phénomènes périodiques que les êtres humains aient pu observer, ceux que l’astronomie nous fournit de manière immédiate : rotation de la Terre autour de son axe pour le jour, mouvement de la Terre autour du Soleil pour l’année, rotation de la Lune autour de la Terre, etc. En fait, pour les anciens, la Terre était au centre du monde. Cette doctrine géocentriste, défendue pendant des siècles, a été élaborée par Ptolémée. Claude Ptolémée, astronome, mathématicien et géographe grec, probablement membre de l’école d’Alexandrie, plaçait en effet la Terre au centre du monde. Dans le Planisphœrium Ptolemaicum, sept sphères centrées sur la Terre servaient à décrire, dans leur ordre respectif, les mouvements de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne ; une huitième sphère – dite « sphère des Fixes » – portait les étoiles (voir figure 1). Ces mouvements des corps célestes se répétaient à l’infini selon un rythme immuable.

Fig. 1 – Système de Ptolémée.
Palais de la Découverte.
Sans doute les astronomes des époques anciennes n’avaient-ils pas l’intuition que cet ensemble de mouvements pouvait être quasi périodique, c’est-à-dire que la périodicité du Soleil et celle des astres pouvaient être dans un rapport qui ne fût pas un nombre entier ou rationnel. C’est pourtant le cas dans le déroulement du calendrier pour lequel les « unités » de base dans le calcul du temps sont le jour et l’année et dont le rapport des durées astronomiques est 365,242... La partie non entière de ce rapport est à l’origine des années bissextiles : ajouter un 366e jour permet de rattraper presque parfaitement1, tous les quatre ans, le retard pris sur une année de 365 jours par rapport à un tour complet de la Terre sur l’écliptique. Si l’on se réfère à la chronologie égyptienne, l’année comptait invariablement 365 jours ; de ce fait, les saisons se décalaient d’année en année par rapport au calendrier à raison de un jour tous les quatre ans. (Un décalage de six mois du calendrier égyptien par rapport au temps réel astronomique – plein été en « janvier » – se faisait en 730 ans.) Ce fait a été utilisé par les égyptologues pour dater certains événements. En particulier, les anciens Égyptiens étaient très attentifs au mouvement de l’étoile Sothis, que nous nommons aujourd’hui Sirius. Quand le lever de cette étoile avait lieu juste avant celui du soleil, cela annonçait la crue imminente du Nil ; aussi cet événement important est-il parfois indiqué sur des documents avec la date du calendrier de l’époque. Si l’on sait que ce phénomène astronomique – lever héliaque de Sirius – se produit régulièrement à une date correspondant au 19 juillet du calendrier julien, le décalage de la date de cet événement dans le calendrier des Égyptiens par rapport à une date connue permet de situer, à quatre ans près, les événements concomitants.
Dans les travaux des champs, l’importance de la longueur du jour en tant que période éclairée par le soleil a conduit à une subdivision journalière du temps en douzième de la durée écoulée entre lever et coucher du soleil d’une part, coucher et lever du soleil d’autre part. L’heure de jour et l’heure de nuit n’étaient donc égales qu’à l’équinoxe, et leurs longueurs variaient d’un jour à l’autre. Cette pratique de division du temps a persisté jusqu’à une époque relativement récente. Au XIIIe et au début du XIVe siècle, donc jusqu’à l’apparition des premières horloges mécaniques, précurseurs des garde-temps précis et réguliers que nous connaissons, les horloges donnaient une heure « temporelle », douzième de la longueur effective du jour, entre lever et coucher du Soleil. Si cette manière de comptabiliser le temps n’était pas simple à mettre en pratique, elle était très proche du rythme de la nature et a été utilisée dans de nombreuses civilisations. On peut trouver2 des descriptions de clepsydres (horloges hydrauliques) très sophistiquées, construites au Moyen-Orient, et qui donnaient des heures temporelles. Ces dernières ont également rythmé la vie au Japon jusqu’à une date assez proche.
Origine du monde, origine du temps
Le retour du jour et des saisons a donné pendant longtemps une perception globale du temps qui, à l’échelle de la vie du Cosmos et de la Terre, se référait à un monde immuable, où les astres tournaient indéfiniment autour de la Terre, centre du monde. La question sous-jacente du commencement, de la naissance de cet univers, trouvait sa réponse dans les croyances religieuses.
En ce qui concerne l’Égypte ancienne, le symbole de la création du monde est constitué d’une crête de limon émergeant des flots. D’après Hérodote, le delta du Nil s’était probablement formé par comblement d’un ancien golfe au cours de l’accumulation d’alluvions charriées par le fleuve. Il est donc possible que les premiers habitants de l’Égypte aient pu contempler des îlots de terre apparaissant progressivement au-dessus des eaux, et que les croyances de l’Égypte ancienne aient trouvé là leur origine : une étendue aqueuse inerte précédait la création, et le Dieu créateur initial, Neith, était assimilé à la « Terre émergeant de l’eau ». Cette première étape de la construction du monde était suivie d’événements dont les détails dépendaient des centres religieux où ils étaient développés.
À Héliopolis, qui célébrait le culte du dieu soleil Rê, un système théologique très intellectuel et de pure logique avait été développé pour expliquer les origines du monde. Atoum, divinité solaire qui émerge du chaos3, va être l’auteur de toute la création à la suite de la naissance d’un couple lui-même créateur : Shou (l’air) et Tefnout (l’humidité), ce couple engendrant à son tour Geb (dieu de la Terre) et Nout (princesse du Soleil).
À Hermopolis, autre centre religieux, la tradition enseigne que quatre couples de divinités fondamentales naissent du chaos aquatique ou océan primordial. D’un œuf mystérieux jaillit le Soleil qui s’élance aussitôt dans l’espace. Une autre tradition du même centre imaginait, plus poétiquement encore, la naissance du Soleil à partir d’un calice de lotus flottant à la surface de l’océan primordial plongé dans les ténèbres.
De nombreux mythes égyptiens, sensiblement différents les uns des autres, tentaient d’expliquer la création du monde. Au-delà des détails, on ne peut manquer d’être frappé par certains de leurs points communs. C’est ainsi que la création s’opère par étapes, mais dans un ordre variable d’un système à l’autre, en particulier en ce qui concerne les êtres animés et le cadre dans lequel ils vont évoluer. Tout ce qui a été créé est sur un même plan – l’homme n’a pas de place à part – et dans un monde sans évolution... le temps est immobile. Autre point commun frappant : l’état initial précédant la création du monde est l’océan (ou le marais) primordial, milieu inorganisé, plongé dans les ténèbres et dans le chaos originel. L’îlot de terre émergeant de cet océan initial illustre en quelque sorte l’ordre émanant du chaos, préfigurant de façon évidemment bien vague une notion moderne que nous retrouverons comme un leitmotiv tout au long de cet ouvrage. Certains sages d’hier n’avaient-ils pas des intuitions remarquables ? Un autre exemple en est fourni par l’image des ténèbres primordiales soudain déchirées par la lumière. On pense au moderne Big Bang. On peut remarquer, par ailleurs, que le chaos est souvent figuré par une masse d’eau (océan, marécage, etc.). Or on sait aujourd’hui que l’état liquide correspond à un état fort désordonné à l’échelle des molécules dont l’agitation est, depuis Boltzmann, représentative du « chaos moléculaire ».
Chez les Grecs aussi, l’état primordial était le chaos, matière de forme vague mais contenant les principes du Monde. D’après la mythologie, ce chaos engendra la Nuit (sous forme d’une déesse des ténèbres). Ici encore, nous trouvons que les ténèbres ont précédé toute chose. La Nuit engendra à son tour les Cieux et le Jour (en fait, la lumière). La Terre naquit alors, et d’elle, l’Homme. De nombreuses divinités naquirent ensuite. Deux d’entre elles méritent plus particulièrement notre intérêt.
Divinité aveugle et inexorable, le Destin représente tout ce qui arrive dans le monde. Il est frappant de noter que les lois du destin étaient écrites de toute éternité en un certain lieu, malheureusement seulement accessible aux Dieux ! Ne faut-il pas voir dans cette croyance un très proche antécédent du déterminisme de Laplace4 énoncé de manière scientifique plus de deux mille ans plus tard ?
L’autre divinité, Cronos5, dieu cruel, mérite aussi notre attention. En effet, à l’exception des trois fils sauvés par son épouse (Zeus, Poséidon et Hadès qui, assimilés à Jupiter, Neptune et Pluton chez les Romains, donnèrent leur nom aux planètes les plus extérieures du système solaire), tous les autres furent dévorés avidement par leur père. Le point intéressant pour nous est que l’allégorie de Cronos (Saturne dans la mythologie latine) dévorant ses enfants représente le Temps qui consomme avec avidité les années qui s’écoulent.
La Bible a, elle aussi, sa description de la création divine du monde. Certains points sont communs avec les civilisations dont nous venons de parler, et la présence du chaos originel semble être une constante d’importance. La création du monde en six jours, divins certes, a été à l’origine de croyances persistantes sur le très jeune âge de notre planète. Cela paraît peu croyable aujourd’hui, mais ce n’est que vers le milieu du XIXe siècle que la Genèse a été définitivement abandonnée comme repère dans la connaissance de l’âge de la Terre. Claude Allègre rapporte6 que, vers 1540, une étude approfondie de textes grecs, égyptiens et chrétiens avait conduit à la certitude que la Terre avait été créée en l’an 4004 av. J.-C. Très précisément le 26 octobre à 9 heures du matin ! L’histoire de l’humanité s’étalant sur quelques milliers d’années, on pensait que l’histoire de la Terre lui était parallèle, comme le laissaient supposer les écrits de l’Ancien Testament.
De la prédiction dans les temps anciens
Au-delà des observations, une certaine maîtrise dans l’évaluation du temps et la reconnaissance de périodicités remarquables devait naturellement entraîner l’homme à faire des prédictions. Certaines furent réussies dès l’Antiquité. Thalès, dont le nom est immortalisé par un classique théorème de géométrie, aurait prédit des éclipses dès 640 av. J.-C. Hipparque, vers 140 av. J.-C., a prédit les éclipses de Soleil et de Lune devant se produire dans les six cents ans à venir. En Égypte, les crues du Nil étaient annoncées par une certaine position de Sirius par rapport au Soleil. Plus généralement, l’observation du ciel permettait de prévoir de nombreux phénomènes, dont le retour régulier des saisons. Dès lors, la répétition des événements astronomiques devait conduire les hommes des premières civilisations à la notion de relation de cause à effet et à l’utilisation du passé pour prédire l’avenir. Par une extrapolation logique, pourquoi ne pas associer le sort des hommes et de la Terre entière à la position des astres ? C’est ainsi que les anciens se servaient de certains livres, les éphémérides, constitués de tables astrologiques calculées par des mathématiciens. Avant de se lancer dans un quelconque projet, une consultation des éphémérides était hautement recommandable, les plus réputées étant dues à un astronome égyptien, Pétosiris. Mais force a été de reconnaître que la plupart des événements, dont certains majeurs, ne pouvaient être prévus par cette méthode car, comme l’on sait, l’incertitude domine aussi bien la vie individuelle que le comportement social ou celui de la Nature. Cette situation, peu confortable devant l’avenir inconnu, a promu le développement d’un palliatif, toujours présent dans nos sociétés et que les rationalistes considèrent7 comme injustifié. Il consistait à s’adresser à des devins et à des oracles de tous ordres pour lever cette troublante incertitude et aider la prise de décisions. Une autre attitude, plus résignée, consiste aussi à attribuer à la volonté de Dieu ou des dieux les événements qu’on n’a pu prévoir. Cette attitude n’est d’ailleurs pas antinomique de celle consistant à faire appel à la divination car, dans l’Antiquité, beaucoup de devins...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Introduction
- CHAPITRE 1 - Autrefois le temps
- CHAPITRE 2 - De notre temps
- CHAPITRE 3 - Regards sur un passé terrestre
- CHAPITRE 4 - Une loi simple... un comportement complexe
- CHAPITRE 5 - Les rythmes des horloges : le temps régulier
- CHAPITRE 6 - Les horloges en compétition : le temps dévié
- CHAPITRE 7 - Chaos et attracteurs étranges
- CHAPITRE 8 - Phénomènes périodiques naturels
- CHAPITRE 9 - Météorologie
- CHAPITRE 10 - Rythmes du monde vivant
- CHAPITRE 11 - Vers les comportements collectifs
- CHAPITRE 12 - Une petite histoire du chaos
- Versets chaotiques
- Annexe - Des oscillateurs simples et leur géométrie de phase
- Dans la collection « Opus »
- Table