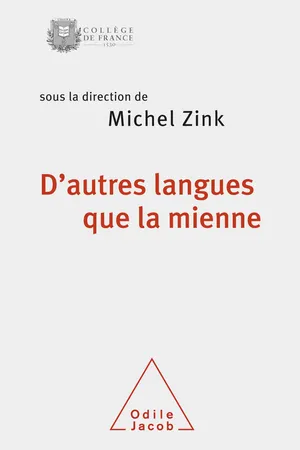
- 288 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
D’autres langues que la mienne
À propos de ce livre
Écrire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle : du Moyen Âge à l'époque contemporaine, de nombreux poètes ou romanciers l'ont fait, par choix ou par contrainte. Dans maintes civilisations, la vie intellectuelle et la littérature ont même eu recours avec une sorte d'aisance naturelle à une langue étrangère ou apprise : le grec pour les Romains, le chinois pour les Japonais, le latin pour l'Occident médiéval. Écrire dans une autre langue, c'est s'arracher à soi-même, ou simplement se partager : la langue du poète, la langue du mathématicien ne relèvent-elles pas de la catégorie des langues autres ? Et la langue maternelle peut, elle aussi, se faire « autre » : lorsqu'elle est dévoyée ; ou lorsqu'elle est consciemment choisie et modelée ; ou lorsqu'elle préserve au sein de l'écriture la langue de la tribu, de l'enfance, de la fratrie. Ces questions se posent à tout écrivain si, comme l'écrit Proust : « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. » Michel Zink, spécialiste de littérature médiévale, est membre de l'Institut et professeur au Collège de France. Avec les contributions de Jean-Paul Allouche, Odile Bombarde, Yves Bonnefoy, Pascale Bourgain, Antoine Compagnon, Sir Michael Edwards, Marc Fumaroli, Claudine Haroche, John E. Jackson, Jacques Le Rider, Jean-Noël Robert, Luciano Rossi, Karlheinz Stierle.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à D’autres langues que la mienne par Michel Zink en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Languages & Linguistics et Psycolinguistics. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
À CÔTÉ DE LA LANGUE MATERNELLE
La langue que l’on fait sienne : le latin au Moyen Âge
par Pascale Bourgain
I
Au Moyen Âge, depuis 800 ou un peu plus tard selon les pays, pour une majorité de la population, le latin, c’est bien la langue des autres, ceux qui ont le pouvoir, le savoir, la maîtrise des outils de communication qui servent dans des circonstances précises. Le latin n’est plus la langue naturelle, ou maternelle comme on le dira à partir du XIIe siècle1. C’est une langue qu’il faut apprendre.
Évidemment, au fil du temps, les évolutions sont fortes, qui accompagnent les transformations de la société et l’usage de la langue. De plus, il y a une foule de niveaux, de la compréhension approximative d’un latin d’usage à l’habitude qui vient de la répétition de textes liturgiques dont on finit tout de même par comprendre quelque chose, ainsi que de ceux qui manœuvrent la langue des textes juridiques, mais seraient incapables de comprendre un discours de Cicéron, à ceux qui non seulement le comprennent, mais considèrent le latin comme la langue de leur propre créativité. C’est une époque de cohabitation, caractérisée par une forte perméabilité des langues en contact, un jeu constant dans la recherche de la communication et de l’expressivité, où chaque état de langue a son rôle à jouer, selon les circonstances et les protagonistes2. La continuité conceptuelle et linguistique entre la langue maternelle, surtout si elle est d’origine latine, et la langue savante nous apparaît de plus en plus.
Le statut effectif du latin est compliqué par le phénomène, parallèle mais non superposable, de la connaissance de l’écriture et de la capacité de lire, puisqu’elle est très longtemps liée dans les esprits et dans les faits à la langue écrite, le latin3. Ceux qui savent lire et écrire, jusqu’au XIVe siècle au moins, sont forcément des latinistes, donc des bilingues. Pourtant les deux notions ne sont pas confondues. Le latin représente la compétence linguistique, la capacité de communication, même si elle reste au niveau des échanges oraux : ainsi les interprètes, même s’ils servent d’intermédiaires entre turc et roman, s’appellent en français au XIIe siècle des « latiniers » ou « latimiers »4, et les oiseaux, c’est bien connu, chantent en leur latin, c’est-à-dire en leur langue, mais ils n’écrivent pas. D’autre part on a écrit très tôt des gloses en langue vernaculaire, et confié au parchemin des traductions. On apprend en principe à lire et à écrire en latin ; mais, surtout dans les pays germaniques, d’autres apprentissages restaient possibles5. D’autre part le latin entendu, ne fût-ce que par la liturgie, reste proche des oreilles de l’ensemble de la population6, qui devait souvent avoir une sorte de « compétence passive élémentaire7 » lui permettant, surtout en domaine roman, de reconnaître quelques mots et de savoir au moins de quoi on parlait.
Laissons donc de côté ceux qui, tout en comprenant un peu, en étant capables de répéter ou de copier sans trop de précision, comprennent un latin bien prononcé selon leurs propres habitudes et peuvent baragouiner en latin simplifié si c’est nécessaire, comme tous ces gens qui de nos jours, faute d’usage, ne peuvent parler une langue étrangère sans hésitations et sans faute. Convers ou moine ignorants, serviteurs des abbayes ou des suppôts des universités, clercs de chancellerie et probablement aussi certains aristocrates, à partir du moment où l’écrit s’impose dans les actes de la vie courante sans que les langues vernaculaires aient encore fait reculer le latin dans cet usage8, tous ces gens-là ont bien conscience d’utiliser une langue qui n’est pas leur langue naturelle. Mais ce n’est pas une langue étrangère : c’est la langue des puissants et des savants, donc la langue de ceux qui leur sont supérieurs, plus puissants ou plus savants, sur le plan politique et intellectuel ou sur le plan spirituel. La langue étrangère, lingua aliena, peregrina lingua, ce n’était jamais le latin, mais le grec, l’hébreu, éventuellement les langues des peuples non chrétiens, à convertir. À plus forte raison, pour ceux qui s’en servaient, le latin pouvait être senti comme langue de prestige, de savoir, d’usage professionnel, la langue de l’art s’opposant à la langue de la nature, mais pas comme une langue étrangère9. Celui qui le maîtrise considère qu’il a pour lui les atouts qui devraient lui permettre une carrière intéressante et confortable. La maîtrise du latin constitue un critère de supériorité pour ceux qui le pratiquent et assure leur propre développement, vers les honneurs et les charges, ou vers l’accroissement de leur savoir et par là de leur prestige.
Qui parlait le latin ? Les clercs, par définition. Donc, si l’on peut se permettre cette expression anachronique, tous les travailleurs intellectuels : notaires, juristes, enseignants, tous les prêtres, et les moines sauf les frères lais.
Tous les moines n’avaient certes pas fait du latin leur langue de prédilection, si on en juge par les prestations de copistes du sud de la France, par exemple à Saint-Martial de Limoges ; les opinions récentes sur le degré de capacité des moines à s’exprimer en latin varient considérablement, les uns le voyant essentiel dans la communication orale interne10, les autres insistant sur les difficultés du commun des moines et jugeant le latin réservé aux circonstances solennelles11. D’après Guibert de Nogent ou Giraud de Barri, même des personnages avancés dans la hiérarchie ecclésiastique et jusqu’au pape étaient parfois handicapés pour parler le latin (encore que fin XIIe ou XIIIe siècle cela paraît scandaleux, alors qu’auparavant on n’en parle pas parce que cela choquait sans doute moins, étant donné le moindre développement de l’enseignement). Certains prélats, par leurs qualités d’administrateurs ou les droits que leur confère la naissance, peuvent occuper des charges importantes, mais ne sont pas capables de prendre la parole en public sans faire sourire les vrais initiés. Ceux-là ont, de toute façon, comme les grands de ce monde, des collaborateurs, qui pallieront leurs insuffisances en leur soufflant la terminaison juste, à l’oral12, car il faut sauver les apparences, et rédigeront ensuite les écrits nécessaires : il est possible que l’aisance véritable soit chez le secrétaire du cardinal plus que chez le cardinal lui-même, chez le collaborateur efficace plus que chez le décideur.
Le latin est nécessaire aussi dans la vie politique et diplomatique. On apprend le latin aux garçons des familles royales, s’ils ont vocation éventuelle à devenir rois un jour (ainsi les premiers Valois étaient plus ignorants du latin que leurs prédécesseurs de la branche directe, jusqu’à Charles V qui avait été élevé comme héritier du trône). Ces dirigeants n’ont sans doute cessé de considérer le latin comme un outil, à l’exception de quelques rois lettrés, mais en leur qualité de laïcs, ceux-là restent très conscients des problèmes de communication et soutiennent assez volontiers des entreprises de traduction (Asser en Angleterre, Charles V, qui malgré tout devait lire plus volontiers en français). Ce sont leurs collaborateurs, chanceliers, notaires et secrétaires, qui ont une véritable maîtrise de la langue.
Dans des cas extrêmes, ces spécialistes de l’écriture qui écrivaient le latin de préférence le parlaient avec autant de maestria. On admire effectivement les personnes capables de parler le latin avec à la fois autant de rapidité et d’abondance que leur langue maternelle, ce qui leur donne aussitôt un net avantage dans les échanges internationaux, si leurs interlocuteurs, obligés aussi de parler latin, sont moins à l’aise qu’eux13. Les échanges oraux devaient être la plupart du temps relativement simplifiés, puisqu’on signale que tel ou tel personnage, ainsi Suger décrit par Guillaume de Saint-Denis14, parle le latin comme il l’écrit. Cette aisance supérieure devait néanmoins être assez rare. Mais après tout, parler comme on écrit, même dans sa langue maternelle, n’est pas à la portée de tous.
Même dans les milieux étudiants, le latin, langue des cours et des exercices, n’a certainement jamais été la seule langue parlée ; si les étudiants à Paris se sont organisés en nations, la question linguistique y a sans doute une importance, encore que chaque nation regroupât des langues maternelles différentes, comme la nation anglaise qui englobait aussi les Allemands. Les sujets terre à terre étaient sans doute traités dans la langue maternelle entre étudiants de même origine, mais, dès que les échanges avaient un certain degré d’intellectualité, les étudiants se servaient du latin, au moins jusqu’au XIVe siècle, par l’habitude des « disputes », parce que le vocabulaire était plus précis et qu’ils y étaient mieux habitués. La poésie d’origine visiblement scolaire est pratiquement toujours en latin, ou bilingue, les termes grammaticaux, les allusions au monde des écoles sont rares dans des poèmes en langue vernaculaire. Cependant...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Ouverture Quelle langue est la mienne ? - par Michel Zink
- À côté de la langue maternelle
- Ma langue et moi
- Langues poétiques
- Les auteurs
- Dans la même collection
- Table