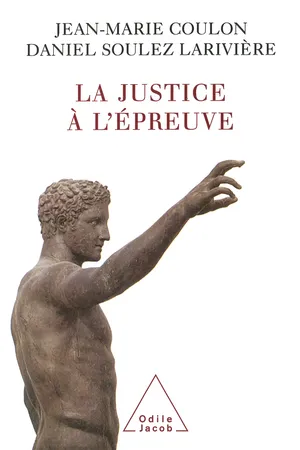
- 336 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
La Justice à l'épreuve
À propos de ce livre
Montée du pouvoir des juges, vieillissement des procédures, surcharge : la justice française est en crise. Mais n'est-ce pas plutôt la France qui découvre les servitudes et les vertus du droit ? Notre justice est-elle prête pour les nouvelles missions que la société lui assigne ? Les juges sont-ils bien choisis et formés pour assumer leur tâche ? Les cours et tribunaux sont-ils adaptés ? Quels sont les autres moyens de résoudre les conflits ? Le système de répression pénale est-il satisfaisant ? L'avènement d'un ordre juridique européen et, au-delà, d'une justice internationale ne constitue-t-il pas une chance pour notre propre appareil judiciaire ? Pour la première fois, un juge et un avocat confrontent sans concession leurs points de vue. Apparemment, tout les oppose : l'exercice de leur métier, la fonction qu'ils remplissent, leur conception du droit. Pourtant, par-delà les différences et les divergences, s'ébauche le portrait de ce que devrait être notre justice. Jean-Marie Coulon, magistrat, est premier président de la Cour d'appel de Paris. Daniel Soulez Larivière est avocat au barreau de Paris.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à La Justice à l'épreuve par Jean-Marie Coulon,Daniel Soulez Larivière en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Law et Law Theory & Practice. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
III
Des juges et des avocats
DANIEL SOULEZ LARIVIÈRE — En France, les juges et les avocats ne constituent pas une communauté. La vraie caractéristique du monde judiciaire français est son sous-développement ; l’un de ses symptômes et de ses ferments est la division. Quatre cours suprêmes coexistent, et chacune représente un monde à part. À côté du Conseil d’État, la cour suprême administrative, on trouve la Cour des comptes, cour suprême financière, le Conseil constitutionnel, cour suprême contrôlant l’application de la norme supérieure : la Constitution ; et la Cour de cassation, cour suprême judiciaire. Plus grave encore, le personnel judiciaire est coupé en deux corps : avocats et juges. Dans nombre d’autres pays, on trouve un seul ordre juridictionnel et une profession judiciaire dont la formation et l’expérience de base sont communes. Leurs rôles respectifs ne se différencient qu’ensuite : après les concours, comme en Allemagne, ou bien après vingt à trente ans d’expérience comme dans le monde anglo-saxon, où les avocats deviennent juges. Dans notre pays, il n’existe pas de communauté juridique. Juridictions et professions sont morcelées. L’antagonisme fonctionnel naturel entre défenseurs et magistrats est envenimé par une hostilité et une incompréhension culturelle entre les deux professions, ce qui génère des conflits absurdes. Le phénomène s’aggrave d’ailleurs. Voilà une faiblesse et un archaïsme qui empêchent l’institution judiciaire d’être à la hauteur de la puissance nouvelle qu’elle est en train de conquérir en France.
JEAN-MARIE COULON — On ne peut que regretter qu’il n’existe pas de communauté entre les juges et les avocats. Des relations politiques, culturelles, économiques expliquent historiquement cette division. Pourtant, l’avocat est le partenaire du juge. Mais, pour le juge, l’avocat est trop souvent celui qui « privatise » le procès, alors que le juge a pour mission d’en réguler le cours et d’assurer le bon fonctionnement du service public. Deux logiques se télescopent : celle de l’intérêt privé et celle du service public. Elles sont contradictoires, mais complémentaires. Cela implique donc que les deux professions collaborent pour que la justice progresse.
Pourquoi échapperait-elle aux « clôtures chères aux Français », selon Jean-François Revel ? En réalité, quand nous parlons des juges, nous parlons des avocats.
D. S. L. — En France, cette coupure se confond avec une confusion des rôles. On oublie trop souvent que le juge est d’abord une personne, qui tranche après avoir écouté deux thèses opposées. On croit trop souvent que les termes de « magistrat » et de « juge » sont synonymes ; on confond alors ceux dont la fonction est de juger et ceux qui représentent le parquet. Le magistrat du parquet est l’avocat de la société. C’est l’avocat de la République, après avoir été celui du roi. Quand, dans son discours de présentation de la réforme judiciaire, le président de la République évoquait en 1996 l’« indépendance des juges », il pensait en réalité à l’indépendance du parquet. De même, un juge d’instruction n’est pas un juge. Il est à moitié juge, à moitié accusateur, « demi-Maigret, demi-Salomon », comme l’a fort bien dit Robert Badinter. Certains juges d’instruction se laissent appeler « juges antiterroristes », ce qui est une aberration : un juge ne peut être « anti ». Soyons clairs : le juge est un décideur, non un administrateur, non un fouilleur de coffres des voitures du Tour de France pour chercher des seringues. Cela, c’est un travail de policier, extrêmement honorable, vers lequel j’encourage beaucoup de jeunes à se diriger ; mais qui n’est pas du même ordre que celui du juge.
Quand on discute avec des jeunes de l’École de la magistrature, comme je le fais souvent, ou avec des moins jeunes, on voit bien qu’ils rapprochent leurs futures activités de celles des fonctionnaires publics. Ils se voient mettant la main à la pâte, enlevant un enfant à son foyer pour le placer ailleurs, décidant et pratiquant une perquisition. Dans leur imaginaire, ils agissent autant qu’ils jugent. D’un autre côté, le monde du barreau leur semble étranger, comme vous le disiez vous-même : d’un côté, le service public, de l’autre, l’avocat, avec, vous le disiez vous-même, son « droit-marché ».
Pourquoi cette situation ? Elle s’explique par des raisons historiques. Blandine Kriegel explique depuis longtemps1 que la France s’est organisée pendant trois cents ans comme un État administratif. En France, État progressivement constitué par une longue conquête de quatre siècles, pays de droit écrit, l’administrateur écoute et décide d’une règle générale a priori. Le fonctionnement naturel de la société dépend d’une régulation a priori. Dans le système britannique de common law, c’est l’inverse qui se produit : la décision a davantage lieu a posteriori, à partir de l’existence d’un problème concret traité par le juge. C’est une question qui a trait à l’histoire de la fabrication de chaque État.
Que se passe-t-il en France aujourd’hui ? L’État, celui des rois, puis celui de la République, centralisé et jacobin ensuite, l’État des IIIe, IVe et Ve Républiques est en train de se déliter. Pour deux raisons : d’une part, les citoyens ne sont plus d’accord pour fonctionner au sifflet administratif ; par ailleurs, la construction européenne mange par le haut la tête de l’État traditionnel tout-puissant. La loi, référence française absolue, ne parvient plus à trouver sa place. Par exemple, depuis quarante-cinq ans, la réforme de la procédure pénale s’est transformée en danse de Saint-Guy. Les parlementaires, malgré leurs efforts louables notamment à travers la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence, demeurent incapables de se mettre d’accord sur un texte de réforme reconstructeur et non point seulement réparateur. Parce qu’ils en sont politiquement incapables. De même pour la réforme des infractions involontaires du 10 juillet 2000. Cette infirmité législative concerne aussi l’Éducation nationale, le ministère des Finances, les retraites, etc. C’est la raison de la montée en puissance du juge. Il devient celui qui agit, l’image de référence, la figure forte. La société moderne impose de produire un travail microsocial de très grande précision ; et c’est à cette occasion que le juge se réfère à de la norme ou en dégage si elle n’existe pas. Le monde moderne a besoin de régulation fine. On comprend que le problème du recrutement du juge, de sa formation, mais aussi de sa légitimité se pose avec une particulière acuité.
Les juges
J.-M. C. — Balzac disait qu’un peuple qui a quarante mille lois n’en a pas. On a beaucoup glosé sur la boulimie législative française. Resituons ce problème dans un cadre civique. Nous vivons actuellement dans une société de juridicisation. Le droit, qui devrait être un socle, ne devient-il pas trop souvent une sorte de dialectique interchangeable, tournant à vide ? Tout le problème de l’égalité des citoyens devant la loi se pose ici. La loi ? Mais on l’applique, aujourd’hui. Ce n’est plus une expression abstraite. Le droit est pris au sérieux, tout comme le juge. Bien sûr, des initiatives sont lancées dans tous les sens, y compris vers une sorte de tentation totalitaire de la vertu. Le désir de transparence paraît très fort. Prenons l’exemple de l’Europe : la Commission européenne alors présidée par Jacques Santer a été mise en cause sur des soupçons de favoritisme qui l’ont conduite à démissionner en mars 1999. La responsabilité politique a joué ; quand un comité de sages a mis en cause le fonctionnement de la Commission européenne, cette dernière a répondu en démissionnant. Si elle ne l’avait pas fait, le risque n’était pas exclu d’une motion de censure au parlement de Strasbourg. Nous avons eu affaire à une justice sans juge. Mais il s’agit d’une forme de justice dans laquelle, qu’on le veuille ou non, l’exigence de transparence a joué. C’est tout de même un hommage rendu au droit. Ce désir de transparence a pour seule réponse l’aspiration au triomphe du droit.
D. S. L. — Bien sûr ! La montée en puissance du juge se voit portée par les progrès de la vertu. Il est exact que, dans l’affaire de la Commission européenne, on a eu l’impression de voir une institution européenne accéder à la responsabilité politique. Le constitutionnaliste Guy Carcassonne me rappelait récemment que, lorsque lord North a perdu les colonies américaines, on ne lui a pas coupé la tête après un procès pénal ; il a démissionné. La responsabilité politique est née à cette occasion en Angleterre. En France, en revanche, après un procès de plusieurs années, on décapita le comte Lally-Tollendal qui avait capitulé dans Pondichéry, en Inde. Sa réhabilitation posthume est intervenue après une campagne d’opinion menée par Voltaire. Ces deux événements se sont déroulés pratiquement à la même époque ! La démission de la Commission européenne, elle, est un début de responsabilité politique qui se distingue de la seule responsabilité judiciaire : elle a émergé spontanément, sans qu’un juge soit intervenu pour l’ordonner ; on ne se trouve pas dans une situation ancienne, quand la perte d’une bataille et l’échec d’une opération sont sanctionnés. Cette fois-ci, on met en cause une institution au nom de la vertu. Le fonds culturel commun a progressé. Dans cet exemple, il s’agit des progrès de la notion anglo-saxonne de conflit d’intérêts encore largement ignorée par la société française. Édith Cresson a ainsi pu expliquer qu’elle ne voyait pas où était le problème puisqu’en France tout le monde procédait de la sorte en faisant payer ses collaborateurs par l’institution. Et elle avait raison ! Les choses se passent effectivement ainsi chez nous. De surcroît, le fonctionnaire français impartial se révèle en réalité très souvent à la fois juge et partie. Cela aussi appartient à notre fonds culturel.
Changeons d’échelle. Évoquons un instant l’intervention militaire de l’OTAN au Kosovo, en 1999. Il y a deux ou trois siècles, personne ne se serait inquiété de ce qui s’y déroulait. Le traité de Westphalie2, par exemple, n’a pas été mis en œuvre sur des principes semblables à ceux qui ont agité les opinions publiques occidentales sur le Kosovo. L’intérêt des grands États, c’est qu’il n’y ait pas d’histoires et que ceux qui se battent cessent de le faire, pour ne point remettre en question les équilibres des grandes puissances. Ce qui a motivé les Américains et les Européens en faveur d’une action militaire est peut-être une représentation populaire de ce qu’il serait vertueux de faire. Reste à définir toutes les composantes de cette « vertu » moderne. J’y vois le progrès de la sensibilité de l’un à la mort de l’autre qui lui est montrée, une réaction immédiate aux images, le mythe de la transparence absolue, une sorte d’universalisation laïque des valeurs du christianisme. Il y a dans cette vertu moderne une part d’imaginaire, une part de rationalité et une autre de « justicialisme » simplificateur et démagogique.
La justice, fondement du lien social
J.-M. C. — La justice, dans notre pays, demeure le domaine du symbolique, voire des passions ; mais une évolution très profonde a lieu. Elle tend à devenir un lieu de fabrication de lien social. Une loi fort importante a été promulguée le 18 décembre 1998, avec pour finalité que chaque citoyen puisse accéder à ses droits et les faire valoir. C’est quelque chose d’extrêmement fort, une forme de consécration de la montée en puissance du droit. De plus, on assiste aujourd’hui, au sein de la justice prise globalement, à une montée des politiques publiques. On demande aux magistrats d’être davantage présents dans la cité. On assiste enfin à une montée de la procédure sous l’impulsion de la Convention européenne, traduite par la Cour européenne des droits de l’homme.
Se repose à cette occasion la question du procès dans nos sociétés. Dans la tradition jacobine française, c’était un acte de souveraineté. On le voit dériver. D’acte de souveraineté, il est en train de devenir un droit subjectif. Un autre élément est la montée de l’éthique, qui n’est autre que la « régulation sociale nue », selon l’expression du professeur Gérard Farjat.
On se trouve, en France, dans une phase transitoire, qui tend vers l’établissement d’une sorte de reconnaissance de la réalité des composantes multiples de la justice.
D. S. L. — Vous avez raison de dire que la justice a changé de fonction. Jadis, elle était essentiellement un acte de souveraineté. Mais aussi un enjeu de souveraineté : nous avons consacré près de quatre siècles à bâtir une justice unique et centralisée pour tout le monde, par-dessus les justices féodales, seigneuriales et ecclésiastiques. L’acte de souveraineté permettait de faire régner l’ordre. Quel est le rôle de la justice ? D’abord au plan pénal, il s’agit de faire en sorte que les déviants soient éliminés, que les « dangereux » soient mis hors d’état de nuire, ceux qui ne veulent pas respecter le pacte social, châtiés ou écartés ; ou, à tout le moins, handicapés. Au plan civil, le rôle de la justice consiste à éviter les conflits entre les personnes privées. Ceux-ci n’intéressent pas l’État, sauf s’il s’agit d’empêcher qu’ils finissent par des incidents violents, générateurs de désordres. La justice est faite pour sauvegarder un cadre de travail pacifique afin que la société puisse prospérer.
Qui sont les gens qui permettent à ce cadre général d’exister ? Ce sont les juges. Si le juge n’est autre qu’un faux nez pour l’État, cela ne marche pas, il n’est pas crédible. Il faut donc qu’il soit indépendant. Mais si, dans ce cas, il se prend pour le pouvoir politique, il risque d’en périr. Quand vous évoquez à juste titre la justice comme lieu de fabrication du lien social, je souhaite y apporter une nuance, car la justice est en fait l’endroit où tout se déchire. C’est une fabrication du lien social pour le moins ambiguë !
J.-M. C. — La création sans cesse renouvelée d’un lien social implique des réformes. Les réformes en profondeur sont certainement plus difficiles aujourd’hui qu’hier. Le socialisme et le libéralisme ont, en quelque sorte, surinvesti les questions économiques et sociales en privilégiant une conception souvent abstraite de la loi. C’est pourquoi il est si difficile d’élaborer des réformes en profondeur. Antoine Garapon souligne très justement que l’on vit actuellement la seconde Révolution française : la révolution par le droit.
D. S. L. — Pourtant, pour la plupart des hommes politiques français, ce que vous dites là est assez difficilement compréhensible. Et pour les Français aussi… Il est assez simple de comprendre que le juge, au cœur de la société, décide. Mais quand on commence à expliquer qu’il décide à partir du droit, c’est déjà nettement plus difficile à comprendre, et souvent même pour les magistrats français. En 1984-1985, lors de l’enquête que j’ai réalisée pour mon livre Les Juges dans la balance, j’ai demandé à un jeune magistrat de vingt-deux ans (auditeur stagiaire dans un tribunal du Sud-Ouest) ce qu’il pensait de ses futurs collègues. Et il m’a répondu : « Le problème, c’est qu’ils essaient de statuer en équité plutôt qu’en droit ; mais, comme ils n’ont pas les moyens de savoir la vérité, ils se plantent. » Cette formule d’un jeune homme très observateur, dont je ne sais pas ce qu’il est devenu, est fort intelligente. Effectivement, le magistrat français n’est pas toujours intéressé par le droit. Il cherche une solution de bon sens, trouve un habit convenable dans la penderie juridique, l’adapte et rend une décision. Trop souvent le raisonnement se trouve donc inversé.
Dans les pays anglo-saxons, les juges savent beaucoup mieux ce qu’est le droit, puisqu’ils le créent. Le problème est d’une nature différente. Jacques Lacan parlait de mathèmes, pour désigner des blocs transmissibles de théorie, permettant de comprendre un certain nomb...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Sommaire
- Introduction
- I - De la crise de la justice, de la loi, du droit, de l’État et de quelques malentendus
- II - Le couple État-justice dans les labyrinthes du changement
- III - Des juges et des avocats
- IV - Un juge pour quoi faire ?
- V - Avec qui juge-t-on ?
- VI - Qui juge-t-on ?
- VII - Comment juge-t-on ?
- VIII - Que faire ?
- IX - L’avenir de la justice
- Conclusion