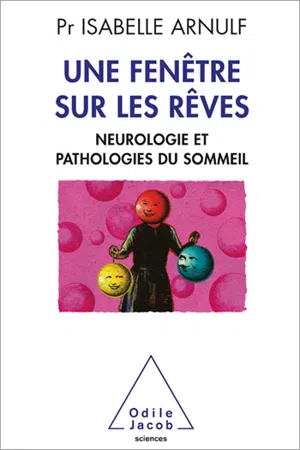
- 224 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Les rêves peuvent-ils être prémonitoires ? Le sommeil guérit-il la maladie de Parkinson ? De quoi sont faits les rêves des aveugles ? Longtemps, le monde des rêves a appartenu aux religieux, aux artistes, aux psychanalystes et à tous ceux qui voulaient y découvrir un sens caché. Pourtant, il existe une approche scientifique des rêves : on peut désormais savoir si hommes et femmes rêvent des mêmes choses, si nous volons tous en rêve ou si nous rêvons tant que cela de sexe. L'étude des rêves permet également de mieux comprendre les maladies du sommeil : hallucinations, somnambulisme, terreurs nocturnes, narcolepsie et trouble comportemental en sommeil paradoxal. Voir un dormeur combattre des lions dans son lit ou fumer une cigarette fictive, découvrir qu'un homme à demi infirme redevient valide lorsqu'il rêve permettent d'en savoir un peu plus sur cette curieuse machinerie qui fait de nous, chaque nuit, la marionnette de notre cerveau. Entre ses expéditions chez les moines contemplatifs qui rêvent du diable, ses patients qui dévorent, endormis, des sandwichs au tabac et ses expériences au laboratoire du sommeil, Isabelle Arnulf ouvre une fenêtre fascinante sur ce nouveau théâtre de la nuit. Le professeur Isabelle Arnulf est neurologue, directrice de l'unité des pathologies du sommeil de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Une fenêtre sur les rêves par Isabelle Arnulf en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Médecine et Physiologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
Comment mesurer les rêves ?
Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec le biostatisticien de notre université, Jean-Louis. Il incarne l’image d’Épinal du mathématicien : de grosses lunettes, une politesse timide teintée d’une grande gentillesse et d’une immense intelligence. Il se prépare à analyser nos résultats grâce à ses puissants logiciels statistiques. Le thème de notre recherche est : les étudiants en première année de médecine rêvent-ils qu’ils échouent au concours avant de le passer ? Et ces rêves prédisent-ils échec ou réussite le lendemain ?
Quand nous arrivons, il sourit : « C’est marrant, ton sujet. Moi aussi j’ai rêvé d’échec avant mes concours en classe préparatoire de mathématiques. Tu sais, j’en ai parlé à ma femme hier soir, qui est médecin elle aussi. Elle m’a dit qu’on pouvait dire tout et son contraire sur le rêve, donc n’importe quoi. Mais moi, tu sais, je ne suis pas d’accord : on peut analyser correctement toutes les données, y compris celles issues de recueil de rêves, pourvu que la méthode de recueil et d’analyse des récits obéisse aux règles de bonne pratique scientifique. »
Depuis que Jean-Louis analyse les données de recherche que nous recueillons, que ce soit des mesures du temps de sommeil, du taux sanguin d’une hormone ou d’une échelle de qualité de sommeil, il sait que nous suivons ces règles. Pourtant, comment les appliquer à quelque chose d’aussi évanescent et subjectif que les rêves ? Comment en étudier les mécanismes ? L’épouse de Jean-Louis, comme beaucoup de Français, n’a probablement été informée que de l’approche populaire ou psychanalytique des rêves, qui n’en mesure ni la production ni les caractéristiques, et ne tient pas compte du récit brut pour lui-même (ce qu’on appelle le contenu manifeste), mais au contraire l’interprète et cherche à lui donner un sens symbolique, qui n’est basé sur aucun élément un tant soit peu validé. Or, avant d’interpréter des données, même subjectives (de nombreux chercheurs travaillent tout à fait sérieusement sur la douleur, qui est par définition une expérience purement subjective !), il faut qu’elles soient recueillies sans biais, de préférence en grand nombre. Il faut également établir ce qui est « normal » (c’est-à-dire ce dont rêvent 95 % de la population) et faire analyser toutes les données de la même manière par différentes personnes. Ainsi, nous verrons par exemple comment les récits de rêve de marche ont été comparés chez les personnes privées de la faculté de se déplacer (soit de naissance, soit suite à un accident) et chez les personnes valides, sans que les personnes analysant les récits ne sachent s’ils émanaient d’une personne paraplégique ou non.
Comment se forme le souvenir
de rêve ?
Lorsque nous dormons, nous rêvons, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de rêver (à l’exception des rêveurs lucides que nous évoquerons au chapitre 12) : nous adhérons à l’histoire de notre rêve comme à un événement en train de se dérouler. Au réveil, nous nous souvenons du rêve ou de certains fragments, puis transformons cette trace mnésique en un récit sous forme verbale ou imagée (bande dessinée, dessin, film). Ainsi, le rêve passe par trois formes : l’expérience du rêve en cours (le rêve vécu), la remémoration du rêve au réveil (le rêve souvenir) et la transcription du rêve en un récit ou sous une autre forme artistique (le rêve récit, sur lequel les chercheurs vont travailler). Le passage du rêve à son compte rendu s’effectue en deux étapes : d’abord le rêve vécu doit être mis en mémoire pour être évoqué au réveil, puis l’évocation du rêve est elle-même décodée par introspection pour prendre la forme d’un compte rendu.
L’étude scientifique des rêves se heurte donc à plusieurs biais : l’oubli, la reconstruction, l’interprétation, la censure et la saillance (c’est-à-dire le fait de se rappeler mieux un rêve plus dérangeant ou plus marquant que les autres). Par définition, les rêves sont des souvenirs – des souvenirs de pensées, de sensations, d’hallucinations et d’émotions survenues pendant le sommeil et rapportées en éveil quelques minutes après l’expérience onirique. L’oubli du rêve ou d’une partie de celui-ci est donc l’un des plus grands obstacles à son étude. La capacité de se souvenir de ses rêves varie beaucoup d’un individu à l’autre et dépend de plusieurs facteurs tels que l’âge, l’intérêt personnel porté aux rêves, la personnalité, les capacités visuelles et créatives, l’environnement culturel et professionnel, ainsi que les préoccupations affectives. D’autre part, de nombreuses distorsions peuvent affecter les récits à cause de phénomènes de reconstruction et d’interprétation du rêve au moment où celui-ci est rapporté. En outre, certaines expériences subjectives peuvent être difficiles à décrire verbalement (par exemple, les émotions, les scènes complexes, les objets qui n’existent pas dans la réalité, les expériences inhabituelles, etc.). Enfin, certains contenus jugés embarrassants (pensées immorales ou contenu sexuel, par exemple) peuvent être tout simplement censurés par le rêveur. Les rêves marquants, inhabituels, très bizarres ou qui ont provoqué un réveil (c’est le cas des cauchemars) vont être plus facilement mémorisés : c’est le biais de saillance. Par exemple, le rêve au cours duquel on perd toutes ses dents, que plus de 75 % de la population normale a déjà fait au moins une fois dans sa vie, représente moins de 0,05 % des récits collectés systématiquement parmi les 22 000 présents dans la banque de données mise en ligne par les équipes de recherche de l’Université de Santa Cruz(1), en Californie. Pourtant, tous ceux qui l’ont fait s’en souviennent encore et on le retrouve dans toutes les clés des songes populaires (avec diverses interprétations, évidemment jamais validées, telles que l’annonce du décès d’un proche).
Jusqu’à récemment, on pensait que les limites de recueil de rêve étaient incompressibles et qu’il n’y avait aucun moyen de mesurer l’écart entre l’expérience originale du rêve et son souvenir à l’éveil. Ces biais laissaient libre cours à diverses théories, telles que celle de penser que le rêve n’était créé qu’au réveil (théorie de Goblot), ou que le cerveau disposait de plusieurs scénarios de rêve en réserve, dont l’un pouvait être évoqué par un bruit (comme si le cerveau choisissait dans une vidéothèque interne, en fonction du bruit environnant, un film qui contiendrait le scénario de rêve le plus probable pour ce bruit). La découverte de comportements oniriques complexes chez certains dormeurs, l’étude des somnambules, des personnes qui parlent en dormant, des émotions qui se traduisent sur le visage des dormeurs, des hallucinations de réveil, des rêveurs lucides, et les progrès de l’imagerie fonctionnelle ont totalement changé la donne en réfutant ces théories. On est désormais capable de mesurer l’écart entre le rêve dont se souvient le dormeur et les données qu’a observées le scientifique pendant que le dormeur rêvait.
Comment recueille-t-on les rêves ?
Les récits sont généralement recueillis lors des réveils spontanés (le plus fréquent étant le recueil du rêve le matin au réveil) ou lors de réveils provoqués par l’investigateur (à l’aide d’une sonnerie, qui réveille et rappelle la consigne d’écrire ou de dicter son rêve, ou par un chercheur qui entre dans la chambre, réveille et interroge le dormeur, en recueillant son récit à l’aide d’un dictaphone), en laboratoire de sommeil ou à la maison. Les smartphones, qui dorment souvent auprès de leur propriétaire et sont équipés d’un enregistreur vocal, permettent aussi de recueillir aisément les récits de rêve.
Parmi tous les facteurs qui déterminent l’obtention d’un récit de rêve, celui qui s’est révélé finalement le plus important, dès les années 1960, est la façon dont on pose la question au patient. En effet, si on lui demande : « À quoi étiez-vous en train de rêver au moment où vous avez été réveillé ? », on n’obtient pas le même récit que si on lui pose la question suivante : « Qu’est-ce qui vous passait par la tête au moment où vous avez été réveillé ? » En effet, tout le monde n’a pas la même définition du rêve : certains ne vont pas considérer comme des rêves certaines pensées ou émotions qu’ils avaient en tête avant d’être réveillés, ou les rêves ordinaires, sans bizarrerie ou faiblement scénarisés. C’est à cause de cette différence de méthode dans le recueil des rêves que les chercheurs ont cru, pendant quelques années, entre 1954 et 1966, que les rêves ne survenaient que dans une seule phase du sommeil : le sommeil paradoxal.
La mesure des rêves
Un de mes professeurs aimait à répéter que la science consistait d’une part à compter et classer, et commençait avec un instrument de mesure : par exemple, la recherche sur la régulation de la température par le corps a pu débuter dès l’invention du thermomètre. Alors quel est l’instrument de mesure des rêves ? l’« oniromètre » ? et que mesure-t-il ?
Tout d’abord, on peut mesurer la présence ou l’absence de récit de rêve, et sa fréquence : ainsi, la population normale rapporte en moyenne deux rêves par semaine. Il existe évidemment une grande variabilité entre les individus : certains (rares, moins de 0,4 % de la population) n’ont absolument jamais eu aucun souvenir de rêve de toute leur vie (et n’en rapportent aucun quand on les réveille pendant le sommeil paradoxal ; on les appelle les « non-rêveurs »), alors qu’à l’autre extrême, d’autres sont capables de rapporter cinq à dix rêves par nuit. Il n’y a pas de différences majeures entre le sommeil de ceux qui se souviennent beaucoup ou peu de leurs rêves, à l’exception (en moyenne, bien sûr) de réveils plus fréquents au cours de la nuit chez les personnes qui s’en souviennent aisément : cela suggère que les réveils permettent de mémoriser plus facilement les rêves. Chez un individu donné, le nombre de récits de rêves augmente avec le temps lorsqu’on demande de tenir un carnet de rêves, peut-être parce que le sujet y porte plus d’attention. Cette fréquence de souvenir des rêves se stabilise après deux semaines de tenue de carnet de rêves. Elle diminue avec l’âge après une pointe à l’adolescence. Elle dépend du moment où on réveille les dormeurs : si on les réveille après 10 minutes de sommeil paradoxal, 97 % des personnes jeunes et 81 % des sexagénaires se souviennent d’un rêve. Ce chiffre chute à 54 % (mais pas à 0 % !) lorsqu’on réveille les personnes pendant le sommeil lent. Enfin, les femmes se rappellent plus souvent leurs rêves que les hommes.
Quand les récits des rêves sont dictés immédiatement au réveil sur un enregistreur puis transcrits par écrit, ou écrits directement sur un carnet de rêves (ils sont alors un peu plus condensés que quand ils sont rapportés oralement), ils peuvent faire l’objet, comme n’importe quel texte, d’une analyse. Un travail préliminaire consiste à compter, pour chaque récit, le nombre total de mots, puis le nombre de mots significatifs, en excluant les mots introducteurs (tels que « j’ai rêvé que », « je ne sais pas exactement », etc.), les répétitions et les articles. Cela fournit une première information sur la longueur du rêve, une sorte de « poids ». Les récits peuvent ne contenir qu’un seul mot significatif (« j’ai rêvé de ma sœur ») ou plusieurs centaines. Cette première analyse a montré qu’un récit de plus de 40 mots provient exclusivement de réveils en sommeil paradoxal. Chez des personnes dont le sommeil n’a pas été enregistré, on peut donc choisir de restreindre l’analyse aux récits de plus de 40 mots, afin d’être certain qu’il ne s’agit que de récits issus du sommeil paradoxal : certes, on risque alors de ne pas tenir compte d’authentiques autres rêves de sommeil paradoxal plus courts, mais au moins ont été éliminés ceux de sommeil lent. C’est par exemple ce choix qui a été fait dans l’analyse des rêves des personnes sourdes-muettes, décrit dans le chapitre 3.
Dans une autre méthode, il est possible aussi non pas de compter les mots mais les phrases : l’analyse propositionnelle des rêves fonctionne en découpant les récits en propositions (c’est-à-dire en phrases, construites autour d’un verbe). Nous l’avons utilisée, entre autres méthodes, pour comparer la présence de propositions évoquant la marche dans les récits de rêve des personnes paraplégiques par rapport aux sujets valides.
L’analyse du contenu des rêves
L’analyse du contenu du récit de rêve s’intéresse aux éléments qui constituent le scénario de celui-ci. Parmi toutes les méthodes proposées, la plus utilisée dans le monde est celle de Hall et Van de Castle(2), mise en place en 1966. Elle consiste à subdiviser le récit en différentes catégories : personnages (animaux, humains, créatures ni humaines ni animales), environnements physiques ou décors (lieux, objets), activités (physiques, verbales, intellectuelles), interactions sociales (agression, actes amicaux, sexualité), succès ou échec et émotions (appréhension, tristesse, colère, confusion, bonheur). Hall et Van de Castle ont recueilli cinquante mille rêves de plus de cinq cents personnes, hommes et femmes, en sommeil lent comme en sommeil paradoxal, et établi grâce à cette grande base de données des normes selon l’âge et le sexe. Ils ont très rapidement démontré que les émotions négatives comme la colère et la peur étaient beaucoup plus fréquentes en rêve que les émotions positives comme la joie ou le plaisir. Ces émotions sont bien sûr rapportées par le rêveur ; elles ne doivent en aucun cas être déduites du récit par un investigateur externe, car l’émotion est une perception subjective. Les mêmes auteurs ont montré que le sens le plus utilisé en rêve était la vision (40 %), alors que les sensations gustatives et olfactives n’étaient décrites que dans 1 % des rêves. Ces chiffres obtenus dans la population générale sont différents si l’on étudie des groupes particuliers, comme des personnes aveugles par exemple (voir chapitre 3, « Les aveugles verront et les sourds entendront »). Je n’ai pas connaissance d’une étude menée chez les fins œnologues ou gastronomes français, mais on peut parier sur une utilisation plus élevée de l’odorat et du goût chez ces derniers.
En fonction du sujet d’intérêt des chercheurs, d’autres échelles d’analyse du contenu ont été développées. La bizarrerie des rêves intrigue. Elle s’observe plus souvent lors des rêves recueillis en sommeil paradoxal. L’échelle de bizarrerie de Revonsuo estime le nombre de bizarreries présentes dans un rêve et les catégorise(3). Elle permet de décomposer le récit en 14 catégories d’éléments (soi, lieux, temps, personnages, animaux, parties du corps, plantes, objets, événements, actions, langages, cognitions, émotions et sensations), puis classe chacun selon son étrangeté. Les éléments bizarres sont classés en « incongrus » (« distordus », « exotiques » ou « impossibles »), « vagues » et « discontinus ». Par exemple, « J’étais dans une voiture géante » comporte trois éléments : soi-même (Je), un lieu et un objet, dont deux (Je et le lieu) sont non bizarres et un seul (la voiture géante) est bizarre. Cette bizarrerie est une incongruité, car la voiture est distordue (anormalement grande).
Les mêmes auteurs ont mis au point une échelle de menace, en particulier parce qu’ils s’intéressent au rêve comme façon de s’entraîner à faire face à des dangers dans le cadre d’une réalité virtuelle(4) (voir les chapitres 5 et 8, sur les comportements oniriques et les terreurs nocturnes). Six éléments sont ainsi mesurés : la nature de la menace (par exemple : échecs, fuites et poursuites), sa cible (soi ou quelqu’un d’important pour soi), sa sévérité (mineure ou vitale), la possibilité de réagir et la nature de la réaction. Dans le récit de rêve suivant : « J’ai été attaqué par un braqueur. Il a pointé son pistolet sur moi, mais mes cris l’ont fait fuir », la menace est une agression, de sévérité potentiellement mortelle. Le rêveur a eu la possibilité de réagir et a réagi d’une façon possible et raisonnable.
Quelles erreurs éviter
dans l’analyse de rêve ?
À partir du moment où un chercheur s’intéresse à un récit de rêve et en décompte les différents éléments, selon l’analyse Hall et Van de Castle ou selon les échelles de bizarrerie ou de menace, il projette sur le récit de quelqu’un d’autre une analyse qui présente forcément de nombreux éléments subjectifs. Il y a un risque important qu’il veuille y trouver ce qu’il cherche. C’est un biais très fort chez le chercheur, qu’il peut toutefois réduire de différentes manières.
La première est de ne pas connaître le groupe auquel appartiennent les auteurs des rêves qu’il analyse. Ainsi, si on recherche la mention de paroles prononcées ou entendues par des personnes sourdes-muettes dans leurs rêves, il faut qu’une personne extérieure numérote les récits de rêves et mélange les rêves de ces personnes avec les rêves des personnes entendantes. On donne ensuite les rêves à analyser à au moins deux évaluateurs qui vont les analyser chacun de leur côté. Les codages obtenus sont ensuite comparés. Tout ce qui est concordant est conservé pour la suite des analyses.
Enfin, sauf exception, mieux vaut se garder de dévoiler à la personne dont on recueille les rêves le but véritable de l’étude, sinon il risque fort de sélectionner et de détailler plus les rêves susceptibles d’intéresser l’investigateur. Nous verrons par exemple que, dans l’étude des rêves des personnes paraplégiques (chapitre 3), l’étudiante a expliqué aux participants qu’elle s’intéressait à la reconnaissance des visages en rêve afin de brouiller les pistes.
On applique donc au recueil et à l’analyse des récits de rêve les mêmes critères que ceux utilisés dans des études menées dans d’autres domaines cognitifs subjectifs, tels que l’étude des émotions, de la douleur et de nombreux processus de pensée. Les bases de données sur les rêves comportent essentiellement des chiffres, et l’on peut donc compter, classer et mesurer. Cela n’enlève en rien toute la « chair » du rêve, tous ces récits parfois merveilleux, extraordinaires ou bizarres.
Pour ajouter encore plus d’objectivité dans l’analyse des rêves, la plupart des journaux scientifiques demandent s’il est possible de mettre en ligne les récits eux-mêmes (évidemment sans jamais citer de nom) afin que d’autres chercheurs puissent travailler dessus. Ces analyses de groupe, contenant de préférence un grand nombre de participants, sont complémentaires des analyses individuelles. De nombreuses études n’ont pas comparé des groupes de rêveurs entre eux, mais ont profité de carnets de rêves bien tenus pendant de nombreuses années par une seule personne, d’autant plus utiles que cette même personne t...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Introduction
- Chapitre 1. Comment mesurer les rêves ?
- Chapitre 2. La vie rêvée est-elle la vie réelle ?
- Chapitre 3. Les aveugles verront et les sourds entendront
- Chapitre 4. Sommeil, rythme et rêves chez les moines cloîtrés
- Chapitre 5. Un nouveau trouble du rêve : le trouble comportemental en sommeil paradoxal
- Chapitre 6. Que regardent les yeux du dormeur ?
- Chapitre 7. Quand Morphée guérit Parkinson
- Chapitre 8. Les somnambules rêvent-ils ?
- Chapitre 9. Réviser en dormant… et en rêvant ?
- Chapitre 10. Manger en dormant
- Chapitre 11. Sexualité, rêve et sommeil
- Chapitre 12. Les hallucinations : des morceaux de rêve ?
- Chapitre 13. Les rêves peuvent-ils être prémonitoires ?
- Chapitre 14. Les rêves lucides
- Conclusion
- Table
- 4e de couverture