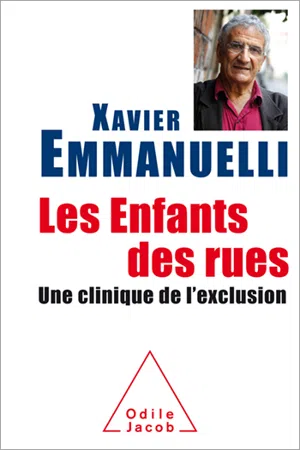
- 160 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Les enfants des rues, ce sont ces enfants que l'on voit errer, seuls ou en groupe, dans les rues des mégapoles. Dégât collatéral de l'urbanisation et de la mondialisation, ils sont souvent molestés par les commerçants, poursuivis par la police et rejetés par l'ensemble de la population. Comment aider ces petits exclus ? Quels sont les pièges à éviter pour se faire accepter d'eux et agir efficacement ? Fort de son expérience auprès des grands exclus, Xavier Emmanuelli se penche ici sur le sort de ces enfants abandonnés de tous. Enfants sorciers ou enfants soldats, filles-mères ou adultes ayant refusé de grandir, tous ont des comportements de survie archaïques qui relèvent de ce qu'il appelle l'« atroce liberté ». Quand ces comportements sont compris, ils peuvent servir d'appui pour une démarche de soin concrète. Un document d'une richesse clinique exceptionnelle. Un témoignage poignant sur l'un des scandales de nos sociétés. Xavier Emmanuelli est cofondateur de Médecins sans frontières, pionnier du Samu, fondateur du Samu social et ancien ministre de l'Action humanitaire d'urgence.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l'application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux forfaits: Essentiel et Intégral
- Essentiel est idéal pour les apprenants et professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la Bibliothèque Essentielle avec plus de 800 000 titres fiables et best-sellers en business, développement personnel et sciences humaines. Comprend un temps de lecture illimité et une voix standard pour la fonction Écouter.
- Intégral: Parfait pour les apprenants avancés et les chercheurs qui ont besoin d’un accès complet et sans restriction. Débloquez plus de 1,4 million de livres dans des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. Le forfait Intégral inclut également des fonctionnalités avancées comme la fonctionnalité Écouter Premium et Research Assistant.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l’application Perlego sur appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n’importe où — même hors ligne. Parfait pour les trajets ou quand vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Oui, vous pouvez accéder à Les Enfants des rues par Xavier Emmanuelli en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences sociales et Travail social. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
L’urgence, une méthode
pour sortir de l’urgence
pour sortir de l’urgence
Je suis un médecin urgentiste et je n’ai vraiment entamé ma vie professionnelle qu’avec la création du Samu (Service d’aide médicale urgente), œuvre médicale collective du service public hospitalier née au tournant des années 1970 et appliquée depuis sur tout le territoire français.
Auparavant, j’avais exercé dans des milieux sociaux et environnementaux extrêmement différents : au cours de nombreux remplacements en médecine de campagne ; comme médecin de marine marchande, embarqué sur les derniers paquebots autour du monde, sur des cargos, des navires usines, et autres bateaux pétroliers ; comme médecin du travail en mer ; comme médecin des mines de charbon de Lorraine ; et, enfin, comme médecin de prison.
Puis, j’ai entamé une spécialité d’anesthésie-réanimation au Samu 94 à Créteil, dans le Val-de-Marne, en 1972. Ce fut le grand tournant de ma carrière. Si l’on voulait décrire par un aphorisme le Samu, on pourrait dire, en jouant sur deux niveaux de sémantique : « Le Samu développe par l’urgence une méthode pour sortir de l’urgence. » L’urgence est un terme générique qui qualifie une situation ou un état demandant à être traité instantanément, comme en cas de risque vital ou de crise aiguë, et il implique toujours une notion de gravité extrême ou d’intense péril.
Par extension, et dans le sillage du Samu, on parlera ainsi d’urgence à différents niveaux d’interprétation : urgence vitale, urgence ressentie, urgence relative, urgence collective, jusqu’à élaborer l’oxymore d’« urgence chronique ». Et la réponse de l’urgence à l’urgence consiste en un déploiement de moyens adéquats selon des méthodes précises, par des professionnels compétents et pour une situation qui ne peut souffrir d’aucun retard.
En cela, le mot « urgence » décrit aussi bien la situation sur le terrain que les moyens mis en œuvre pour y faire face. Il décrit également l’accueil hospitalier prévu pour recevoir et traiter ladite urgence : en l’occurrence, un service ouvert jour et nuit, qui permet l’entrée immédiate dans le circuit hospitalier pour des malades qui s’estiment ou qu’on estime en grand danger.
Formé par l’urgence
Ces années de Samu auprès d’un maître, le professeur Huguenard, m’ont appris ce que devait être une action de terrain. Je veux résumer ici les grands principes de cet enseignement, par lequel j’ai été formé et initié, de même qu’ont été formés et initiés des générations d’anesthésistes réanimateurs et autres urgentistes (médecins, infirmiers, ambulanciers), voire des « profanes ».
L’action urgente n’est pas démocratique. Elle ne peut pas l’être. Elle ne peut se faire, comme pour des opérations militaires, qu’en respectant une hiérarchie en quelque sorte organisée sur trois niveaux :
– Le niveau stratégique : c’est celui du recueil et du traitement de l’information. Certes, on doit savoir caractériser l’information, mais on doit surtout – et c’est le seul moment vraiment « démocratique » de cette action – pouvoir la recevoir, d’où qu’elle vienne et quel que soit l’informateur. C’est ainsi que se forge la décision de l’action.
– Le niveau tactique : c’est le niveau de l’application de l’action, telle qu’elle a été décidée par un seul chef, qui est et reste le responsable, quoi qu’il arrive. Cette phase d’application est la phase de réalisation de la décision, selon les aléas et les contraintes du terrain.
– Enfin, le niveau technique : c’est l’exécution de l’acte décidé, selon des procédures éprouvées et bien rodées. Il ne peut y avoir d’improvisation… Cependant, si la situation change brusquement et en l’absence d’autres directives, il est nécessaire de ne pas s’obstiner dans une procédure devenue une impasse et de savoir prendre l’initiative d’en changer. La responsabilité médicale est à ce prix. Dans cette situation, elle est en quelque sorte automatiquement et momentanément déléguée. Néanmoins, quoi qu’il arrive, ce sera toujours au chef d’assumer les conséquences de ce choix, car ce que choisit un subordonné, même sans s’en rendre compte, est au final de la responsabilité du chef.
Une opération de terrain nécessite donc un responsable, une équipe en hiérarchie, des moyens adaptés, des communications fiables et des réseaux.
Le professeur Huguenard était un pédagogue hors pair. Quand, pour le mettre en porte-à-faux, sur le problème d’acharnement thérapeutique par exemple – terme qu’il n’aimait pas d’ailleurs, et auquel il préférait « obstination thérapeutique » ou « application obstinée des procédures » –, on lui demandait : « Quand doit-on arrêter une réanimation ? », il sentait le piège et sa réponse était : « Jamais !… » Il complétait alors : « Une réanimation commencée ne doit jamais être arrêtée… tant qu’une équipe mieux équipée ou plus professionnelle ne vient pas prendre le relais. Si ce n’est pas le cas, il ne faut pas la commencer. Si vous n’êtes pas en mesure de prévoir les suites, alors non vraiment, il ne faut pas commencer. Ce serait une faute grave. »
Ainsi décrivait-il les trois paliers de l’urgence :
1° l’action d’urgence proprement dite ;
2° la posturgence, qui est le relais choisi en fonction des suites de votre action ;
3° et, enfin, l’action à long terme.
Dans l’urgence, aucune opération complexe ne doit être entreprise seul et sans hiérarchie. La décision doit toujours permettre d’identifier un responsable, celui à qui, en dernière analyse, incomberont les choix.
C’est depuis ce cadre mental que je parle, et c’est ainsi que l’urgence, les actions d’urgence et le modèle Samu ont guidé mes actions, non seulement dans le cadre hospitalier, mais aussi sur le terrain des crises et des catastrophes, et enfin dans tous les autres cadres de l’intervention auxquels j’ai été confronté. Ce cadre mental m’a effectivement guidé pour tenter d’aider les personnes en difficulté, qu’elles soient médicales, psychologiques ou sociales. Je dis « guider » car je veux parler du point de vue technique, gestuel… le point de vue du « faire ».
De l’urgence individuelle
à l’urgence collective
À l’époque où naissait le Samu dans sa forme définitive (décembre 1971) a aussi été créée l’association Médecins sans frontières, fondation dont faisaient partie, à l’origine, quelques-uns de mes camarades de faculté et des journalistes médicaux de Tonus1. J’ai participé à cette création. Par rapport au Samu, il n’y avait pas de relation de « causalité », mais, comme aurait pu l’écrire Jung2, juste un rapport de « synchronicité » ou de coïncidence, car cette culture de « projection de forces et de personnels médicaux » hors les murs de l’hôpital était dans l’air du temps.
Dans ces années-là, les militaires avaient créé l’« élément médical militaire d’intervention rapide » (EMMIR), les assureurs « EUROP Assistance », les médecins « SOS médecins », ouvrant ainsi des pistes pour des associations ou des entreprises qui ont repris les mêmes concepts. Naturellement, pour les états de guerre, le grand modèle restait le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Le Samu a sans conteste influencé la culture de MSF, mais MSF a aussi, à l’inverse, introduit au Samu, avec l’expérience de ses missions, sa propre culture humanitaire et son savoir en médecine de crise et en médecine de catastrophe, puisque, depuis sa création jusqu’à nos jours, MSF a été présente sur toutes les crises, qu’elles relèvent de l’urgence, de la posturgence ou du long terme : tremblements de terre, inondations, famines et épidémies… et, bien sûr, l’accompagnement des réfugiés et des personnes déplacées – domaine dans lequel MSF a acquis sa notoriété, par sa conception de la logistique, grâce en particulier au grand logisticien Jacques Pinel aujourd’hui disparu –, les attentats, les blessés de guerre – culture que MSF a pu développer avec et grâce au savoir des médecins militaires…
Sur tous ces terrains d’intervention, MSF a maintenu une activité de moins en moins éloignée géographiquement, de plus en plus proche de la pratique médicale de nos sociétés, puisque les déplacements de population, les épidémies et les attentats se sont rapprochés de l’Occident…
Ces hommes et ces femmes, professionnels de l’urgence, la plupart du temps bénévoles, ont décrit les désordres que ces situations entraînaient, les actions pratiques et les solutions thérapeutiques inédites qu’ils étaient au fur et à mesure amenés à développer. C’étaient des empiriques. Ils ont ainsi apporté au monde médical de nouvelles pratiques, de nouvelles perspectives et de nouvelles expériences. La dimension d’initiation qu’ils vivaient et les risques qu’ils prenaient ont donné une nouvelle signification aux interventions médicales avec des expériences sans précédent.
Le Samu et MSF ont grandi ensemble. Mais, il faut bien le reconnaître, leur montée en puissance s’est faite en même temps que le développement des médias, de l’image et de ses moyens. Il y eut notamment la télévision avec les reportages instantanés et ses récits en direct. Ces avancées ont permis la construction permanente d’une « saga » et ont assuré la notoriété de chacune de ces deux structures. Ce ne fut pas sans inconvénients car, souvent, des actions furent scénarisées devant les médias pour des raisons pédagogiques ou de spectacle. Ces actions propulsèrent sur le devant de la scène quelques personnages charismatiques, censés incarner le sauveteur. Cela donna en revanche une sorte de distance désincarnée à tous ces drames. Mais, surtout, cet engouement n’échappa pas aux politiques, et les opérations humanitaires devinrent parfois un prétexte à l’intervention des États ou des gouvernements. Le savoir-faire et la culture de l’urgence et de l’intervention devenaient sous les médias un support d’action politique, qui, elle, restait classique dans les rapports de forces qu’elle suscitait.
MSF s’étendit dans le monde entier et, en 1999, obtint le prix Nobel de la paix. J’ai eu l’honneur et le privilège – en dehors du fait d’en avoir été l’un des fondateurs – d’avoir fait partie du cercle de ses dirigeants durant vingt-trois ans, de l’avoir vu grandir et d’y avoir contribué par mon expérience au Samu. J’ai pu apporter bien des éléments dans son ascension, en particulier dans la médecine de crise et de catastrophe. Je n’ai quitté MSF, en 1995, qu’à regret, pour entrer au gouvernement Juppé.
Quand Jacques Chirac fut élu président de la République, je devins secrétaire d’État à l’action humanitaire d’urgence, une mission que j’ai assurée pendant deux ans, entre 1995 et 1997. Le départ de l’association fut à la fois un chagrin de laisser mes copains en arrière et également un tournant important dans ma carrière. Je suis entré au gouvernement en tant que représentant de la société civile et, pour ce qui me concerne, indépendant de toute étiquette ou de tout parti. J’y suis entré en raison des compétences que j’avais acquises dans le domaine médical et humanitaire. Ce fut une expérience essentielle.
La pratique médicale et sociale acquise avec MSF dans bien des situations et sur tant de lieux différents autour de la planète m’avait fait vivre des expériences qu’aucun médecin, je crois, n’a eu la chance de vivre. J’ai pu voir disparaître la variole, qui flambait encore au Bangladesh lors de ma toute première mission, en 1972. À l’époque, la mortalité y était encore importante. Pourtant, le dernier cas de cette maladie, qui avait accompagné l’humanité depuis ses origines, a eu lieu en 1976, et celle-ci a été pour toujours et complètement éradiquée en 1976 (sauf évidemment dans les laboratoires secrets pour servir éventuellement d’arme biologique destructrice). Et j’ai vu naître une nouvelle épidémie, le sida (syndrome d’immunodéficience acquise), dont les premiers cas ont été décrits en 1981. Mais la maladie venait de plus loin bien sûr, puisque, rétrospectivement, on a compris qu’elle était apparue au Cameroun, au milieu XIXe siècle.
J’ai compris peu à peu que les épidémies sont des êtres biologiques qui vivent et qui meurent. Pour arriver à cette conclusion, je me suis appuyé sur le concept de « pathocénose », développé par Mirko Grmek3, un historien de la médecine. Ce mot désigne l’équilibre des pathologies à un moment donné, pour des populations données ; un concept « évolutionniste » qui part du principe que les virus, les bactéries, les parasites et les champignons se développent et entrent en compétition « darwinienne » pour établir un nouvel équilibre. Si on élimine une catégorie d’êtres de l’environnement, une catégorie jusqu’alors en arrière-plan occupera cet espace désormais vide et pourra s’exprimer. Ainsi les virus ont-ils supplanté d’un...
Table des matières
- INTRODUCTION
- CHAPITRE 1
- CHAPITRE 2
- CHAPITRE 3
- CHAPITRE 4
- CHAPITRE 5
- CHAPITRE 6
- CONCLUSION