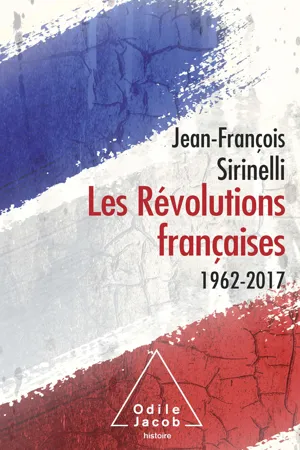
- 384 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
La France a changé, et rien désormais ne sera plus comme avant. En deux générations à peine, les Français ont radicalement modifié leurs façons de vivre, de penser et de voter, au point qu'on a pu parler de « Seconde Révolution » pour désigner les bouleversements intervenus au cours des années 1960. Ce sont ces Révolutions françaises que retrace pour nous Jean-François Sirinelli. Elles ne sont pas toutes politiques ; nombre d'entre elles concernent la vie intime des Français, ce qui les enthousiasme, les fédère ou les heurte, des Parapluies de Cherbourg au Cabu de Charlie Hebdo, de la fin de la guerre d'Algérie à la révolution introuvable de Mai 68, du règne de De Gaulle à l'ascension de Macron. Une interrogation parcourt ce livre : née sous le signe de la paix et de la prospérité, la Ve République est-elle parvenue au terme d'un cycle ? Faut-il redéfinir le modèle républicain français ? Jean-François Sirinelli est professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po. Spécialiste de la Ve République et des mutations socioculturelles de la France contemporaine, il a publié de nombreux ouvrages qui ont fait date.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l'application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux forfaits: Essentiel et Intégral
- Essentiel est idéal pour les apprenants et professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la Bibliothèque Essentielle avec plus de 800 000 titres fiables et best-sellers en business, développement personnel et sciences humaines. Comprend un temps de lecture illimité et une voix standard pour la fonction Écouter.
- Intégral: Parfait pour les apprenants avancés et les chercheurs qui ont besoin d’un accès complet et sans restriction. Débloquez plus de 1,4 million de livres dans des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. Le forfait Intégral inclut également des fonctionnalités avancées comme la fonctionnalité Écouter Premium et Research Assistant.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l’application Perlego sur appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n’importe où — même hors ligne. Parfait pour les trajets ou quand vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Oui, vous pouvez accéder à Les Révolutions françaises par Jean-François Sirinelli en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Histoire et Histoire du monde. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Première partie
Les craquements de la France d’avant
Chapitre 1
1962 : retour à l’Hexagone
On n’entre pas dans une histoire nationale comme on sort d’un ascenseur à l’étage que l’on désire : cette histoire est toujours le fruit de ce qui précède. 1962, on va le voir, ouvre indéniablement une phase nouvelle de cette histoire, phase à laquelle est consacré ce livre, mais, précisément parce que ce millésime marque une inflexion majeure, il convient, pour prendre la mesure d’une telle inflexion, de la replacer à la fois dans l’espace géographique et dans la longue durée : elle n’en prend alors que plus de signification encore. L’analyse, dans les quelques pages qui suivent, sera donc nécessairement plus générale – car ainsi placée doublement en grand-angle – qu’au fil des autres chapitres.
Les horizons perdus
Dans un ouvrage publié en 1998, Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot, Alain Corbin retrace le cours supposé de l’existence du petit artisan du même nom, dans le Perche rural du XIXe siècle. Il le fait au sein d’une histoire relativement immobile – l’intéressé, né en 1798, ne sera pas directement concerné par les guerres napoléoniennes –, et Louis-François Pinagot aurait pu naître vingt, voire quarante ans plus tard sans que son existence en soit fondamentalement différente. En d’autres termes, les strates générationnelles empilées au sein de la société française vers 1850 ont une histoire relativement commune, l’histoire n’étant pas entendue ici au sens des événements politiques successifs mais plutôt des tendances lourdes que sont les évolutions socioculturelles qui refaçonnent les conditions de la vie quotidienne.
Si l’on se place maintenant trois quarts de siècle plus tard, dans l’entre-deux-guerres, la société française est encore alors le fruit d’une histoire largement partagée entre générations empilées en son sein, même si cette histoire, bien sûr, n’est plus celle vécue par l’artisan percheron. L’observation peut paraître paradoxale, et l’expression entre-deux-guerres pour caractériser la période accroît encore la contradiction apparente : cette période, en effet, s’est ouverte par le grand massacre des jeunesses européennes qu’a été, à bien des égards, la Grande Guerre, et il existe, dans les années 1930, une « génération du feu » que sa dénomination même singularise alors au sein de cette société française. Et pourtant le Français de 1930 relève, toutes classes d’âge confondues et par-delà ce coup de faux qui ne frappa que l’une d’entre elles, d’une histoire commune, si on prend le soin de replacer celle-ci dans la longue durée. Bien plus, dans une telle remise en perspective, le Français de 1950, après un second conflit pourtant lui aussi traumatisant pour la communauté nationale, est encore, à travers toutes ses générations, le produit d’une telle histoire partagée.
Cette histoire longue, qui transcende ainsi les classes d’âge, est, en effet, la résultante de plusieurs temporalités imbriquées. La première de ces temporalités est cette « séquence occidentale » (Jean-Claude Guillebaud) d’un demi-millénaire qui s’enclenche au XVe siècle. À cette époque s’amorcent des mouvements historiques de fond qui vont en premier lieu affecter l’extrémité occidentale du continent européen. Or sur ce finistère se localise déjà, depuis plusieurs siècles, une communauté nationale, la France. Celle-ci, comme ses voisines, relevait jusque-là de la séquence pluriséculaire précédente, cette « civilisation de l’Occident médiéval » pétrie de christianisme, chère à Jacques Le Goff qui l’étudia dans un livre du même titre qui a fait date. Et cette France est alors elle aussi concernée par la dilatation géographique que représentent, à la fin du Moyen Âge, la découverte puis la conquête de nouveaux mondes, et, plus largement, un processus d’échanges multiformes, dont l’Europe n’est alors au demeurant qu’un des épicentres. Même si l’État-nation France n’est pas à ce moment un agent primordial de la dilatation à l’œuvre, à la différence d’autres royaumes européens, il en connaît lui aussi les effets, d’autant que le mouvement qui s’amorce est pluriséculaire et qu’il ne s’agit pas seulement, pour cet Occident, d’extension des échelles géographiques mais, beaucoup plus largement, d’un bouleversement de ses représentations du monde. Univers d’abord géographiquement autocentré et intellectuellement expliqué par les enseignements de l’Église, l’Europe des siècles suivants, et en son sein la France, est devenue un continent conquérant dans lequel de surcroît les lézardes cultuelles et culturelles introduites par la Renaissance ont accéléré une quête de savoir et d’ouverture intellectuelle : la Réforme puis les Lumières ont eu des effets induits considérables sur les consciences individuelles aussi bien que sur les représentations collectives. Les horizons géographiques mais également spirituels et intellectuels s’en sont donc trouvés bouleversés. Et tout ce qui précède montre bien aussi à quel point l’histoire de la France ne peut être dissociée d’une histoire géographiquement plus large.
Si ce temps long pluriséculaire a ainsi profondément modifié ces horizons, s’ajoute également, dans la constitution de ceux-ci, le rôle joué par un temps intermédiaire, multidécennal : la période 1850-1900, de fait, va remodeler cette histoire française partagée. Elle constitue, en effet, le moment d’apogée de l’expansion coloniale et celle-ci, débouchant alors pour la France sur la constitution du deuxième empire du monde, s’intègre dans un second processus de mondialisation, après celui observé aux XVe et XVIe siècles. L’historienne américaine Suzanne Berger a utilisé à bon escient, à propos de cette période, ce terme de mondialisation, et, indéniablement, l’univers mental et l’horizon du Français de 1930 ou encore de celui de 1950 ont été refaçonnés par ce mouvement d’ouverture au monde environnant. Il y a bien, à cet égard, dans l’histoire française, une sorte de moment 1900, essentiel pour une meilleure compréhension par l’historien des perceptions communes de ce monde environnant. D’autant qu’à la même époque les progrès de l’encadrement scolaire et l’intense brassage culturel activé par la presse – les quotidiens voient leur tirage décupler entre 1870 et ce tournant du siècle – enclenchent une « révolution culturelle silencieuse » (Jean-Yves Mollier). Symboles de cette rencontre entre la mue culturelle et l’expansion coloniale, les touches de couleurs sur les cartes de géographie rendent compte à tous les écoliers – c’est-à-dire tous les jeunes Français dans le cadre de l’école primaire obligatoire – de la dilatation de leur pays aux dimensions du monde.
Ce pays, au même moment, connaît de surcroît une autre forme d’homogénéisation : la France, longtemps fractionnée en « terroirs » (Eugen Weber), est alors le territoire d’une unification culturelle croissante, et l’école républicaine, là encore, joue un rôle essentiel. Certes, il y a débat entre les historiens sur le rythme et la chronologie d’un tel processus. Mais un constat s’impose : vers 1900, cet agrégat de régions en partie désunies qu’était la France est devenu un pays aux éléments profondément rapprochés par l’école et le développement d’une culture de masse imprimée qui leur confèrent désormais des horizons davantage partagés qu’auparavant. Si la France des « petites patries » (Jean-François Chanet) est encore une réalité, l’articulation de celles-ci avec une vision du monde commune est alors un élément constitutif d’une forme d’identité historique. Celle-ci, on le voit, est le fruit complexe de ces jeux d’échelles géographiques et de ces imbrications de temporalités. Elle n’est certes jamais totalement pérenne, mais la puissance structurante de ces jeux d’échelles et la force cinétique de ces temporalités font qu’il y a bien là des éléments qui resteront relativement stables tout au long du premier XXe siècle. Ni la Grande Guerre ni le second conflit mondial n’affaibliront durablement cette identité : en 1950, la France est une nation encore largement rurale, qui se voit et se vit en puissance impériale. En même temps, cette vision apparemment mondiale n’était pas, en fait, réellement mondialisée : le pré carré national, aux yeux du plus grand nombre, apparaissait seulement comme dilaté par un appendice colonial.
L’ombre portée du moment 1900 produisait donc encore largement ses effets dans la France toujours impériale de 1950. C’est à ce titre que l’on peut parler, en dépit du drame des deux guerres mondiales, d’une histoire immobile dans ses structures profondes, et de ce fait doublement partagée. D’une part, le Français de 1950 demeurait, à bien des égards, l’ombre portée de celui de 1900, deux générations plus tôt : le grand-père et le petit-fils s’inscrivaient dans la même longue durée. D’autre part, à ces deux dates, une telle histoire, précisément en raison de la relative immobilité socioculturelle et anthropologique, et parce que le grand-père et le petit-fils y connaissaient donc aussi le même environnement stable, est la même pour toutes les strates générationnelles qui constituent la communauté nationale. D’autant qu’il y a aussi stabilité politique : cet État-nation français dilaté aux dimensions de la planète par l’expansion coloniale reste politiquement beaucoup plus stable que ses voisins immédiats tout au long de ce premier XXe siècle. Mis à part le Royaume-Uni, les trois autres grands pays riverains reçurent, en effet, de plein fouet les ondes de choc des grands ébranlements du siècle : l’Allemagne, bien sûr, tout au long du « court XXe siècle » (Éric Hobsbawn) qui s’achève… à Berlin en 1989, mais aussi l’Italie, vite privée de ses possessions coloniales et ballottée par plus de vingt années de régime fasciste, l’Espagne enfin, monarchique, républicaine puis franquiste.
Tout change, pour la France, dans la seconde partie du XXe siècle. Tout d’abord, en deux décennies à peine, ces horizons restés ainsi longtemps communs sont devenus des horizons perdus. Jusque-là, on l’a vu, ces horizons communs, en tout cas depuis la fin du XIXe siècle, sont restés globalement fixes : un pays campé au finistère de l’Europe mais également installé sur plusieurs continents par l’expansion coloniale, une France-monde en quelque sorte. Mais celle-ci, dans les années 1950 et au début de la décennie suivante, paraît passer d’une telle dilatation à une brusque rétraction : en quinze ans, la République impériale qu’était la France fut ramenée à sa matrice hexagonale, et les horizons de l’État-nation France s’en trouvèrent ainsi totalement remodelés. En 1962, après la décolonisation de l’Algérie, la France-monde redevint plus prosaïquement la France-dans-le-monde, statut historique et géographique moins glorieux mais jamais véritablement déconnecté d’autres espaces.
D’autant qu’à ces horizons perdus succédèrent rapidement des horizons reconstruits, et ce statut de France-dans-le-monde prit bientôt un tout autre sens, encore plus complexe, dans un monde lui-même changeant car en globalisation accélérée. Progressivement, donc, dans les houles de la décolonisation, puis dans un tel processus de globalisation, cette France perdit assurément une position en surplomb, subissant désormais l’Histoire plus qu’elle ne contribuait, comme par le passé, à la faire. En même temps, il est vrai, l’État-nation France avait connu un autre changement d’horizon, induit par la construction européenne. Mais, on le verra, à partir des années 1980 et surtout 1990, l’Europe devint, au sein de la communauté nationale, un débat plus qu’un dessein, un coin enfoncé plus qu’un ciment.
Surgira donc, pour ce qui concerne cette question des horizons perdus puis recomposés, une question essentielle : qu’en est-il du rôle des frontières nationales comme éventuelle ligne d’horizon ? Certes, la Ve République est le régime politique d’un État-nation aux frontières inchangées depuis 1962, sauf que, au fil des décennies suivantes, il deviendra de plus en plus difficile de ramener celui-ci au seul périmètre que celles-ci dessinent. Il n’y a pas que le registre économique, en effet, où la mondialisation subvertit ainsi les jeux d’échelles par-delà les frontières, de tels mécanismes opèrent aussi, on le verra, dans le domaine politique et plus encore dans celui de la culture.
La fin du village ?
Pour l’heure, en ces années 1960 et 1970, retenons que l’histoire française voit ses cadres et ses horizons se modifier à vitesse accélérée et qu’une telle évolution donne encore davantage de densité à la mutation en cours. D’autant que ce ne sont pas seulement des jeux d’échelles extérieurs qui modifient ainsi la donne, la France se modifie également dans ses aspects proprement endogènes. Si le jeune Français adulte de 1950 demeurait, on l’a vu, à bien des égards l’ombre portée de celui de 1900, c’est aussi que les deux France qui les portaient, à un demi-siècle de distance, étaient l’une et l’autre pétries de ruralité. Tout change au cours du second XXe siècle : dans cette France que la décolonisation ramène aux dimensions de ses frontières continentales et maritimes a lieu à la même époque un impressionnant glissement de peuple, comme on dit glissement de terrain, qui pousse la population des campagnes et des petites villes vers les moyennes et grandes agglomérations. Le pays, puissance encore en premier lieu rurale et impériale aux lendemains de l’Occupation, est devenu une France hexagonale, urbaine et industrielle vingt ans plus tard. Au recensement de 1968, 66,7 % des Français sont des citadins, et, de surcroît, l’agriculture n’emploie plus à cette date qu’un actif sur sept, plus précisément 14,9 %.
L’évolution est considérable par rapport à l’immédiat après-guerre : au recensement de 1946, encore près d’un Français sur deux (47 %) était un rural et l’agriculture employait alors à elle seule un tiers des actifs. Entre-temps, l’exode rural est passé par là et jamais, à cet égard, une génération, celle née dans la période qui suit cet après-guerre, n’a été globalement aussi différente de celle de ses pères et de ses grands-pères : beaucoup ont été alors transplantés en ville, avec leurs aînés ou, un peu plus tard, de leur propre initiative. Mais, même dans le cas où le fils n’a fait que suivre le père, leur parcours sociologique est de nature différente, le père ayant connu un « avant » en milieu rural. Cependant, si le fils est directement transplanté dans un « après » citadin, cela ne signifie pas que cette génération de la transition ait rompu avec la ruralité. De fait, même si historiquement elle est bien la génération de l’adieu aux terroirs, elle conserve encore des liens étroits avec eux. Souvent petits-fils de paysans et fils de citadins aux racines paysannes encore proches, ces jeunes gens ont gardé de facto un rapport de grande proximité avec le village, lieu de vacances chez les grands-parents.
Le village ? Il faut s’attarder ici sur le destin de cette entité, qui s’inscrit dans une histoire dont l’unité de mesure est le siècle, voire le millénaire – Fernand Braudel la plaçait ainsi au cœur de sa réflexion – et qui va, dans les quelques décennies à peine qui suivent ces années 1960, connaître une mutation sans précédent par sa rapidité et son intensité. En ces temps, ce village demeure un symbole fort de cette civilisation rurale française qui constitue le socle de la France du milieu du XXe siècle, mais qui commence alors à s’étioler. Sa place ultérieure constitue donc une sorte de papier chimique reflétant le rythme et les formes prises par cet étiolement.
Il y a tout d’abord, à cette période, ce reflux majeur de la proportion des paysans dans la population active, consommé, on l’a vu, dès le recensement de 1968. À tel point que, l’année précédente déjà, le sociologue Henri Mendras diagnostique, dans un livre au titre délibérément provocateur, La Fin des paysans. Puis, précisément parce qu’il apparaît ainsi comme un monde fragilisé et donc menacé, le monde des paysans deviendra dès la décennie suivante un lieu de luttes pour l’écologie naissante : c’est l’époque où les causses du Larzac polarisent l’attention des médias et où leur défense face à un projet d’extension du camp militaire déjà présent paraît à la pointe des mouvements sociaux. C’est l’époque, aussi, où ce monde menacé deviendra, pour certains, un monde en marge de la ville et le lieu de la « vie en communauté », retour présumé à l’innocence des sociétés préindustrielles et contrepoint élégiaque postrévolutionnaire. À la croisée de l’écologie défensive et de cette tentation du retrait, il y a bien la reconnaissance indirecte d’un monde qui risque de disparaître. Les luttes au nom du « Larzac » ou la fondation de « communautés » coloreront ainsi le premier versant des années 1970 des teintes de la nostalgie et d’une sorte de mélancolie historique, qui sont autant de symptômes d’une France dont la mutation s’est encore accélérée après ces années 1960.
Mais, dans une étude s’assignant aussi d’analyser les logiques du vivant à l’œuvre dans l’histoire française récente, le destin du village ne s’arrête pas à ce glas qui semble alors sonner pour lui. Il réapparaîtra à plusieurs moments de cette étude. Moment politique, par exemple : ainsi le village sur l’affiche symbolisant « La force tranquille » de François Mitterrand, en 1981. Moment sociologique, également : au fil des décennies s’est retressé dans les campagnes françaises un tissu conjonctif grâce non plus seulement au maintien sur place des plus âgés ou des paysans toujours moins nombreux – 3,6 % des actifs en 2015 – ou au retour d’une partie des retraités, mais, plus largement, au phénomène de rurbanisation aux raisons complexes. Certains sociologues – ainsi Jean-Pierre Le Goff – considèrent néanmoins qu’il ne s’agit plus, en l’occurrence, d’une « société villageoise », qui poursuivrait son déclin avec, se profilant à l’horizon de ces premières décennies du XXIe siècle, la « fin du village ». Il reste que, par-delà les questions de terminologie, il y a bien eu dans les années 1950 et 1960 un glissement de peuple des villages vers les villes au moment même où la France poursuivait par ailleurs la construction européenne et que les pratiques culturelles en son sein commençaient, on le verra, à être influencées par une culture-monde en gestation. S’est déroulée, à partir de ces années 1960, une grande mutation de l’Occident dont la France fut assurément partie prenante et dont l’amorce du recul de la société villageoise fut un symptôme majeur.
Mais revenons à la date de 1962. Celle-ci, on l’a déjà constaté, est essentielle : après l’indépendance de l’Algérie, la France se retrouve alors rétractée aux dimensions d’un hexagone. Une nouvelle génération s’y éveille, sur laquelle nous reviendrons plus loin : il s’agit des baby-boomers, nés après la Seconde Guerre mondiale. À ceux-ci appartient le Français de 1980, pour reprendre l’étalonnage commencé avec ceux de 1900, 1930 et 1950. Celui-ci, pour l’heure, en ce début des années 1960, parvient à l’adolescence dans cette France géographiquement rétractée, qui est aussi une France pour la première fois en paix depuis longtemps. Le point est essentiel et, là encore, on y reviendra. Toutefois, observons d’emblée que 1962 est un millésime essentiel de notre histoire nationale, mais aussi un coin dans la morphologie générationnelle de la France : le Français de 1980, né dans la décennie de l’après-guerre, n’aura pas la même histoire que celle qu’avaient connue le Français de 1900, celui de 1930 ou encore celui de 1950. Ou, plus précisément, il ne vivra pas son histoire dans la même France que ses prédécesseurs.
D’autant que 1962 introduit aussi une autre forme d’inédit dans cette France : s’y déploie un nouveau régime politique, la Ve République, qui prend alors ses traits sinon définitifs, en tout cas fixés pour des décennies. Cette république, certes, était née en 1958, mais c’est la bataille politique de l’automne 1962, au...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Dédicace
- Introduction. La France des grandes mutations
- Mode d’emploi. À la croisée des ères et des aires
- Première partie - Les craquements de la France d’avant
- Deuxième partie - La fin des « années faciles »
- Troisième partie - Le changement du monde
- Quatrième partie - Une perte d’autonomie ?
- Retour vers 1958 ?
- Bibliographie indicative
- Table
- Quatrième de couverture