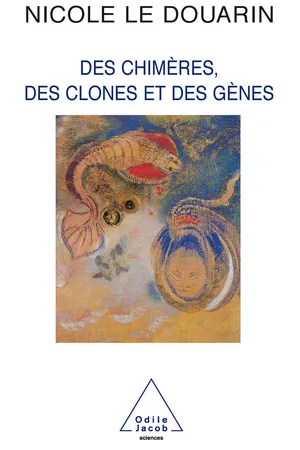
- 496 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Des chimères, des clones et des gènes
À propos de ce livre
« Chacun de nous a commencé sa vie sous la forme d'une cellule, l'œuf. Certes, nous sommes habitués à cette idée ; elle suscite cependant, lorsqu'on s'y attarde, incrédulité et interrogations. Comment se peut-il que de cette cellule unique, "isolée", surgissent les constituants du corps de l'adulte, faits de plusieurs milliards de cellules harmonieusement ordonnées pour former des organes aussi différents et complexes que le cerveau, les membres, les yeux et le visage ?Ce livre a pour ambition de donner au lecteur une idée de ce qu'est le développement des organismes et l'état actuel des recherches dans ce domaine. Il se propose de révéler l'extraordinaire diversité des facteurs et des processus qui, ensemble, président à la formation d'un être vivant. Après la brebis Dolly et les cohortes de moutons et de veaux clonés, chacun est en droit de se demander si on n'en viendra pas un jour à appliquer ces méthodes à l'espèce humaine. Voilà qui suscite des espoirs et des craintes qui doivent être évalués raisonnablement. » Nicole Le DouarinNicole Le Douarin est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, de la National Academy des États-Unis, et de la Royal Society de Londres. Elle vient d'être élue Secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Des chimères, des clones et des gènes par Nicole Le Douarin en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Biological Sciences et Genetics & Genomics. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Partie 1
Les origines de la biologie
du développement
du développement
Chapitre 1
La naissance des sciences de la vie
La cellule, l’évolution, les gènes
Introduction
La reproduction des êtres vivants n’a cessé d’être un sujet d’émerveillement pour l’humanité. Comment expliquer la génération d’un embryon, puis d’un adulte, à partir de la rencontre des « semences » ? D’où vient que l’être nouveau, dont tant de traits rappellent ceux de ses parents, présente aussi des variantes qui en font une créature, à bien des égards, unique ? Face aux mystères de la vie, de la génération et du développement, les philosophes et médecins de l’Antiquité ont su très tôt, par le simple usage de la réflexion sur des données d’observation courante, dégager les principaux types d’hypothèses possibles, qui ont longtemps servi de repères pour la recherche, même si la science en a radicalement modifié le sens et la portée.
De fait, une fois reconnus certains caractères propres au vivant — autoreproduction, autonomie, individuation… —, les principes généraux susceptibles d’en rendre compte s’avèrent finalement peu nombreux, malgré la grande variété de théories que permet leur combinaison. Brièvement dit : ou bien on tente de réduire la vie aux relations causales qui commandent la matière inanimée (mais le risque est alors d’occulter la spécificité du vivant) ; ou bien on doit imaginer l’intervention d’un « principe » vital dont la définition ne laisse pas d’être problématique.
Face aux contradictions qu’entraînaient ces deux modèles, la pensée antique fut conduite à les affiner par la formulation d’une alternative complémentaire. De deux choses l’une, en effet : soit on considère l’individu adulte comme un simple agrandissement de l’embryon (où tous ses caractères seraient, dès l’origine, présents, y compris… la totalité de sa descendance « en réduction ») ; soit on suppose que les formes et fonctions vitales se construisent progressivement, au cours du développement, sous l’effet d’énigmatiques causes organisatrices.
Ce jeu d’hypothèses, en dépit des difficultés qu’il soulève, a continué d’inspirer les « savants » qui s’interrogeaient, par exemple, sur le contenu des « semences » ou sur le rôle respectif de l’élément masculin et de l’élément féminin, avant la démonstration définitive, au XIXe siècle, que l’unité de base est la cellule : le nouvel être résulte de l’union de deux cellules, l’ovule de la mère et le spermatozoïde du père.
Le profond renouvellement de l’étude et de la connaissance du vivant qui accompagne cette découverte majeure tient, autant qu’à la mise au point de méthodes expérimentales inédites, à la création d’une série de concepts originaux — « évolution », « milieu intérieur », « cellule » — qui ont tous en commun de satisfaire simultanément deux exigences auparavant inconciliables : ils définissent des entités et des modes de fonctionnement qui ne valent que pour la vie, mais ils conçoivent ces propriétés autonomes du vivant comme les conséquences d’interactions complexes conformes aux lois générales de la matière inerte. Sur la base des relations physico-chimiques qui régissent les constituants des êtres vivants émergent des caractéristiques nouvelles absolument propres à la vie.
Les niveaux supérieurs d’intégration des données physiques et chimiques telles qu’elles existent dans le monde vivant instaurent en effet des types de relations bien distinctes de celles que l’on rencontre dans le monde inanimé.
Tout se passe comme si les hypothèses de l’Antiquité, débarrassées de leur excessive généralité, appuyées sur des faits et réconciliées, retrouvaient chacune leur place dans la conception hiérarchisée des lois du vivant qui prend corps au XIXe siècle.
On pouvait enfin dépasser l’antinomie entre, par exemple, l’idée que l’embryon est le modèle réduit de l’adulte et la théorie selon laquelle celui-ci acquiert progressivement ses caractères. Rien n’empêchait plus de concevoir la cellule initiale, tout à la fois, comme dotée de ce qui permettra le développement de l’individu — qu’en ce sens elle préfigure — et comme anatomiquement et fonctionnellement différente de lui.
Après l’avènement de la génétique au début du XXe siècle, la découverte en 1953 de la structure du gène et de ses capacités d’autoréplication leva un voile sur l’origine d’une des propriétés les plus fondamentales de la vie. Depuis 1975, la révolution du génie génétique a considérablement enrichi nos connaissances en ce domaine : le problème de la transmission des caractères héréditaires n’apparaît plus comme un mystère défiant l’entendement.
Il faut insister sur l’extraordinaire changement de perspective que traduisent ces avancées par rapport aux tendances dominantes qui orientaient les recherches du siècle précédent.
Là où l’on cherchait des constituants et des relations évoquant au mieux les manifestations typiques de la vie, les généticiens découvrent les molécules qui codent le développement de ces entités et conditionnent en grande partie leur fonctionnement. Cette nouvelle approche, plus « structurale », rompt avec nos représentations intuitives du vivant : on ne cherche plus « les états élémentaires » de la vie mais, derrière eux, les éléments qui en commandent la construction.
Reste à expliquer par quelles voies le matériel génétique, l’acide désoxyribonucléique (ADN) qui constitue notre patrimoine héréditaire, dirige le développement embryonnaire. Dans l’ADN se trouve, en un certain sens, l’être virtuel préformé que les Anciens imaginaient. Mais comment ce message codé est-il mis à exécution au cours du développement pour créer un embryon ? Telle est aujourd’hui la question principale qui occupe les embryologistes, dès lors que génétique et biologie du développement agissent de concert pour achever d’éclairer ce qui fut durant des siècles le mystère de la génération.
Ici se dessinent les prémices d’une nouvelle révolution dans la pensée du vivant. Car la fécondité même de la recherche génétique ouvre désormais la voie à l’étude de la stupéfiante diversité des phénomènes physico-chimiques qui découlent indirectement de l’action du génome. Celui-ci les orchestre au profit de l’être dont il dirige la construction puis les régulations : une vision plurielle de la vie se dégage ainsi, renvoyant à des formes de causalités plus ouvertes, moins linéaires, mais dont la variété n’empêche pas la coopération sous la direction du « code » qui les programme ou les gère. Au lieu de prétendre, coûte que coûte, ramener la vie à un type unique de causes, on se rend compte qu’elle se caractérise par la faculté de fédérer et de reproduire, dans des unités autonomes, les processus originaux qui émergent d’une pluralité de facteurs.
Les brefs aperçus historiques de ce chapitre s’attacheront à faire ressortir le sens des bouleversements successifs que l’on vient d’évoquer touchant notre compréhension de la reproduction et du développement des êtres vivants. C’est une étape indispensable si l’on veut comprendre les vrais enjeux des recherches scientifiques plus récentes dont la présentation et l’analyse constitueront le cœur du présent ouvrage, de pair avec une réflexion sur les applications médicales, les problèmes éthiques, les changements culturels, voire l’évolution des mœurs qui en résultent ou peuvent en résulter.
La vie entre l’harmonie et le chaos : le concept de génération chez les Anciens
S’agissant de la reproduction, on est émerveillé de voir comment les Anciens ont su, pour ainsi dire, faire le tour du problème, formuler clairement l’ensemble des grandes hypothèses possibles, même si les conclusions qu’ils ont cru devoir en tirer ne nous sont plus, quant à elles, d’aucune aide. Mais leurs efforts n’auront pas été vains : sans doute fallait-il d’abord recenser les principales perspectives envisageables sur la question afin de disposer d’un cadre qui pût ensuite guider des observations et des recherches plus précises.
Deux idées ont, en ce domaine, guidé les philosophes et les médecins de l’Antiquité, la plupart pour les magnifier, quelques-uns, très rares, pour les combattre, ce qui était encore une façon de les placer au centre de leurs réflexions.
La première est celle de l’Harmonie du cosmos : le monde est un univers clos sur lui-même dans lequel chaque être a sa place où peut se manifester son excellence propre. Dans cette totalité hiérarchisée, la vie occupe une position intermédiaire entre le mouvement éternel de la sphère céleste et la passivité de la matière inanimée : le cycle des générations reproduit dans le temps l’éternelle perfection de la course circulaire des astres.
La seconde idée, corrélative de la première, est que la reproduction des êtres vivants apparaît comme un phénomène trop extraordinaire pour ne faire intervenir que des causes communes à l’ensemble de la matière, même si on imagine souvent qu’elle puisse en dériver indirectement par génération spontanée. Bref, il faut rendre justice à ce que la vie, en chaque individu, a d’unique. Toute la question est alors de choisir entre deux manières de théoriser ce mystère de la vie : vaut-il mieux poser que l’individu doit être complètement formé dès sa conception (car on n’imagine pas qu’il puisse être reconstitué par « morceaux » dont chacun ne saurait être viable isolémentI) ; ou est-il préférable de considérer qu’un « principe vital » immatériel dirige, en s’incarnant dans la matière, la formation progressive du vivant en gestation ?
Deux théories principales ont donc été proposées pour expliquer la formation des êtres par la reproduction. Une première théorie, dite de la préformation, défend l’idée, formulée de diverses manières, selon laquelle l’être futur est contenu d’une façon physique ou virtuelle, visible ou non visible, dans la « semence » (terme qui, selon les auteurs, peut désigner l’œuf aussi bien que les gamètes mâle et femelle). On se représente cet être, à l’origine, soit comme un individu miniature, complètement ou partiellement déterminé, soit sous la forme de « particules représentatives » dont la nature demeure énigmatique mais dont l’assemblage reproduirait un organisme.
Selon l’autre conception, celle de l’épigenèse, l’embryon se forme progressivement, une étape après l’autre, en accomplissant une « morphogenèse » (élaboration de formes) qui fait aller le germe du simple au complexe.
Les idées les plus anciennes tendant à expliquer, selon une démarche sinon scientifique, du moins rationnelle, la nature du développement remontent à HippocrateII. Celui-ci indique, dans son traité sur la génération, que le développement d’un fœtus est le résultat de la rencontre des semences de l’homme et de la femme. Il pense que les semences sont des émanations de toutes les parties individuelles du corps. Les caractéristiques propres de chacune de ces parties chez le père et la mère peuvent donc être transmises à la descendance. Une anomalie ou une déficience affectant une de ces parties chez les parents peut ainsi se retrouver chez les enfants. Pour Hippocrate, le sexe du fœtus est déterminé par le jeu des « forces » contenues dans chaque semence : quand la semence mâle est plus forte que la semence femelle, il naît un mâle, et inversement. L’homme et la femme possèdent à la fois une semence mâle et une semence femelle : c’est la confrontation des tendances contenues dans les semences qui détermine les caractères du nouvel être, y compris son sexe.
Cette théorie dite de la « panspermie » ou « pangenèse » a été reprise par de nombreux auteurs au moins jusqu’à la fin du XIXe siècle et notamment par Charles DarwinIII. Elle s’accorde avec l’idée d’une transmission à la descendance des caractères acquis pendant la vie individuelle tant sous l’effet de l’environnement qu’en raison de l’usage plus ou moins intensif d’un organe.
Le premier grand naturaliste dont les écrits sont parvenus jusqu’à nous est AristoteIV. Il fut un excellent observateur et le premier à distinguer une ...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Avant-propos
- Introduction
- Partie 1 - Les origines de la biologie du développement
- Partie 2 - Comment se construit un embryon ?
- Partie 3 - Sculpter le corps de l’adulte
- Partie 4 - Du laboratoire à la clinique
- Glossaire
- Bibliographie
- Cahier photos
- Index