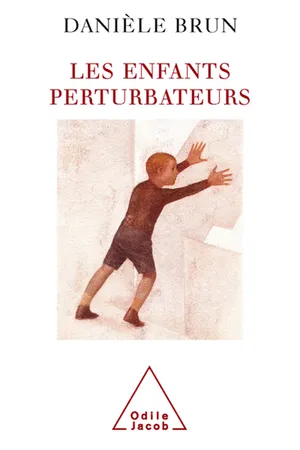
- 192 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Les Enfants perturbateurs
À propos de ce livre
« Faites ce que vous voulez, de toute façon ce sera mal », disait Freud de l'éducation des enfants. Pourquoi tant de malentendus de part et d'autre ? Pourquoi les enfants ont-ils le sentiment d'être incompris ? Et de ceux qu'ils admirent le plus… Pourquoi les parents sont-ils au désespoir de ne rien comprendre ? Et à ceux qu'ils aiment le plus au monde…Sur de multiples exemples cliniques, Danièle Brun montre comment les enfants ont besoin, pour se construire, d'un espace intime qui leur permet de chercher et de trouver leur solution à leurs problèmes. Or les parents s'ingénient à piétiner cet espace par souci d'adapter le plus vite possible les enfants aux exigences de la société : l'école, les bonnes manières, les valeurs communes. Dans ce livre, Danièle Brun montre une issue : comment les parents doivent se réconcilier avec leur propre enfance pour laisser se déployer la plasticité de leurs enfants. Danièle Brun, psychanalyste, est professeur de psychopathologie à l'université Paris-VII-Denis-Diderot. Elle a publié La Passion dans l'amitié.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l'application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux forfaits: Essentiel et Intégral
- Essentiel est idéal pour les apprenants et professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la Bibliothèque Essentielle avec plus de 800 000 titres fiables et best-sellers en business, développement personnel et sciences humaines. Comprend un temps de lecture illimité et une voix standard pour la fonction Écouter.
- Intégral: Parfait pour les apprenants avancés et les chercheurs qui ont besoin d’un accès complet et sans restriction. Débloquez plus de 1,4 million de livres dans des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. Le forfait Intégral inclut également des fonctionnalités avancées comme la fonctionnalité Écouter Premium et Research Assistant.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l’application Perlego sur appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n’importe où — même hors ligne. Parfait pour les trajets ou quand vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Oui, vous pouvez accéder à Les Enfants perturbateurs par Danièle Brun en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Psychology et Developmental Psychology. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
1
De la curiosité à la plasticité
De tous les mouvements intérieurs qui animent un bébé depuis la naissance, c’est la curiosité qui s’éveille en premier. Elle est marquée, dès ses débuts, de tâtonnements qui ne la quitteront pas. Cela commence au moment de la rencontre du nouveau-né avec le monde extérieur qui soulève en lui une multiplicité d’émotions et de sensations inconnues. Les poumons se déploient à l’air libre et son cri se fait entendre. Il est à la fois mesurable et mesuré, comme l’un des signes majeurs d’ouverture sur la vie. Il engage aussi la vie psychique de façon décisive. Le cri est un appel auquel l’adulte va désormais réagir et répondre tandis qu’in utero l’immédiateté était assurée par les apports du cordon ombilical. La découverte de l’intervalle qui sépare l’appel de la réponse est donc essentielle à l’inscription du bébé dans l’univers qui l’accueille. Le délai, si court soit-il, qui s’écoule entre son premier cri et la réponse qu’y apporteront les adultes suscite immanquablement l’éveil de sa curiosité.
Quel est ce nouveau milieu dans lequel il arrive ? Ces bruits, ces voix, ces odeurs, cette lumière, les connaît-il ? Qu’annoncent-ils ? La proximité ? L’éloignement ? Les bras ? La satisfaction du besoin ? La solitude ? Que lui fait-on ? Que lui dit-on ? Que lui veut-on ? Malgré le peu de coordination de ses gestes, la maladresse de ses vocalises et l’impromptu de ses sursauts, ils sont pour le bébé la principale voie d’expression d’une curiosité qui s’éveille face à l’attente et à ses incertitudes.
La curiosité donne lieu à une activité de pensée spontanée qui se développe en contrepoint de toutes celles qui sont demandées dès la naissance, telles que boire, manger, dormir, babiller, marcher, courir, apprendre, parler, et que les progrès du développement diversifient au fil des ans.
Une foule de questions apparemment simples mais dont les enjeux sont complexes, peuplent l’esprit du bébé depuis l’aube de la vie. Les voies d’entrée dans un questionnement sont toujours plus simples que les réponses qu’elles appellent, surtout lorsqu’elles portent sur des thèmes intemporels. L’enfant s’y engage très tôt. Sans bien savoir comment ni pourquoi il pense à la naissance, à la mort, et au sexe. Autant d’interrogations très éloignées de ses activités et de son mode de vie, qui ne peuvent recevoir que des réponses provisoires, même si l’acquisition du langage, les jeux et les dessins lui ouvrent peu à peu de nouvelles possibilités d’expression.
La plasticité, qui apparaît au long de ce livre comme un élément essentiel de la vie psychique, est une forme de réponse à la sensation d’inadéquation que crée la curiosité insatisfaite. Elle est une activité de pensée particulière qui permet à l’enfant dès l’aube de la vie de découper un espace virtuel à l’intérieur duquel il construit des scénarios personnalisés sur sa ou ses raisons d’être au monde et de participer aux différents modes d’existence qui lui sont proposés.
La notion de plasticité va plus loin que ce que laisse entendre le mot dans le dictionnaire. Il faut imaginer la plasticité de l’amibe qui tantôt se déploie, tantôt se rétracte, ou celle de l’araignée qui tisse sa toile avec constance au mépris de la fragilité, disons aussi de la précarité, de sa construction.
Combler, par soi-même, avec la trace de ses émois et de ses blessures d’enfance, l’espace nécessairement troué ou incomplet qu’ouvrent les questions sur l’origine de la vie et sur son devenir, telle est la principale dynamique de la plasticité. En elle résident les désirs inavoués et inavouables de la toute petite enfance qui créent la confusion à tous les sens du terme, tant en ce qui concerne la possibilité de les mettre en mots pour autrui comme pour soi-même, qu’en ce qui concerne la nature des émotions qu’ils soulèvent.
Chez l’enfant, l’espace de la plasticité évolue, au fil des années, aménageant un subtil alliage entre les exigences du monde extérieur – ses parents et sa fratrie –, et celles de son monde interne, pulsionnel. Il s’agit en fait d’un fragile équilibre qui parfois met en péril les signes de sa curiosité et les scénarios qui y sont associés.
Voici, à titre d’illustration de ce mouvement inédit et de ses indices, une anecdote issue de la vie quotidienne.
La scène se passe à la terrasse d’un bistrot où je me trouve en compagnie de deux amis ukrainiens. Les tables sont très proches l’une de l’autre. La conversation porte sur leur pays où je suis allée une fois il y a fort longtemps. Soudain, depuis la table qui jouxte la nôtre où sont assis face à face un homme et un petit garçon d’une dizaine d’années, sans doute son fils, l’homme tourne sa chaise vers nous et nous adresse la parole. Il a entendu que nous parlions de l’Ukraine. Justement, sa femme est là-bas, c’est là-bas qu’il l’a connue. Ses beaux-parents sont venus en France récemment. Ils sont repartis et lui y part prochainement pour faire baptiser son fils.
En entendant le père dire « mon fils », le petit garçon qui est lui aussi, à l’évidence, le fils du monsieur, intervient avec un air interrogateur : « Moi, demande-t-il ? – Non, pas toi », répond le père avec un léger agacement, sans apercevoir la mine soucieuse de son garçon ni la portée de sa question qui s’entend comme un « Qu’est-ce qui va m’arriver ? » « On va bientôt baptiser mon fils », a dit le père. L’inquiétude n’est peut-être pas justifiée mais elle trahit, pour ce jeune garçon que l’on n’a pas encore emmené dans ce pays lointain, toutes les questions et les émotions, jalousie comprise, qu’a provoquées le changement intervenu dans sa vie : la séparation de ses parents, la venue d’une nouvelle femme et d’un nouvel enfant avec une nouvelle langue que son père ne parle d’ailleurs pas. Mais il sait mieux que son enfant lutter contre l’étrangeté d’une situation. La preuve, il demande à l’un de mes amis de lui traduire le texto que sa femme, aussitôt informée de la rencontre que son mari vient de faire, a adressé en retour dans sa langue maternelle. Elle souhaite « bon appétit » à tout le monde. Si le père parut tranquillisé, le petit garçon resta en panne avec sa question mal formulée dans laquelle se logeaient sa curiosité et une activité de pensée relative à la nouveauté de la situation pour laquelle son père s’excitait tout en le tenant à l’écart de ce qui allait arriver.
Même si les mots pour la dire sont le plus souvent en deçà de ceux qui seraient nécessaires à sa reconnaissance, la plasticité est une forme d’activité de pensée inhérente à la curiosité et aux effets d’étrangeté qui la mettent en éveil. L’espace qu’elle découpe permet à l’enfant d’y interroger sa position à partir des réactions puis des questionnements que suscitent les événements auxquels il participe. Cette activité de pensée lui appartient en propre. S’y esquisse une conception du monde où coexistent un avant et un après. « Moi ? » a demandé l’enfant en entendant le père parler de son fils. Il fallait qu’il se rende à l’évidence. Il devait admettre qu’il ne s’agissait pas de lui. La plasticité de l’enfant, activité singulière par excellence, est faite de mouvements positifs de satisfaction et négatifs de contestation. Elle est le corollaire de la nécessaire dépendance de l’enfant à l’égard des adultes, la contrepartie bien souvent négligée, sinon ignorée, des activités qu’il lui est demandé d’accomplir aux différentes périodes de son existence. De là surgissent souvent des états de tension que la réussite ou les prouesses ne suffisent pas à apaiser.
Ces états de tension trouvent leur paradigme chez le bébé qui en témoigne en criant depuis les premiers temps de son existence. Dans l’alternance entre les états de tension et les temps d’apaisement, il met toute sa sensorialité en éveil : il écoute les bruits, les voix, il perçoit les odeurs, il reconnaît l’approche des pas. Il parvient petit à petit à anticiper la venue de la satisfaction, la tétée, par exemple, et à en fabriquer l’image hallucinée en tournant tous ses sens à la fois vers l’extérieur et sur son propre corps. S’il découvre les bienfaits du suçotement, du pouce ou des mouvements de la langue entre ses lèvres, c’est qu’il a reconnu, intégré les sensations issues de la rencontre de ses lèvres avec la tétine ou avec le sein. Très tôt, il se donne par lui-même une part du plaisir qui dépend du bon vouloir de l’autre ; de cet autre maternel qui a su, par ses soins, et par le corps à corps des premiers temps, éveiller sa curiosité et ses sens. Mais l’autoérotisme n’a qu’un temps. Le bébé ne peut pas se passer de la présence de l’autre et ses absences le tourmentent. Les preuves de l’amour maternel se mesurent, pour lui, à l’aune de la satisfaction de ses besoins qui, au-delà des exigences de survie, impliquent l’élection de zones érogènes. Ainsi la sexualité infantile fait-elle entendre très tôt ses exigences. Elle connaît des déceptions et des forçages précoces, qui retentissent sur la plasticité.
L’adaptabilité, comme celle qui permet à un enfant adopté de parler la langue de ses parents adoptants et de prendre leurs habitudes de vie, n’est pas ici en cause. Ce type de facilitation est davantage à situer du côté de la malléabilité du petit enfant, c’est-à-dire du côté des effets de l’empreinte de l’adulte et de ses manières qui marquent une appartenance réciproque.
La dépendance native du petit enfant sur le plan moteur comme sur celui de l’acquisition du langage et, plus généralement, sur celui de sa survie, le montre soumis à l’influence de l’adulte, que ce dernier soit, ou non, animé par le souci de son bien. Pourtant, parallèlement à sa malléabilité et à son adaptabilité qui vont lui permettre d’obéir aux ordres ou aux prescriptions, l’enfant peut se révéler perturbateur.
Perturbateur, au sens où il ne mange pas, où il ne dort pas, où il vomit, où il se scolarise mal, bref, au sens où il se livre à toutes sortes d’écarts qui inquiètent les parents quand ils ne mettent pas en défaut leurs projets ou leurs principes éducatifs. Ces différents écarts auxquels tous les parents vont, à un moment ou à un autre, tenter de remédier soit par eux-mêmes, soit en recherchant de l’aide, constituent une sorte d’appel silencieux. Ils contiennent les signes d’une plasticité bâillonnée.
Cela commence fréquemment dans les deux premières années de la vie sous la forme d’un forçage de nourriture ou de sommeil au nom d’un « bien faire » ou d’une autorité devant lesquels les petits enfants, à leur façon, s’esquivent. Ce n’est pas comme on le pense trop souvent un esprit de contradiction prématuré qui s’exprime ainsi. Il faut plutôt y voir la preuve d’une pâle résignation devant des efforts de pensée déboutés. À peine ouvert, l’espace de la plasticité se referme. Et curieusement, à leur tour, devant les symptômes de leur enfant, les parents, à un moment ou à un autre, s’inclinent. Une relation médiatisée par le refus potentiel de l’enfant à se soumettre s’instaure.
C’est à ce niveau, en ce cas, que se découvre l’écrasement de l’espace dans lequel l’enfant doit pouvoir laisser évoluer sa plasticité et s’inscrire dans une temporalité où le présent est fait de remaniements successifs. Très tôt, le passé est idéalisé et vécu comme perdu, tandis que l’avenir peine à être anticipé.
Si la situation psychanalytique se prête mieux que toute autre à mettre en valeur les blocages de la plasticité ainsi que ses relances, la vie quotidienne fournit de nombreuses occasions propices à son expression, à condition d’y être attentif.
Au premier exemple donné plus haut, j’ajouterai la description d’une scène dont je fus également le témoin. C’est l’une de ces scènes qui s’inscrit au cœur de ce que chacun a pu vivre en tant que parent ou en tant qu’enfant et qui le plus souvent s’oublie sauf si elle se répète trop souvent, auquel cas elle produit un traumatisme.
Assise à proximité d’un comptoir d’embarquement à l’aéroport, dans l’attente d’un avion, mon attention est attirée par l’agitation inconsidérée d’un petit garçon d’à peine deux ans. Une femme, vraisemblablement sa mère, lui donne compulsivement à manger, habitée par une angoisse perceptible. Elle tient le petit garçon d’une main, la cuiller de l’autre et, joignant le geste à quelques paroles, elle lui présente inlassablement des cuillerées que tantôt il prend, tantôt évite, tantôt refuse. Elle tente aussi de le distraire en attirant son attention sur un livre d’images qu’elle a placé sur ses genoux pendant qu’elle lui enfourne la nourriture dans l’espace qu’il laisse entrouvert, et qu’il mâchouille lentement ce qu’elle parvient à y faire entrer. Je remarque qu’il jette un œil distrait sur le livre d’images, tout occupé qu’il est à tourner la tête de côté quand la cuiller arrive pour qu’elle manque sa cible, à savoir la bouche. Vient le moment où il s’avise de regarder autour de lui et où il aperçoit sur le banc voisin un bébé que sa mère nourrit tendrement au biberon. Je le vois s’attarder sur le spectacle qu’ils lui offrent avec un long regard d’envie. Son visage a changé, il s’est extrait de l’emprise maternelle et, sans s’en rendre compte ni le savoir, il a l’air de reconnaître chez ce bébé tranquille le signe d’un temps heureux, d’un autre temps dans un autre monde qui n’est pas le sien aujourd’hui. Une sorte de lucidité dont il ne peut rien faire me paraît se mêler à l’impuissance dans laquelle il se trouve.
Cette forme de lucidité et d’envie pour les conditions de vie idéalisées d’un autre participe, chez l’enfant, de l’exercice de sa plasticité naturelle. Elle exige la rencontre avec l’autre pour se mettre en mouvement. On pourrait presque dire que s’esquisse ainsi en lui une forme de conception de l’existence, une manière précocement personnelle de penser. Un très petit enfant peut faire d’un instantané le substrat d’une image de liberté dont le contenu ne parviendra peut-être même pas à sa conscience mais qui constituera un creuset que d’autres images, d’autres traces viendront plus tard réactiver.
Pendant ce temps, la mère, tout occupée à sa tâche de nourrissage, ne laisse aucun répit à son petit garçon. Elle n’a pas vu qu’il tournait la tête ailleurs, elle ne saura rien de l’image d’un repas paisible sur laquelle son regard s’est porté.
Elle continue sans état d’âme son gavage tandis qu’il montre, en avançant la langue, des signes de préparation au vomissement. Il va vomir, c’est sûr puisqu’elle ne prend pas son refus en compte, puisqu’elle s’applique à le faire manger malgré tout et qu’elle a hâte – c’est évident – que le petit pot du goûter se vide. Il se met à tousser doucement d’abord, puis de plus en plus fort et il vomit une partie de ce qu’il a fini par ingurgiter. Curieusement, la mère ne s’agite plus. Serait-elle habituée, quasiment prête à la fin de repas qui se préparait ?
Elle recueille soigneusement le vomi chocolaté dans une serviette. Ses gestes sont précis et sûrs. Pendant ce temps, l’enfant crache de nouveau, et il salit le fauteuil où ils sont assis tous les deux, puis il tousse une nouvelle fois peut-être pour enlever le mauvais goût de sa gorge car il a l’air gêné. Ensuite il ne paraît plus maîtriser la situation qu’il laisse se dérouler comme s’il n’y était pour rien. Il vomit en jets le reste du petit pot que la mère s’est donné tant de peine à lui faire avaler.
Les odeurs qui parviennent jusqu’à moi m’incitent à changer de place et à observer les événements de plus loin. Sans se fâcher ni le gronder, la mère sort un paquet de lingettes et des vêtements propres. Après avoir nettoyé le tout, elle court vers la poubelle jeter le vomi ramassé dans les lingettes. Quelques minutes plus tard, l’enfant est propre comme un sou neuf, apaisé ; sa mère aussi. D’ailleurs elle ne le retient plus et il se met à courir un peu, ici et là, sans regarder personne. Sans doute est-elle satisfaite d’avoir fait ce qu’elle pouvait pour qu’il mange tout en voulant le distraire avec un livre d’images. Mais elle n’a pas, ce faisant, attiré sa curiosité qui s’est portée ailleurs.
Dans ce rôle de nourrissage on voit se dessiner la part presque caricaturale que la mère prend dans les difficultés d’alimentation de son enfant. Dans son agitation comme dans son comportement anxieux, l’excitation n’est guère maîtrisable. On ne sait plus qui elle est dans l’affrontement mêlé de séduction qu’elle livre à son enfant.
Il ne s’agit plus entre eux d’une relation entre un enfant et une adulte, mais d’une lutte entre deux parties de corps. À moins qu’il ne s’agisse – l’un n’empêche pas l’autre – d’un simulacre de lutte entre enfants. L’enfant en elle, et dont manifestement elle ne sait plus rien, a peut-être refait surface dans le combat qu’elle a livré entre son bras, armé de la cuiller, et la bouche que son enfant lui refusait. Cela s’apparente à une rencontre sexuelle ratée, comme il s’en produit de temps en temps entre parents et enfants, sans qu’aucun des partenaires en présence prenne la mesure de cette analogie. La plupart du temps, les soucis éducatifs verrouillent solidement les traces de cette résurgence qu’ils rendent inaccessible. Le combat, évidemment inégal entre parents et enfants par le biais du projet éducatif, est au fond livré aux traces d’une sexualité infantile que les adultes s’emploient à nier ou à enfouir, oublieux qu’ils sont de leur enfance et de la jouissance qu’ils ont tirée de leur corps.
La bagarre, au cours de laquelle l’enfant n’a eu aucun plaisir à recevoir la nourriture, et où il a laissé son estomac parler pour lui, s’est terminée par un apparent non-lieu. La mère et lui ont chacun vaqué de leur côté.
Toutefois, sur la base d’une vaine recherche dont il n’a eu aucune claire conscience mais qui participe de l’expression de sa plasticité, il a tenté un regard sur le monde ...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Table
- Dédicace
- Introduction
- 1. De la curiosité à la plasticité
- 2. Le corps en jeu
- 3. Les paradoxes de la sexualité
- 4. Les élans de curiosité sexuelle
- 5. Une représentation d'enfant perturbateur
- 6. L'enfant et ses objets : aux sources de la plasticité
- 7. Les enjeux de pouvoir entre parents et enfants
- CONCLUSION. Voyage à travers l'enfance
- Notes
- BIBLIOGRAPHIE
- Index
- Du même auteur
- Collection
- Quatrième de couverture