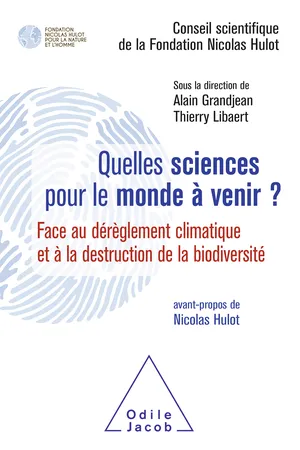
eBook - ePub
Quelles sciences pour le monde à venir ?
Face au dérèglement climatique et à la destruction de la biodiversité
- 272 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Quelles sciences pour le monde à venir ?
Face au dérèglement climatique et à la destruction de la biodiversité
À propos de ce livre
L'époque est riche en événements et situations où l'expertise scientifique est sommée de se prononcer. Quittant les laboratoires pour descendre dans la rue, elle doit affronter les lobbies industriels, les médias, et composer avec des stratégies politiques et économiques qui lui sont étrangères. La « vérité » scientifique, toujours temporaire et fragile, sort souvent malmenée de ce combat inégal. Comment faire en sorte que la science devienne la meilleure alliée de la démocratie ? C'est un vaste chantier auquel s'est attelé depuis vingt ans le Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. À partir d'exemples concrets, dont au premier chef la question du climat, il a patiemment démêlé l'écheveau d'intérêts particuliers et de modes de pensée obsolètes qui mènent à s'opposer systématiquement aux avancées de la science et à maintenir un commode statu quo (business as usual et « après moi le déluge »), même lorsque l'avenir de la planète est en jeu. Ces analyses éclairantes montrent la voie d'une meilleure dissémination de la pensée scientifique permettant à tout citoyen de décider en toute indépendance de son avenir. Ces mesures pour une saine prise en compte de la science dans le débat et l'action politiques se résument en un « pacte scientifique » en cinq points, quinze ans après le « pacte écologique » proposé par la même Fondation. Par le Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, sous la direction d'Alain Grandjean et Thierry Libaert. Avec la participation de Loïc Blondiaux, Nicolas Bouleau, Dominique Bourg, Philippe Cury, Marc Dufumier, Marie Duru-Bellat, Jean-Baptiste Fressoz, François Gemenne, Gaël Giraud, Pierre-Henri Gouyon, Jean Jouzel, Marc Lachièze-Rey, Éloi Laurent, Jean-Dominique Lebreton, Marie-Antoinette Mélières, Corine Pelluchon, Michel Prieur, Cécile Renouard, Laurence Scialom, José Tissier.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Quelles sciences pour le monde à venir ? par Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot,Alain Grandjean,Thierry Libaert,Thierry Libaert en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Physical Sciences et Meteorology & Climatology. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
La science, une activité méconnue
La science n’est pas un savoir comme un autre. Elle nous apporte une capacité de compréhension du monde jamais égalée, qui s’est accrue dans tous les domaines. Que l’on pense à notre vision de l’univers, de notre planète dans cet univers, à notre place dans la vie, éclairée par la théorie de l’évolution. Que l’on pense à la physique fondamentale et à la physique des particules, à la mécanique des solides et des fluides, à la chimie, à la thermodynamique, aux mathématiques, à la biologie, à l’écologie…
Les progrès de notre alimentation, de notre qualité de vie, de notre santé lui doivent aussi beaucoup. C’est grâce à la démarche scientifique que nous connaissons très précisément notre anatomie, que nombre de maladies sont comprises et soignées, que nos techniques chirurgicales sont si précises et efficaces ; c’est aussi à la science que nous devons les progrès de la lutte contre la douleur et l’anesthésie, la compréhension du rôle de l’hygiène et de l’alimentation sur notre santé, la croissance de l’espérance de vie à la naissance qui s’est accrue de plusieurs décennies… en quelques décennies. Si, au Moyen Âge, la peste était comprise comme un châtiment divin, faute d’explications rationnelles, aujourd’hui, le coronavirus a immédiatement pu être identifié pour ce qu’il était, un virus, et des scientifiques du monde entier se mobilisent pour trouver des traitements et des vaccins.
C’est aussi grâce à la science que nous pouvons utiliser dans la vie courante des machines de tous ordres qui réduisent considérablement nos efforts physiques (parfois au détriment de notre santé !) et nous apportent un grand nombre de facilités (en matière de déplacements et de communications) qui nous sont enviées par ceux et celles qui n’y ont pas accès. C’est encore grâce à elle que nous devons l’essor des technologies numériques et des transferts d’informations.
Si les effets possibles du changement climatique nous alertent aussi sérieusement, c’est bien parce que l’on en comprend les causes, que l’on sait modéliser le climat sur la planète, certes avec des incertitudes (qui sont identifiées), et simuler tel ou tel scénario. Si la perte de la biodiversité nous inquiète, c’est que nous l’avons documentée et comprise grâce aux recherches des écologues et des biologistes de toutes disciplines.
Plus philosophiquement, les sciences écologiques et celles du climat ont permis l’émergence d’une pensée mondiale commune. C’est au cours de ces dernières décennies qu’une telle vision a été, pour la première fois, au niveau mondial, mise à la disposition de l’ensemble de la société. Toutes ces connaissances ont convergé pour établir la notion de « bien commun mondial ».
Mais la science elle-même reste mal connue. Dans le langage courant, déclarer d’une activité ou d’un fait qu’il est scientifique ne poursuit souvent d’autres finalités que de vouloir lui conférer une image de rigueur. C’est sérieux puisque c’est scientifique. De fait, on assiste fréquemment à la reprise d’éléments scientifiques dans le débat d’idées. Qu’il s’agisse des pesticides, du climat, d’organismes génétiquement modifiés, les opinions les plus diverses et contradictoires appellent la science à la rescousse pour légitimer leur propos et décrédibiliser les points de vue opposés.
Qu’est-ce que l’activité scientifique ?
L’activité scientifique consiste à tenter d’expliquer rationnellement le fonctionnement du monde qui nous entoure, des grandes lois de l’univers jusqu’aux phénomènes qui se manifestent dans notre vie quotidienne. Elle considère que des phénomènes inexpliqués pourront l’être un jour par la raison, à condition, parfois, de modifier la raison elle-même comme on fit pour la microphysique (voir chapitre 2). La science a donc à voir avec la recherche de la vérité, tout en reconnaissant l’absence de certitudes scientifiques.
La science est en quête perpétuelle de nouvelles connaissances et accepte la possibilité de se tromper. Non dogmatique, elle s’offre à la contradiction, et l’évolution de ses paradigmes et les résultats qu’elle produit sont sans cesse confrontés à la réalité. De cela, elle tire une remarquable capacité d’évolution. La science moderne ne se contente pas de produire de nouvelles théories et de produire une description rationnelle du monde, elle met au point de nouvelles technologies toujours plus performantes. Elle est communément divisée en différents domaines, disciplines ou communautés scientifiques. On distingue classiquement les sciences exactes, mathématiques et physique théorique, les sciences de la nature, biologiques et médicales, et les sciences humaines. La complexification récente des sciences a amené à une hyperspécialisation et à la multiplication des champs d’étude, avec une accélération des découvertes de pointe, comme la génomique (science des génomes qui étudie les séquences d’ADN des êtres vivants), les nanotechnologies ou encore l’intelligence artificielle. Les « sciences fondamentales » visent prioritairement l’acquisition de connaissances nouvelles, innovantes, abstraites, et dont l’utilité n’est pas forcément immédiate, même si on leur doit des applications bien pratiques – que l’on pense au GPS et au laser, applications de la relativité générale et de la physique quantique. Les « sciences appliquées » ont comme perspectives des objectifs plus pratiques et immédiats. Si ces deux grands champs de recherche s’avèrent complémentaires, leurs limites semblent souvent floues et fluctuantes.
La science a plusieurs visées. Elle cherche à établir les faits et à les expliquer, quand c’est possible à partir d’expériences reproductibles. Une idée, fût-elle juste, n’est pas scientifique si elle n’est pas argumentable, voire réfutable1, et si, dans les cas où elle repose sur des expériences, celles-ci ne sont pas reproductibles. On doit à Karl Popper d’avoir mis en lumière le critère de réfutabilité. Il serait cependant excessif d’en faire une caractéristique générale de la science, notamment dans le domaine des sciences humaines qui se confrontent à des histoires rarement reproductibles. Mais c’est également le cas de l’astrophysique. La science permet aussi des énoncés de prudence : la mise en évidence des risques liés au changement climatique et à la destruction de la biodiversité, à la résistance aux antibiotiques, aux dégâts des accidents technologiques majeurs, la résilience limitée des écosystèmes, le fait que les marchés financiers indiquent mal la rareté des ressources, etc.
La science, en se donnant pour objectif de fournir une explication rationnelle du monde la plus achevée possible compte tenu des savoirs et des faits connus, vise aussi à faire – sans y arriver toujours – les hypothèses les plus parcimonieuses possible. Elle suit en cela un principe de base du rationalisme, énoncé au XIVe siècle par Guillaume d’Ockham, qui est de préférer les hypothèses les plus simples : leur simplicité même les rend plus plausibles que des hypothèses plus complexes. Ce principe d’élimination des hypothèses superflues, ou principe de parcimonie, est connu sous le nom de « rasoir d’Ockham ».
Ainsi, à partir des ressemblances entre espèces vivantes mises en évidence par la science au XVIIIe siècle, et l’existence de fossiles d’espèces disparues, l’hypothèse d’une évolution du vivant, dont les mécanismes seront proposés par Darwin, s’est imposée car elle donne une explication plus parcimonieuse que celle d’une création quasi instantanée du monde vivant, qui bute sur de nombreuses contradictions et des suppositions qui sortent du domaine du rationnel.
Ce dialogue ininterrompu entre établissement de vérités non ambiguës et doute permanent fait qu’à tout moment, certaines interprétations scientifiques font débat, et que le consensus ne se construit que progressivement jusqu’à ce que l’on puisse raisonnablement considérer qu’une certitude est atteinte. Certitudes et incertitudes cohabitent d’ailleurs le plus souvent : la révision quasi permanente des dates de grandes transitions (apparition de la vie, apparition des êtres pluricellulaires, premiers outils utilisés par des humains) ou la remise en question de faits considérés comme établis (la non-disparition des dinosaures, qui ont survécu à travers les oiseaux, ou les débats sur la thèse de la météorite dans la disparition des dinosaures) ne donnent bien sûr pas pour autant raison aux créationnistes. La science ne produit donc pas toujours des énoncés non ambigus. Le croire risquerait de faire confondre science et vérité et de nous conduire à une république des experts. La science ne détient pas « la » vérité.
Science et technoscience
La science, activité humaine et sociale, a pour but d’accéder à une meilleure connaissance de son objet (la nature, la vie, l’esprit, la société…), en se fondant sur l’usage de la raison à l’exclusion de tout « argument » d’ordre religieux, idéologique, politique ou partisan, pour se rapprocher de la vérité. Elle procède en dégageant des lois, le plus souvent arrangées en théories ou modèles. Son originalité, sans aucun doute à l’origine de ses réussites, vient de ce qu’elle soumet ces dernières à l’épreuve de tests observationnels ou expérimentaux, destinés à les valider ou les invalider.
Si son but essentiel est de comprendre et de transmettre, la science permet aussi parfois de prédire. Elle est également à l’origine de multiples applications (source d’innombrables objets de la vie quotidienne et des processus industriels qui les produisent). C’est le domaine dit des sciences appliquées.
Elle permet aussi d’intervenir sur la nature, domaine de la technoscience. Celle-ci a très peu en commun avec la science dans sa méthode (l’empirisme y joue un grand rôle), mais s’appuie entièrement sur ses résultats. Cette application des connaissances scientifiques est considérée comme hautement profitable à la société et à l’économie. C’est en tout cas l’opinion la plus répandue et la technoscience, issue des résultats scientifiques fondamentaux des décennies, voire du siècle passé, apparaît comme une motivation de la recherche scientifique.
L’impact de la science dans l’économie et la société est ainsi devenu considérable. Parmi ses dérives, la junk science désigne une activité qui se présente comme scientifique, mais qui n’obéit pas (ou seulement partiellement) aux critères de scientificité. Procédant par omission, trucage, fraude ou falsification de données, elle est pratiquée dans le but de justifier l’autorisation ou le soutien à une activité économique ou commerciale (tabac, produits alimentaires, médicaux, agricoles). Ses agents, qui peuvent très bien avoir une formation et un poste scientifiques, ont des intérêts liés à cette activité, ce qui relève du lobbying, voire de la corruption, ou bien désirent soutenir une idéologie, en général liée à la religion (créationnisme en biologie, ou « anthropisme » en cosmologie).
Il est difficile de nier que la science est source de progrès, même si ce dernier est difficile à définir. Mais, au vu des dégâts du productivisme directement issu de la technoscience (pollution, épuisement des ressources, réchauffement de la planète, déchets nucléaires, risques divers), la notion est de plus en plus remise en question : nul ne doute que la technoscience génère des nuisances. À cet égard, le scientisme minimise ces nuisances au regard des aspects bénéfiques, et surtout soutient que les technosciences elles-mêmes leur apporteront des solutions. Cette position est de plus en plus difficile à soutenir.
La science n’a pas de prétention à la vérité absolue et fait du doute une de ses valeurs. Ce faisant, elle ouvre une brèche en posant le principe du doute permanent dans ses principes. Pour autant, on ne peut remettre en cause sans arguments eux aussi scientifiques les concepts et résultats scientifiques et l’explication du monde qu’ils sous-tendent. Qui mettrait en doute aujourd’hui la valeur de l’accélération de la pesanteur sur Terre, le fait que la planète soit sphérique et tourne sur elle-même, la dérive des continents, la fission nucléaire ou la transmutation de l’azote atmosphérique par les rayons cosmiques ? Qui remettrait en cause l’absorption du rayonnement solaire par le CO2 atmosphérique, l’absorption des ultraviolets par l’ozone, la composition chimique de l’eau ou la décroissance progressive de la radioactivité de l’uranium et autres atomes radioactifs comme le strontium et le rubidium, qui permettent de dater l’âge des roches sur des périodes de milliards d’années, et de situer l’apparition de nouvelles formes de vie ? Qui remettrait en cause, sans recourir à des arguments religieux, la théorie de l’évolution ? ou réhabiliterait la possibilité de la « génération spontanée », réfutée au XIXe siècle ? Le réchauffement climatique sous l’effet de l’augmentation des gaz à effet de serre induite par les activités humaines a également acquis ce statut de certitude scientifique raisonnable, après une analyse critique mobilisant des milliers de chercheurs pendant des décennies.
On peut schématiser la conception « classique » de la connaissance scientifique par la méthode hypothético-déductive : on procède par des hypothèses conduisant à des expériences destinées à les infirmer ou les corroborer, et l’on tente d’englober ces savoirs dans des théories synthétiques soumises à la critique.
Les avancées spectaculaires réalisées, crédibilité croissante de l’existence des atomes, représentation mathématique du rayonnement électromagnétique, relativité, puis indéterminisme quantique, conduisirent à faire de la physique la reine des disciplines pour la pensée épistémologique. Les principaux axes de cette pensée, dans les années 1970, étaient représentés par les philosophes Karl Popper, déjà cité, Thomas Kuhn, qui faisait apparaître le rôle des exemples types (paradigmes) et de leur plasticité dans la science « normale » ainsi que leur remplacement lors de « révolutions », et Imre Lakatos, qui plaidait pour une conduite de la science par des programmes collectifs. Paul Feyerabend, quant à lui, niait l’intérêt d’un cadre général codifiant la méthode scientifique (« tout est bon » pour faire de la science), tout en attachant la plus grande importance à l’empirisme.
Cependant, certaines questions émergeaient de ces réflexions cantonnées au progrès des connaissances. La première apparut à propos des sciences humaines : la subjectivité du sujet qui élabore la connaissance a-t-elle des conséquences sur l’objectivité de la représentation proposée ? Max Weber répondit en reconnaissant l’intérêt en soi de certaines interprétations de la réalité socio-historique qu’il appelle « idéaux types ». Plus récemment, le courant du postmodernisme s’opposa radicalement à la séparation du scientifique et du monde qu’il étudie, et proposa une vision sociocentrée de la science, allant jusqu’à relativiser toutes les notions à la société qui les élabore, grâce à une prise de recul sur la vie de laboratoire et le rôle des experts : les sciences studies. À ces questions se relient celle de la démocratie dans l’orientation de la science et des rôles du citoyen et de l’expert, au centre de la philosophie de Jürgen Habermas, et celle des risques induits par la technique, posée par le sociologue Ulrich Beck.
De fait, les risques sont pris par les uns et subis par d’autres. Et cela mène à l’autre grande question, qui est celle de l’universalité de la science : une connaissance pour qui ? On a longtemps pensé que le savoir était implicitement accessible à tous, mais il est apparu claireme...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Avant-propos
- Comment nous avons procédé
- Chapitre 1 - La science, une activité méconnue
- Chapitre 2 - Les enjeux de l'activité scientifique
- Chapitre 3 - Peut-on encore croire en la science ?
- Chapitre 4 - L'instrumentalisation de la science
- Chapitre 5 - La science dévoyée
- Chapitre 6 - Science et transition écologique
- Conclusion
- Cinq propositions pour réussir la transition écologique
- Bibliographie générale
- Le Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot
- Les membres du Conseil scientifique
- Présentation de la FNH
- Remerciements
- Sommaire