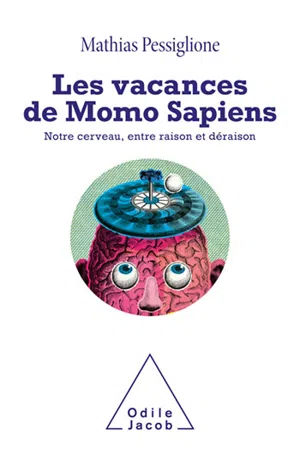
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Rationnel, le cerveau d'Homo sapiens?? Il ne manque pas de le faire savoir, quand il analyse à froid ses décisions. Mais sur le coup, quand il doit faire un choix, c'est une autre histoire?: le cerveau qui décide ne paraît pas si sage?! Il se laisse conditionner par l'habitude, envahir par les impulsions, diriger par les autres… Bref, il semble moins rationnel dans ses décisions pratiques que dans ses réflexions théoriques. À moins que ce ne soit le contraire?? Le cerveau reste un grand incompris. Peut-être, après tout, fait-il les bons choix sans qu'on s'en rende compte. Peut-être faut-il admettre ce paradoxe étonnant?: le cerveau a ses raisons que la raison ne connaît pas?! C'est le paradoxe exploré dans ce livre, à la lumière des sciences actuelles de la décision, où se rencontrent l'économie, la psychologie et les neurosciences. Mathias Pessiglione est directeur de recherches à l'Inserm. Biologiste et psychologue, spécialiste des mécanismes cérébraux qui motivent le comportement dans les situations normales et pathologiques, il dirige actuellement une équipe de recherches en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau à Paris.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Les Vacances de Momo Sapiens par Mathias Pessiglione en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences biologiques et Neurosciences. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
Quand l’inconscient s’en mêle
(ou quand le STRIATUM se pointe)
Cela fait maintenant un certain temps que Momo ne dit plus un mot. Au volant du monospace, il fulmine intérieurement. Le voilà coincé sur l’autoroute, même la file de gauche n’avance pas. Le ciel bleu n’a rien de réjouissant : la climatisation ne marche plus et le soleil chauffe l’habitacle. Il transpire comme un porc. Il se demande si les porcs transpirent et pourquoi on emploie cette phrase toute faite. Si les porcs transpirent, ce n’est certainement pas pour avoir fendu les airs au galop, comme les chevaux de course. De toute façon, les porcs, élevés dans leurs enclos trop petits, ne peuvent même plus tourner sur eux-mêmes. Exactement comme lui dans cette voiture. De l’arrière souffle une odeur de vomi. La petite avait mal au cœur, on ne peut pas lui en vouloir. En fait, l’odeur vient aussi du volant, il n’a pas pu se laver les mains. Et de la droite, où gît le pantalon trempé, mal isolé dans le sac plastique aux pieds de sa femme. L’odeur est partout.
Pourquoi, mais pourquoi a-t-il accepté de passer une semaine de vacances à Saint-Trojan, dans la maison de sa belle-mère ? Il aurait encore mieux valu rester au travail, avec l’air conditionné, et tout ce qu’il doit terminer. Était-ce par facilité ou par habitude ? Ou bien pour faire plaisir à la famille ? Un peu de tout ça à la fois ? Ou peut-être tout simplement pour voir la mer et sentir le grand air ? Tu parles d’un grand air ! Il s’avoue qu’il ne sait pas pourquoi il est là. Soudain il voit une sortie accessible. Sans plus réfléchir, il s’y engage. Bien entendu, c’est une décision qu’il allait regretter par la suite. Quand, après bien des errements, et bien des énervements, il arriverait enfin sur l’île d’Oléron, cinq heures plus tard que prévu.
Don’t ask the person,
ask the brain
Sonder le cerveau au lieu de la personne est un des motto de Colin Camerer, qui figure parmi les chefs de file de la neuroéconomie. Selon lui, demander à une personne d’expliciter son choix n’est pas forcément une bonne idée. D’abord, parce qu’elle peut mentir, et déguiser les vraies raisons de sa décision. Mais, surtout, parce qu’elle n’a peut-être pas accès elle-même à ses propres raisons. Or, si on croit que les gens sélectionnent l’option de plus grande valeur, conformément à la théorie de la décision, alors ces valeurs doivent être représentées, d’une façon ou d’une autre, dans leur cerveau. Les neurosciences doivent donc porter leur effort sur le décodage de ces valeurs.
C’est un effort qui a porté ses fruits dans un autre domaine, la perception visuelle. Dans l’activité hémodynamique du cortex visuel, c’est-à-dire dans les variations de débit sanguin mesurées par l’IRM fonctionnelle, il est possible de retrouver une partie de ce que la personne a vu. On peut ainsi reconstituer les clips vidéo qu’on lui a projetés quand elle était allongée dans la machine, par exemple une scène du Gendarme à Saint-Tropez, en lisant directement dans son cerveau. Cette reconstitution est loin d’être parfaite : lorsqu’on compare à l’original, on s’aperçoit que l’information contenue dans les clips reconstitués est nettement dégradée : on devine à peine la présence d’un gendarme. Mais cette information n’est pas nulle non plus, ce qui démontre une certaine compréhension de la façon dont les scènes visuelles sont codées dans l’activité cérébrale.
Les algorithmes de décodage ont également été appliqués, avec un certain succès, aux activités cérébrales mesurées pendant le sommeil, afin de reconstituer les rêves. Le problème dans ce cas est qu’on ne dispose pas de l’original, contre lequel il faudrait confronter la reconstitution. On ne peut que demander après coup à la personne, et vérifier que, lorsque l’algorithme produit des images de plage ou de forêt, la personne raconte effectivement avoir rêvé d’une plage ou d’une forêt. Ce qui ne marche pas à tous les coups, mais plus souvent que si on pariait au hasard, d’où la conclusion qu’on a su capter une partie de l’information pertinente.
Pour les neurosciences de la décision, le Graal serait, grâce à des algorithmes similaires, de pouvoir lire les valeurs que le cerveau attribue aux différentes options. Toutefois, en supposant qu’on dispose d’un tel algorithme, pouvant décoder les valeurs inscrites dans le cerveau, comment le valider si la personne n’a pas conscience de ces valeurs et que, par conséquent, on ne peut pas le lui demander ?
Mais de quel inconscient parle-t-on ?
C’est ici qu’il faut s’interroger sur la notion d’inconscient. Dans notre culture, la notion d’inconscient renvoie immédiatement à la référence freudienne. Or Freud ne nous est d’aucun secours pour résoudre notre problème puisqu’il propose, paradoxalement, de faire parler le patient pour pouvoir élucider son inconscient. Certains critiques ont d’ailleurs pointé qu’il s’agit là d’une faille épistémologique de la psychanalyse : les contenus qu’on prête à l’inconscient ne peuvent pas être vérifiés, puisque par définition nul n’y a accès, ni le patient ni le thérapeute. Il s’agira toujours d’interprétations, dont rien ne prouve qu’elles soient vraies, au sens scientifique. Ce qui ne veut pas dire qu’elles ne soient pas intéressantes, naturellement.
En outre, l’inconscient freudien se trouve régulièrement en conflit avec les instances psychiques (le moi ou le surmoi) qui peuvent être conscientes. Dans cet affrontement dramatique, les protagonistes partagent beaucoup de capacités, notamment pour ce qui concerne la compréhension du contexte et la motivation du comportement. Lorsqu’il s’agit de prendre une décision, l’inconscient pourrait donc également attribuer des valeurs et poursuivre des buts différents : l’inconscient voudrait une chose, tandis que le moi en voudrait une autre. C’est ainsi, par les mobiles inconscients, que Freud explique les lapsus et les actes manqués. L’inconscient freudien n’est donc pas seulement ce qui échappe à la conscience, c’est aussi ce qui échappe au contrôle du moi.
On trouve également des théories invoquant des conflits entre systèmes (cérébraux) en psychologie cognitive, mais ces conflits ne recoupent pas la distinction entre conscient et inconscient. On parlera plus volontiers de comportements impulsifs, en général dirigés vers des récompenses primaires à court terme, par opposition aux comportements contrôlés, qui intègrent davantage le contexte et qui se projettent à plus long terme. Je reviendrai sur ces conflits dans le cinquième chapitre ; je vais me concentrer ici sur la distinction entre conscient et inconscient.
La notion d’inconscient cognitif est plus simple que la notion freudienne : on n’a pas conscience d’une information si on ne peut pas la rapporter, verbalement ou autrement. Ainsi, on est inconscient des valeurs qui guident notre comportement dans le même sens qu’on est inconscient du poisson d’avril accroché dans notre dos. C’est aussi une notion plus ancienne*1. Dénonçant l’illusion du libre arbitre, Baruch Spinoza écrivait déjà en 1677 : « Les hommes se trompent en ce qu’ils pensent être libres, et cette opinion consiste en cela seul qu’ils sont conscients de leurs actions, et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. »
Il y a bien là l’idée d’un déterminisme inconscient, au sens cognitif : on peut raconter sans (trop) risquer de se tromper ce qu’on a fait, mais on ne peut pas dire en toute certitude pourquoi on l’a fait. Cette conception se retrouve dans les descriptions psychologiques des romans du XIXe siècle, en plein âge romantique et bien avant les théories freudiennes. On peut lire par exemple des phrases comme : « Il ne savait quelle force mystérieuse le poussait à agir sans plus attendre*2. »
D’une certaine façon, l’inconscient cognitif est également plus radical que dans la culture commune héritée de la vision freudienne. Pour la plupart des chercheurs, l’inconscient est la loi, et la conscience, l’exception. Autrement dit, la plupart des traitements opérés par le cerveau restent inconscients, seule une petite fraction accède à la conscience. Et c’est heureux : si tous les traitements cognitifs se faisaient au rythme où s’écoule notre flux de conscience, nous ne pourrions certainement pas danser la salsa, ou reprendre une balle à la volée.
Pour revenir au problème du choix, cela signifie que les rares cas où on examine une par une les différentes options, en considérant explicitement les avantages et les désavantages, ne représentent pas des cas typiques de la prise de décision. Dans la majorité des cas, on a l’intuition (consciente) de ce qu’on préfère, mais pas des raisons qui fondent notre préférence. Les raisons peuvent éventuellement venir a posteriori, lorsqu’on observe notre propre comportement, et qu’on s’efforce d’en rendre compte. Mais rien ne garantit que ce soient les mêmes raisons que celles qui ont effectivement déterminé nos choix. Et pour cet exercice de rationalisation de nos propres actions, nous ne sommes pas tellement mieux placés qu’un observateur externe.
La preuve de l’inconscience
Pour tester le pouvoir de valeurs inconscientes, il faut donc que la personne ne puisse pas expliciter ces valeurs, mais que l’expérimentateur les connaisse. La solution proposée par la psychologie cognitive est de manipuler ces valeurs de l’extérieur. Il est possible de présenter des informations de façon subliminale, ce qui signifie tout simplement sous le seuil (de conscience). De cette façon, les informations peuvent être intégrées dans le comportement de la personne, mais sans qu’elle en prenne conscience, c’est-à-dire sans qu’elle puisse les rapporter. La plupart du temps, il s’agit d’un seuil sur la durée : les informations subliminales sont trop brèves pour être perçues de façon consciente.
Au cours du XXe siècle, la psychologie cognitive s’est attachée à identifier le niveau de représentation que pouvaient atteindre les informations subliminales. Toute l’astuce de ces expériences consiste à montrer que le comportement a été influencé par l’information subliminale, alors que les participants ne peuvent pas dire quelle information leur a été présentée. Pour cela, un paradigme particulièrement probant, bien exploité par le groupe de Stanislas Dehaene, est celui de l’amorçage subliminal. Dans ces expériences, on présente une première image, l’amorce, de façon extrêmement brève. Pour être sûr qu’elle reste inconsciente, on la fait suivre d’une autre image, le masque, qui lui ressemble sur le plan de la forme et de la couleur, et qui est présentée plus longuement. Ensuite vient l’image cible, sur laquelle le sujet doit effectuer une tâche. Des centaines d’essais de ce type sont répétés au cours de l’expérience, variant les amorces et les cibles.
Dans une expérience d’amorçage sémantique, par exemple, les amorces sont des mots, les cibles sont des mots ou des non-mots (une suite de lettres sans signification) et les masques sont des chaînes de caractères venant d’un autre alphabet. La tâche du participant est de dire si les lettres qu’il perçoit (les cibles) sont des mots ou des non-mots ; ce qu’on mesure est le temps qu’il met pour donner sa réponse. Le résultat est que le temps de réponse est plus rapide si l’amorce partage certaines caractéristiques avec la cible. Par exemple, le mot cible « sofa » est plus rapidement reconnu s’il est précédé par le mot-amorce « divan » que par le mot-amorce « table ». D’où on déduit que le sens du mot « divan » a été inconsciemment extrait par le cerveau, de façon à préactiver des mots reliés sémantiquement, comme « sofa », dont le traitement sera de ce fait plus rapide. Les informations subliminales peuvent par conséquent atteindre un niveau sémantique.
Mais comment s’assurer que le participant n’a pas perçu (consciemment) l’amorce ? Le premier critère qui vient à l’esprit est de se fier à son compte rendu. Il s’agit d’un critère subjectif : s’il dit qu’il ne l’a pas vu, c’est qu’il ne l’a pas vu. Mais ce critère pose problème, car les participants peuvent être extrêmement conservateurs, et déclarer ne rien percevoir même quand en réalité ils sont capables de discerner (consciemment) certains éléments qui les mettent sur la voie. On préfère donc les forcer à faire un choix, par exemple sur une tâche de détection. Dans une telle tâche, on leur demande à chaque essai d’indiquer s’il y avait une amorce ou non, sachant qu’en réalité l’amorce n’est présente que dans la moitié des cas. Il s’agit d’un critère objectif : si les participants se trompent une fois sur deux, autrement dit si leur pourcentage de détections correctes n’est pas différent du hasard (50 %), on peut en déduire que l’amorce passe inaperçue. Selon ce critère, il est démontré que le cerveau est capable d’extraire le sens d’une information que la personne ne perçoit pas consciemment.
La publicité subliminale
Mais, direz-vous, cette information inconsciente peut-elle vraiment influencer les préférences ? Les premiers expérimentateurs à tester si des images subliminales pouvaient influencer les choix économiques n’étaient pas des psychologues académiques. Il s’agissait d’un professeur de marketing, associé aux propriétaires d’un cinéma de la côte ouest des États-Unis. Leur idée était d’insérer au cours d’un film une vingt-cinquième image par seconde, afin de suggérer aux spectateurs de consommer un produit en vente, par exemple avec le message « mangez du pop-corn » (voir la Figure 4). C’est ce qu’ils ont fait en 1957, lors des séances où était projeté le film Picnic. Les images étaient trop brèves pour que les spectateurs perçoivent les messages, et néanmoins les ventes de pop-corn pendant ces séances ont été décuplées. Une technique commerciale révolutionnaire, la publicité subliminale, était née.

Figure 4. On nous manipule : publicité subliminale et conditionnement implicite.
La photo du haut a été insérée dans un fil...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- PROLOGUE - Trois mousquetaires pour un cerveau
- CHAPITRE 1 - Quand l’inconscient s’en mêle - (ou quand le striatum se pointe)
- CHAPITRE 2 - Conditionné comme une bête - (par la dopamine)
- CHAPITRE 3 - Des valeurs fabriquées - (dans le cortex orbitofrontal)
- CHAPITRE 4 - L’empire des émotions - (sous le règne d’amygdale et d’insula)
- CHAPITRE 5 - Un patron défaillant - (appelé cortex préfrontal latéral)
- CHAPITRE 6 - Le poids des autres - (et du cerveau social)
- ÉPILOGUE - Y a-t-il un pilote dans mon crâne ?
- Bibliographie (sélective)
- Remerciements
- Sommaire