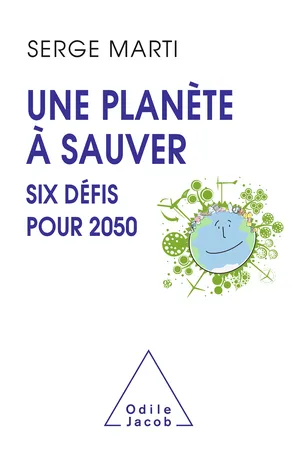
- 240 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
La révolution écologique est en marche. Elle va nécessairement bouleverser les modes de vie des individus et les stratégies politiques des États. Le signal d'alarme le plus évident est le climat, dont le dérèglement affecte la planète entière, mais d'autres défis menacent : comment conjuguer l'accroissement de la population et les méfaits de l'agriculture intensive, la pénurie d'eau potable et la montée des eaux de l'océan, le tarissement des matières premières et l'affaiblissement de la biodiversité ? Aveuglée par des promesses irréalistes de bonheur à court terme, l'humanité a pris le mauvais chemin de la production et de la consommation à outrance, oubliant qu'elle habitait un monde fini. Pour sauvegarder ce qu'il en reste, il est encore temps de relever les défis de l'écologie et d'inventer un monde plus raisonnable. Ce livre y contribue par la richesse exceptionnelle et la précision de ses informations. Une mine à exploiter d'urgence pour comprendre les grands problèmes planétaires. Serge Marti est journaliste, ancien rédacteur en chef au Monde. Spécialisé en économie internationale, il suit les questions de développement, les rapports Nord-Sud et s'intéresse à la problématique environnementale.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Une planète à sauver par Serge Marti en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences physiques et Géologie et sciences de la Terre. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE II
Six défis pour 2050
1. Conjurer le dérèglement climatique
« Si le climat était une banque, les pays riches l’auraient sauvé depuis longtemps. »
Hugo CHAVEZ
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Abondamment citée lorsqu’on parle du dérèglement climatique, la formule a connu un regain d’actualité après le décès, le 26 septembre 2019, de celui qui en était à l’origine, Jacques Chirac. Même si la véritable paternité de cette phrase, entrée dans l’histoire, revient à un conseiller du président de la République qui n’était autre que Nicolas Hulot, lequel l’avait ajoutée au discours officiel, sans se douter de son retentissement et de sa pérennité. À l’époque, le 2 septembre 2002, le propos avait frappé les esprits et on continue à la rappeler depuis, comme l’a fait l’actuel président de la République Emmanuel Macron en août 2019, lors du sommet du G7 de Biarritz, signe qu’il n’a pas pris une ride.
Jacques Chirac, alors en fonction à l’Élysée, avait prononcé cette formule à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l’ouverture de l’Assemblée plénière du IVe Sommet de la Terre, placé sous l’égide des Nations unies. Par raccourci médiatique ou opportunisme politique, on omet généralement de citer la suite du propos présidentiel, au moins aussi importante. « La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous refusons de l’admettre. L’humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud et nous sommes indifférents. La Terre et l’humanité sont en péril, et nous sommes tous responsables. Il est temps d’ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d’alerte s’allument », avertissait alors Jacques Chirac à l’adresse de la communauté internationale.
En matière d’écologie, l’ex-locataire de l’Élysée n’était pas précisément un avant-gardiste. Partisan du nucléaire et de l’industrie lourde, on lui doit pourtant, outre le discours de Johannesburg, quelques avancées « vertes ». À commencer par la Charte de l’environnement et le principe de précaution, imposés contre sa majorité de l’époque, et auxquels on pourrait ajouter les lois environnementales votées au milieu des années 1970, notamment sur les déchets, ainsi que le moratoire sur les organismes génétiquement modifiés (OGM).
Que le propos de l’ancien président à Johannesburg, en 2002, ait été sincère ou qu’il se soit inscrit dans une opération de communication dont le monde politique n’est pas avare, importe peu. L’essentiel est que, dix-huit ans après, si la formule choc de Jacques Chirac résonne étrangement à nos oreilles, c’est parce que l’actualité, faite de catastrophes climatiques sans précédent, y compris à notre porte, nous renvoie au dramatique constat présidentiel formulé en terre sud-africaine. Depuis, le temps a passé et les conférences sans lendemains qui ont suivi se paient aujourd’hui au prix fort.
D’autres grands-messes climatiques se sont en effet inscrites sur l’agenda onusien mais, durant ces longues années, notre maison a continué à brûler de plus belle – et à s’inonder au moins autant – pendant que, trop souvent, nous persévérons à regarder ailleurs, jusqu’à ce que les désastres climatiques, inédits par leur ampleur et leur fréquence, s’accompagnent de bilans humains et matériels de plus en plus lourds. À présent, la planète affronte ouragans et pluies torrentielles en même temps qu’elle s’assèche de plus en plus, phénomène dont les lointaines contrées n’ont plus le triste monopole. Européens autant qu’Américains le constatent maintenant, eux aussi, à domicile.
Des phénomènes climatiques extrêmes et dévastateurs
Inondations à répétition, canicules en série, fonte des glaces accélérée, élévation du niveau de la mer. Soumise comme jamais aux colères de Dame Nature, la planète aura connu ces dernières années une suite quasi ininterrompue de désastres climatiques qui s’ajoutent aux records de température battus d’année en année. Une longue litanie de catastrophes naturelles que l’on déplore à présent partout. Même si les pays du Sud, moins bien organisés au plan sanitaire et nettement défavorisés, économiquement parlant, s’avèrent bien plus désarmés qu’au Nord pour faire face aux éléments déchaînés.
Les cyclones tropicaux sont synonymes de bien des malheurs et des dévastations. On se souvient encore de l’année 2018 lorsque la gigantesque tempête Harvey, après avoir dévasté les Caraïbes et meurtri Porto Rico, frappait à son tour le cœur du Texas, plongeant Houston et ses alentours sous les eaux. En l’espace de deux mois, dix ouragans auront balayé cette année-là les Antilles, Cuba, Haïti, Porto Rico et les côtes de Floride, après le Texas. À l’automne 2018, c’était au tour de Michael, le troisième ouragan le plus puissant à avoir frappé les États-Unis et plus particulièrement le nord-ouest de la Floride. À la même période, l’Asie du Sud-Est subissait le passage du supertyphon Mangkhut avec son lot de victimes en nombre, d’habitations détruites, de champs inondés et de routes coupées.
Plus récemment, en Afrique australe, après le passage du terrible cyclone Idai, au printemps 2019, c’est tout le Mozambique qui s’est retrouvé sous les eaux, les pluies torrentielles dévastant à 90 % Beira la seconde ville du pays, avec 500 000 habitants. À peine essayait-il de se remettre que le pays subissait la double peine, en étant confronté quelques semaines plus tard à l’ouragan Kenneth, d’une puissance record dans cette région. De son côté, l’Australie a connu à la même période des inondations exceptionnelles dans le nord-est du pays qui, selon les météorologues, n’arrivent que « tous les cent ans ». L’Iran a été touché à son tour au printemps 2019 par des inondations destructrices qui ont mis à mal une économie déjà affectée par une crise sévère due en partie à l’embargo américain. En Inde, c’est tout le Kerala, dans le sud du pays, qui a été noyé sous les crues trois mois plus tard.
L’été 2019 n’a pas été beaucoup plus clément dans bien des régions du globe. Au Japon, des pluies abondantes ont balayé le sud du pays, entraînant l’évacuation de 1 million de personnes, et l’archipel a subi à nouveau, suite au typhon Hagibis, de terribles précipitations qui ont fait des dizaines de morts. Un lourd bilan pour un pays pourtant habitué aux caprices du ciel. Au Mexique, fin juin, à la suite d’un orage de grêle d’une violence inégalée, les rues de la ville de Guadalajara, dans le nord du pays, étaient recouvertes, en quelques heures, de 2 mètres de glace pilée. La veille, le thermomètre affichait un beau soleil et 31 °C ! À l’automne, c’est le terrible ouragan Dorian qui a dévasté les Bahamas, avec une violence « jamais vue » dans l’histoire de ce pays, avant de longer les côtes américaines.
Cette carte géographique de la fureur du ciel, stimulée par le réchauffement climatique, parle d’elle-même. Elle frappe désormais toutes les régions du monde, surtout au Sud, obligeant à des transferts de populations d’une ampleur ignorée jusqu’à présent et qui ne feront que s’amplifier. En Asie, au Bangladesh, sans doute l’un des pays historiquement les plus frappés par de violentes intempéries, on considère que d’ici à 2050, ce sont peut-être 50 à 60 millions d’habitants qu’il faudra déplacer pour cause de catastrophe climatique et d’insécurité alimentaire en raison des terres agricoles submergées et de la salinité de l’eau qui en résulte. À en croire la Banque mondiale il faut prévoir, d’ici à 2050, une multiplication par trois des risques d’inondations que l’on doit beaucoup aux phénomènes climatiques El Niño et La Niña, une terrible menace pour la vie de dizaines de millions de personnes.
El Niño et La Niña,
fauteurs de troubles climatiques
fauteurs de troubles climatiques
El Niño, un nom bien innocent pour désigner un fauteur de troubles climatiques de grande ampleur. Cet « enfant », baptisé ainsi par les Péruviens car il paraît aux environs des fêtes de Noël, est un phénomène climatique redoutable qui prend naissance dans le Pacifique sous l’effet du réchauffement de l’océan du même nom et de la hausse des températures de surface. Le choc est frontal avec le refroidissement des eaux intervenu en Australie et Asie du Sud-Est, et El Niño se déchaîne alors en températures déréglées, vents ultraviolents et pluies torrentielles depuis l’Afrique jusqu’à l’Amérique, semant la désolation sur son passage. Les climatologues – et les populations affectées – n’ont pas oublié les ravages du passage du Niño durant le violent épisode de 1997-1998 lorsqu’il avait fait 23 000 victimes dans le monde, 6 millions de déplacés, des territoires entièrement dévastés et entraîné près de 40 milliards de dollars de dégâts.
Depuis, « l’enfant terrible » de la météo continue d’occasionner de gigantesques inondations au Pérou, de graves sécheresses en Australie, des tempêtes impressionnantes en Californie et des typhons qui ne le sont pas moins au Japon. Et les Nations unies, comme la FAO, tirent le signal d’alarme au regard de l’impact dévastateur de l’épisode El Niño sur les récoltes et la sécurité alimentaire, un phénomène climatique hors norme qui complique les effets du réchauffement, entraînant des bouleversements considérables sur les cultures mais aussi sur la mer et les océans, donc sur les pêches.
Un malheur n’arrivant jamais seul, il faut composer à présent avec sa petite sœur, La Niña, promise elle aussi à un bel avenir en termes de nuisances climatiques. Plus de 60 millions de personnes dans le monde se retrouvent en situation d’insécurité alimentaire quand elles croisent « le garçon », El Niño. Lorsqu’il se met en tête de parcourir les airs avec « la fillette », La Niña, c’est près du double de malheureux qui, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, auront à en subir les maléfices.
Inondations et sécheresses
Ce trop-plein d’eau et les inondations qu’il entraîne ont leur pendant dont bien des populations se passeraient : une accumulation de sécheresses – météorologiques lorsqu’elles sont dues à un déficit de précipitations, hydrologiques pour cause de nappes souterraines à sec. En 1964, l’écrivain américain J.G. Ballard proposait à ses lecteurs un livre intitulé Sécheresse, décrivant une planète asséchée et des habitants, privés de toute parcelle d’ombre, en proie à une canicule à laquelle ils ne pouvaient résister. Une œuvre qui se voulait de simple fiction mais qui, un demi-siècle plus tard, est devenue réalité, laquelle, d’ailleurs, n’est pas propre à l’Amérique du Nord. Dans bien d’autres régions du monde et très souvent parmi les plus appauvries et les moins aptes à se relever après les sinistres, les populations locales souffrent de sécheresse endémique et de la pénurie alimentaire qu’elle produit.
À titre d’exemple, l’Inde où le secteur agricole fait vivre 600 millions de personnes a connu au printemps 2019 une sécheresse historique qui a privé d’eau une bonne partie des 115 millions d’habitants de l’État du Maharashtra, vidant quantité de villages de leurs paysans assoiffés. Ailleurs, le nord-est brésilien mais aussi l’État de São Paulo ont soif. En Afrique, le Kenya, le Lesotho, le Burkina Faso et la plupart des pays du Sahel figurent parmi les grandes victimes du réchauffement climatique et de la sécheresse qui en découle. Le continent africain est particulièrement frappé. Entre 2005 et 2016, 84 périodes de sécheresse ont affecté 34 pays africains sur les 54 que compte le continent. Sur le pourtour méditerranéen, tous les pays ou presque sont affectés par des élévations de température anormales qui assèchent la végétation et les cultures, favorisant les incendies. D’autres pays, a priori plus fortunés, sont logés à la même enseigne climatique : l’Argentine, en proie à des pénuries de pluie d’une ampleur sans précédent, ou encore l’Australie qui a connu, début 2019, sa pire sécheresse depuis cinquante ans et des incendies hors normes quelques mois plus tard.
L’Europe, elle aussi, a connu son lot de sécheresses et d’incendies de massifs forestiers, très sensibles au stress hydrique, surtout dans les pays du sud du continent. L’Espagne est en déficit chronique d’eau de pluie depuis quatre ans et des incendies, alimentés par la sécheresse, ravagent des dizaines de milliers d’hectares du couvert forestier espagnol, tout comme au Portugal. À l’été 2019, des incendies à répétition se sont produits en Grèce, et une grande partie de la Sibérie orientale a été ravagée par le feu, jusqu’à devoir classer plusieurs districts en zone « ciel noir ». La France n’échappe pas à la règle. L’Hexagone a connu de gros incendies dans le Gard et l’Aude tandis que plusieurs départements souffraient d’une grave sécheresse et d’un déficit pluviométrique de 50 % par rapport aux années précédentes, handicap majeur pour les cultures et l’élevage.
Coup de chaud sur la planète.
À quand les 50 °C pour tous ?
Tous les spécialistes en conviennent, le réchauffement de la planète, marqué par une hausse des températures exceptionnelle, jusque dans les régions dites tempérées, est appelé à s’accentuer et, surtout, à durer. Les vagues de canicules qu’a connues la Terre en 2018, au Nord comme au Sud, n’étaient qu’un avant-goût des coups de chaud bien supérieurs constatés l’année suivante. Juillet 2019 aura été le mois le plus chaud enregistré depuis les premiers relevés de température à la fin du XIXe siècle, affirme la National Oceanic and Atmospheric Administration, agence fédérale américaine dont les travaux font autorité. Tous mois confondus, juillet 2019 aura été le plus chaud jamais mesuré à la surface de la Terre avec une température de 0,56 °C plus élevée que la moyenne de la période 1981-2000, et de 1,2 °C au-dessus du niveau de l’époque préindustrielle.
À première vue, cet écart peut sembler relativement faible mais ses effets sont plus que conséquents et n’épargnent plus aucun continent. Ainsi, en Inde, New Delhi a affiché un record historique de 48 °C fin juin et jusqu’à 51 °C dans le nord du pays. En Australie, la température n’est pas tombée en dessous de 47 °C en juin-juillet et en Europe où tous les pays ont été concernés, la canicule a fait tomber tous les records historiques. À Paris, le thermomètre est grimpé jusqu’à 42,6 °C mais il a atteint 45,9 °C dans le département du Gard.
Alors, à quand les 50 °C ; voire plus, un peu partout sur la planète, est-on en droit de se demander ? Si rien ne change, c’est déjà fait, ou presque. « En cas de réchauffement climatique non maîtrisé, on pourrait enregistrer des températures atteignant 55 °C dans de nombreux pays, y compris en France, durant la seconde partie du XXIe siècle, ce qui entraînerait cinquante fois plus de décès liés aux catastrophes climatiques qu’actuellement », avertit le climatologue Jean Jouzel. Les spécialistes en sont convaincus : quelles que soient les régions, les extrêmes de chaleur seront plus fréquents et les périodes de canicule plus longues. Une perspective préoccupante pour les pôles où la glace fond comme neige au soleil et élève d’autant le niveau de la mer.
Arctique et Antarctique :
la fonte des glaces en alerte rouge
Avec la dilatation des mers due à l’élévation de température, les grands coupables, bien involontaires, de cette montée des eaux qui s’annonce comme un cauchemar environnemental sont les pôles, soumis au réchauffement climatique dû à l’excès de CO2. Ainsi, au Groenland, grand comme quatre fois la France et couvert de glace sur 85 % de sa superficie, la fonte de la banquise commence actuellement avec trois mois d’avance, et l’on enregistre par moments des températures supérieures de plus de 20 °C à la normale. Du jamais vu au Grand Nord, considéré comme la vigie de tout ce qui concerne le réchauffement de la planète. Sur place, l’accélération du dégel n’est plus contestable. Chaque décennie, l’Arctique perd 13 % de son couvert de glace.
Un constat préoccupant quand on sait que cette région où vivent encore 4 millions d’Inuits, de Iakoutes, d’Evenks et d’Évènes, de Nenets et de Tchouktches, conserve la deuxième plus épaisse couche de glace de la planète, après l’Antarctique. Sous l’effet de températures hivernales de plus en plus élevées et qui bouleversent le cycle normal des saisons, les icebergs sont de plus en plus nombreux à se détacher de la calotte, parfois en quelques minutes. En trente ans, l’épaisseur de la banquise s’est réduite de 40 % et d’ici à la fin du XXIe siècle, elle pourrait avoir fondu au moins de moitié. Prévoyante, l’Islande a déjà inauguré, à l’été 2019, la plaque qui célèbre le souvenir de Okjökull, le premier glacier à avoir fondu sous l’effet du réchauffement climatique !
La situation au pôle Sud, terre de l’extrême, est à peine meilleure que celle de l’Arctique, désormais considérée comme « une bombe polaire ». Ces dernières années, la liste des records de chaleur s’est allongée en Antarctique, jusqu’à 20 °C pour ce qui est de la température la plus élevée. Au total, l’Antarctique occidental s’est réchauffé de 2,4 ...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Avant-propos - Une planète « bleue » en sursis
- Chapitre I - Un réveil brutal
- Chapitre II - Six défis pour 2050
- Chapitre III - Idéologies et modes de vie périmés
- Bibliographie
- Remerciements
- Table