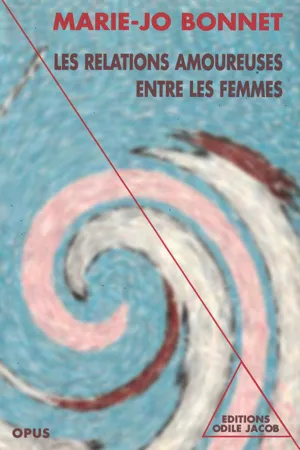
- 420 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Les Relations amoureuses entre les femmes
À propos de ce livre
Il faut se rendre à l'évidence : l'amour entre les femmes sent le soufre. Qu'il soit combattu, nié ou même toléré, aujourd'hui comme hier, il dérange un certain ordre patriarcal fondé sur la famille et la reproduction. Rares sont les historiens qui ont eu le courage de ne pas l'exclure de leur champ. Et pourtant, l'histoire des relations amoureuses entre les femmes est nécessaire pour l'histoire de toutes les femmes, tant il est vrai que les lesbiennes ont joué un rôle prépondérant dans les mouvements progressistes politiques et artistiques, et dans l'évolution des mœurs et des mentalités. " Souhaitons que le présent livre rende mieux perceptible la présence des lesbiennes dans la cité. Peut-être alors leur amour sera-t-il enfin reconnu comme l'un des leviers de la libération des femmes. " M.-J. B. Marie-Jo Bonnet est docteur en histoire, spécialiste d'histoire culturelle.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Les Relations amoureuses entre les femmes par Marie-Jo Bonnet en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Scienze sociali et Studi su tematiche LGBT. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
DEUXIÈME PARTIE
DES MYSTÈRES DE LA NATURE À CEUX DE LESBOS (XVIIIE SIÈCLE)
CHAPITRE PREMIER
Lumières… sur la passion du semblable
Au XVIIIe siècle, un verrou religieux va sauter sous la double pression de la philosophie des Lumières et du libertinage. Chassée par l’âge classique, la sexualité revient en force reconquérir ses droits. Droit au plaisir pour les libertins, mais aussi pour les philosophes qui attaquent l’idéologie religieuse sur son point faible : sa morale sexuelle. « La nature ne souffre rien d’inutile, écrit Diderot. Tout ce qui est ne peut être ni contre nature, ni hors nature1. »
Ces affirmations révèlent à quel point la vision du monde de l’Homme du XVIIIe siècle est en train de changer. Ce ne sont plus les mystères de la religion qui l’intéressent, mais ceux de la nature et des êtres qui peuplent la terre. Que sait-on du corps humain, de la circulation du sang, des nerfs, du plaisir et de la douleur ? Sur quoi fonder une morale naturelle ? Les nouveaux principes du droit et de la loi naturelle ne sont-ils pas en train de miner ceux de la loi divine qui légitime la monarchie absolue de droit divin ? Le démon de l’expérimentation s’empare de toute une société « éclairée » qui remet en question les vérités établies, cherche une nouvelle façon de vivre, vérifie ce qu’on lui dit, explore, découvre de nouveaux horizons, rêve tout haut et pense que le salut ne vient plus de Dieu, mais de l’Histoire, c’est-à-dire de la capacité de l’Homme à établir sur terre le bonheur commun.
Et cela peut aller loin. Car si reconquérir le plaisir, au XVIIIe siècle, c’est lutter contre la religion, c’est aussi reconnaître aux femmes le droit au plaisir, quel qu’il soit, même avec une femme.
Cette évidence va confronter le libertin à un mystère indicible… Si le plaisir entre femmes est un plaisir « sans homme », il échappe fatalement à son regard, à sa curiosité, à sa connaissance expérimentale. Alors, qu’y a-t-il quand il n’y a pas d’homme ? N’y a-t-il pas là une question excitante qui appelle logiquement sa réponse ? Là où il n’y a pas d’homme, au XVIIIe siècle, il y aurait… l’idéal libertin.
Car si le libertin trouve normal qu’une femme puisse en aimer une autre, c’est lui, malgré tout, qui écrit sur les tribades, soulève un coin du voile, imagine ce qu’il ne peut voir, philosophe sur le plaisir et définit la « nature de la femme ». Les femmes ont beau ouvrir des salons, voyager, étudier les sciences, chanter, aimer, monter sur la scène des théâtres, ne plus craindre le qu’en-dira-t-on, elles ne parlent pas de leur plaisir.
Se taisent-elles parce qu’elles n’ont pas d’espace propre pour s’exprimer ou parce que le discours sur le plaisir est un besoin spécifiquement masculin ? À lire les textes produits par le XVIIIe siècle éclairé, on a l’impression que le libertinage est un fait d’homme, et nous renseigne bien plus sur celui qui tient le discours, sur sa langue, sa vision du monde, ses structures mentales et sexuelles, que sur les relations amoureuses vécues par ses contemporaines.
Du bon usage de la langue et des femmes
Cela commence avec la définition du mot « tribade », qui change non seulement par rapport à l’âge classique, mais au sein des élites, selon qu’elles se trouvent du côté du pouvoir ou de sa contestation.
Pour les académiciens du XVIIIe siècle chargés par le roi de « légiférer en matière de langue » (Vaugelas), c’est-à-dire de rédiger un dictionnaire de langue française, la chose s’impose comme une véritable nouveauté, puisque le mot « tribade » fait son entrée dans la quatrième édition de leur dictionnaire, celle de 1762, avec la définition suivante : « Tribade : Femme qui abuse d’une autre femme. »
Selon ces mêmes académiciens, abuser signifie « user mal, user autrement qu’on ne doit […]. On dit abuser d’une fille pour dire en jouir sans l’avoir épousée. “C’est une fille dont il a longtemps abusé.” » Comme pour dire que si la « fille » devient sa femme, « il » n’en abuse pas ou que jouir d’une fille est un droit d’usage conforme à la nature des choses, à condition qu’il soit sanctifié par la loi d’alliance. Or, comme nous savons qu’il ne saurait être question pour une femme d’en épouser une autre, on se demande ce qu’elle doit faire pour ne pas en abuser si ce n’est que de n’en point user du tout.
Le mot « abus » doit donc avoir une autre signification, s’inscrire dans un autre système de références, suffisamment « établi » pour faire autorité sur l’ancien en contraignant les académiciens à sortir de leur vertueux silence.
Est-il une émanation du savoir de l’âge classique dont on sait qu’il fut préoccupé d’ordonner les mots et les choses à la norme du Bon Usage ? Les sciences, les techniques, les arts, la littérature, la vie de société, tout devait se soumettre à la règle du Bon Usage, à commencer par la langue qui devint l’enjeu et le ferment de bouleversements très importants. D’abord avec les grands auteurs de la littérature qui donnèrent à la langue française ses lettres de noblesse, en imposant le français comme langue des élites savantes. Ainsi, on peut lire dans la préface du Dictionnaire de Trévoux (1732) ce désaveu formel des auteurs du passé parce qu’ils parlent latin en français : « La connaissance des langues savantes ou étrangères est encore un écueil pour plusieurs, qui confondant ces idées différentes transportent souvent dans leur langue naturelle des tours et des manières de s’exprimer, qui ne sont propres que des langues qu’ils ont apprises, et parlent souvent latin, ou italien en françois. D’autres, à force de s’être rendu familières certaines façons de parler, se sont imaginé qu’elles étaient en usage, parce qu’ils s’y sont habitués, et qu’ils s’en sont fait un usage eux-mêmes2. »
La langue de Martial souffrirait-elle du même désaveu, devenant impropre à signifier dans la « langue naturelle » l’idée qu’on doit se faire des tribades ? Mais si certaines façons de bien parler impliquent certaines façons de bien penser, pourquoi, en « matière de langue » comme en matière de relations « abusives » entre femmes, les académiciens se réfèrent-ils à la même notion d’usage ?
Pour pouvoir y répondre, il est nécessaire de comprendre au préalable « ce que c’est que cet usage dont on parle tant » au XVIIe siècle, et dont le grammairien Vaugelas donne une définition qui fera autorité : « Il y a sans doute un bon et un mauvais usage – le mauvais se forme du plus grand nombre de personnes (c’est le langage des nourrices et des domestiques) qui presque en toutes choses n’est pas le meilleur, et le bon, au contraire, est composé, non pas de la pluralité mais de l’élite des voix, et c’est véritablement celui que l’on nomme le Maître des langues […]. Voici donc comment on définit le Bon Usage. C’est la façon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d’écrire de la plus saine partie des auteurs du temps […]3. »
On ne pouvait pas mieux décrire le processus d’une prise de pouvoir linguistique d’une « élite de voix » sur « le plus grand nombre ». Mais le plus intéressant est la manière dont Vaugelas confère à la notion abstraite d’usage le poids concret de l’autorité en disant : « L’Usage que tout le monde appelle le Roi, le Tyran, l’Arbitre, ou le Maître des langues » – comme si l’usage avait pouvoir absolu de soumettre la langue à sa loi. Sous la Révolution, on retrouve la même occultation du sujet de la loi dans le discours d’Amar destiné à exclure les femmes de la jouissance de leurs droits politiques : « Chaque sexe est appelé à un genre d’occupation qui lui est propre ; son action est circonscrite dans ce cercle qu’il ne peut franchir, car la nature, qui a posé des limites à l’homme, commande impérieusement et ne reçoit aucune loi4. »
Le principe fait donc la loi aux mots, aux choses, à « la multitude » et aux femmes.
Voilà comment une certaine élite masculine se rend maîtresse de la langue et des femmes en accaparant les fonctions de codification des règles, du bon usage et de la pureté linguistique. Qu’elle se recrute dans « la plus saine partie de la cour et des auteurs » chez Vaugelas, parmi les « honnêtes gens » chez les académiciens de 1694, au sein de « la bonne compagnie » chez les encyclopédistes ou auprès du « public » chez les académiciens de 1762, elle assume d’un siècle à l’autre le même rôle : légiférer en matière de langue, de culture et d’usage des femmes.
N’est-il pas frappant de constater que lexicographes et grammairiens se réfèrent au même vocabulaire – tel que « dénaturer » ou « abuser » – pour parler du mauvais usage de la langue et des relations entre femmes ? Ainsi l’article « Dictionnaire » de L’Encyclopédie explique : « Une langue se dénature de deux manières, par l’impropriété des mots et par celle des tours ; on remédiera au premier de ces deux défauts, non seulement en marquant avec soin, comme nous avons dit, la signification générale, particulière, figurée et métaphorique des mots ; mais encore en proscrivant expressément les significations impropres ou étrangères qu’un abus négligé peut introduire, les applications ridicules et tout à fait éloignées de l’analogie, surtout lorsque ces significations et applications commenceront à s’autoriser par l’exemple et l’usage de ce qu’on appelle la “bonne compagnie”. »
Si ...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Remerciements
- Introduction
- Première partie - TE NOMMER CORPS LESBIEN (XVIe-XVIIe SIÈCLE)
- Deuxième partie - DES MYSTÈRES DE LA NATURE À CEUX DE LESBOS (XVIIIe SIÈCLE)
- Troisième partie - BRÈCHES DANS LA CITÉ DES HOMMES (XIXe-XXe SIÈCLE)
- Conclusion
- Avertissement
- Bibliographie
- Table