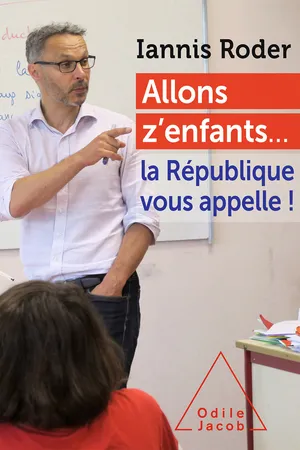
- 272 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Allons z'enfants... la République vous appelle !
À propos de ce livre
« J'ai tâtonné, tenté, échoué parfois… Mais j'ai aussi remporté des victoires. C'est de ces victoires qu'il sera question ici. Ce livre est le fruit d'années de réflexion sur mon métier et sur mon rapport à chaque élève. Ces enfants sont de jeunes Français qui, pour la majorité d'entre eux, veulent réussir et s'accomplir. Pour l'enseignant républicain que je suis, l'enjeu n'est pas uniquement d'offrir à chacun d'eux un métier et une réussite professionnelle. C'est également d'en faire des citoyens français, conscients des enjeux qui traversent notre République et attachés à ses valeurs. C'est là, selon moi, le rôle premier de l'école. » I. R. Fondé sur vingt ans d'expérience dans un collège de zone difficile, nourri d'anecdotes et de portraits d'élèves, un plaidoyer lucide, et malgré tout optimiste, pour une école et une société apaisées. Iannis Roder est professeur agrégé d'histoire et enseigne dans un collège de Saint-Denis. Il est également responsable des formations au Mémorial de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean-Jaurès. Il est à l'origine d'un programme pour les élèves, InterClass', monté avec France Inter, qu'il présente dans ce livre.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Allons z'enfants... la République vous appelle ! par Iannis Roder en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Política y relaciones internacionales et Ensayos en política y relaciones internacionales. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
ISBN de l'eBook
9782738145024TROISIÈME PARTIE
L’école à l’épreuve du réel
CHAPITRE 7
Tout commence par la langue
On l’a dit, un des rôles assignés à l’école est d’ouvrir au monde. Mais comment faire quand on se heurte à des difficultés qui viennent s’ajouter ou s’amalgamer aux pesanteurs sociales et géographiques ?
« Je comprends rien… » :
une langue appauvrie
Les jeunes enseignants mutés pour leurs premiers postes dans les collèges des quartiers dits « sensibles » sont toujours surpris, voire choqués, par les difficultés d’expression de leurs jeunes élèves, par leur manque criant de vocabulaire et par leur incapacité à exprimer, dans de courtes phrases, orales ou écrites, ce qu’ils ressentent ou ont envie de dire. Certains ne comprennent qu’une partie de ce que leur dit leur enseignant faute de vocabulaire et de maîtrise des structures linguistiques. Ils ne saisissent qu’un mot sur deux, alors que l’enseignant fait l’effort de répéter, avec des mots simples, ce qu’il a déjà expliqué auparavant, à l’exemple de cette jeune fille qui, lors d’un cours sur la Guerre froide, avait eu le courage de dire : « Vous parlez chinois, monsieur. J’entends des sons mais je ne comprends rien… »
Dès que le propos emprunte au vocabulaire politique et historique, ces élèves ne peuvent plus suivre, ils ne comprennent pas le sens des mots, encore moins celui des phrases. Le professeur doit prendre le temps, encore, d’expliquer chaque terme d’un document, d’en reformuler chaque phrase, pour le rendre accessible à tous. C’est ainsi que les grands textes patrimoniaux comme la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou la Constitution des États-Unis d’Amérique, le fameux texte commençant par « Nous, le peuple… » de 1787, doivent être reformulés – voire traduits ! – dans une langue plus accessible.
Les échanges sont parfois très limités dans les familles et il n’est pas rare que les parents ne parlent pas à leurs enfants et que ces derniers n’aient pas avec eux d’autres échanges que le strict nécessaire de la cohabitation. Or le vocabulaire se fixe d’abord au sein du noyau familial, quelle que soit la langue utilisée. Les conversations entre les membres de la famille permettent non seulement un élargissement du vocabulaire, une meilleure connaissance des expressions, mais ouvrent également la possibilité d’échanges explicatifs sur les faits et les choses. La pauvreté des échanges au sein des familles explique aussi, en partie, la faiblesse de la langue tout comme l’ignorance des expressions et des tournures de phrase de nombreux élèves qui vivent dans un univers où les communications orales sont pauvres et limitées.
Ce terrible handicap, réellement discriminatoire et peut-être plus que tout autre, pose problème à l’enseignant dans la mise en place de pédagogies actives durant lesquelles les élèves travaillent de manière autonome. Les dictionnaires, mis à disposition sur les tables, n’ont pas toujours une réelle utilité car si des élèves sont amenés à rechercher certains termes, ils se heurtent vite à leurs limites et ne comprennent pas les définitions. On les entend dire : « Je comprends pas [sic] ce qu’il y a marqué dans le dictionnaire. » Dans cette configuration, il devient compliqué de les laisser sans soutien actif, d’autant plus que s’il existe des classes avec des élèves dotés d’un bon niveau de vocabulaire et qui peuvent venir en aide, dans le cadre d’un travail de groupe, à ceux qui ont des difficultés de compréhension, ce n’est pas systématiquement le cas et certaines classes ne comptent aucun élève réellement capable d’aider les autres. Il y a ainsi, chaque année, des classes dans lesquelles aucun élève n’obtient une moyenne de 10 sur 20 au brevet blanc du collège, ce qui signifie qu’aucun élève ne serait admis s’il n’était évalué que par un examen final. Mais nous obtenons, dans mon collège, 80 % de réussite, donc tout va bien…
Cette absence de vocabulaire, cette faiblesse de la langue deviennent donc de sérieux obstacles à la progression et, au-delà, à l’éducation de citoyens avertis et autonomes. Faire des citoyens est un travail de longue haleine. Un travail que doivent se partager les familles, premières prescriptrices de normes sociales mais aussi de valeurs, et l’école, dont le rôle est de mettre ces valeurs, mais également le modèle politique et démocratique qui les sous-tend, en perspective. Mais cet objectif n’est accessible qu’à la condition que les bases de la langue soient acquises, ce qui n’est pas toujours, tant s’en faut, le cas.
C’est ainsi que dans le cadre d’un travail sur les valeurs de la République, j’avais décidé de faire travailler les élèves en autonomie à partir de textes d’articles de la grande presse française. Ils devaient les lire, un dictionnaire à disposition, et dire quelles étaient les valeurs dont il était question dans les articles étudiés, qu’elles fussent affirmées ou bafouées. Le titre de certains articles facilitait grandement la tâche : « En Afrique, l’homosexualité hors la loi » titrait par exemple un article du Monde du 14 février 2014 ; mais d’autres demandaient une véritable lecture et donc un véritable effort cognitif à certains adolescents, ce qui, au bout de dix minutes, se traduisait systématiquement par un échange devenu, l’expérience aidant, habituel pour le professeur :
« Et bien alors ? Tu n’as pas avancé. Où est le problème que tu rencontres ?
– Je comprends rien…
– Comment cela, tu ne comprends rien ? Bon, dis-moi ce que tu ne comprends pas dans l’article.
– Ben… tout…
– Tout ? Mais enfin, ce n’est pas possible. Dis-moi quoi précisément.
– Ben…
– As-tu lu l’article ?
– Ben non… Mais c’est trop long…
– Mais il fait dix lignes ! Fais l’effort s’il te plaît !
– Pffffff… C’est long ! »
Lire un texte de dix lignes est un effort intellectuel parfois insurmontable pour ces élèves de 15 ans. Et tout professeur, de lettres ou d’histoire-géographie par exemple, en a fait l’amère expérience. Étudier une œuvre complète en cours de français conduit à laisser systématiquement de côté une partie des élèves parce qu’ils n’ouvrent pas le livre. Lire des articles de presse, choisis par l’enseignant car suffisamment explicites et accessibles, n’est pas nécessairement aisé. De fait, les contresens sont généralement assez courants. Ainsi de cet article du Parisien1, qui abordait la question des violences perpétrées contre les albinos en Tanzanie, accusés par la croyance populaire d’être des sorciers, dotés de pouvoirs magiques. L’article relatait le drame vécu par un jeune garçon de sept ans, agressé et amputé d’une main par des adultes. L’idée était de montrer que, dans certains pays, la différence effraie et que certaines personnes sont menacées dans leur quotidien pour ce qu’elles sont. Après lecture, un certain nombre d’élèves, noircissant avec soin la fiche d’activité, notèrent que le jeune garçon, parce qu’il était un sorcier, agressait les gens, qui devaient bien se défendre… Je pourrais multiplier les exemples mais il est évident qu’il s’agit en premier lieu d’un problème de pauvreté de la langue, véritable obstacle à la compréhension.
Presque plus inquiétant, il est courant que des élèves ne comprennent pas les extraits de film étudiés, ne saisissant ni la situation ni même les dialogues. N’ayant pas intégré les connaissances permettant de situer l’action, comme le drapeau rouge ou l’étoile rouge sur un calot de soldat, bien visibles dans l’ouverture du film Stalingrad de Jean-Jacques Annaud, ils sont incapables de comprendre l’action. De plus, systématiquement, il faut leur expliquer les dialogues et leur signification, les termes de vocabulaire employés afin qu’ils puissent comprendre les scènes étudiées.
Face à ma surprise, feinte car j’essaye, sans les brusquer ou les braquer, de leur faire comprendre qu’il est inquiétant qu’ils n’aient pas accès au sens des dialogues entendus et des scènes visionnées, ils me répondent que « ce qui compte dans un film c’est l’action » ! Certes, mais si on ne comprend pas ce qui se déroule pendant le film ? « Ben, moi, j’attends la fin pour comprendre parce qu’avant, souvent, je comprends rien », réplique Sarah, 15 ans. « Mais pourquoi regardes-tu si tu ne comprends pas ? », lui ai-je alors demandé. « Ben parce qu’il y a de l’action ! » Inès, même âge, s’est révélée incapable de comprendre un extrait d’Ennemi intime de Florent Emilio Siri (2007), montrant une escarmouche entre soldats français et combattants du FLN durant la guerre d’Algérie. Elle ne comprenait même pas le sens des images. « Mais moi je comprends pas, la caméra elle change tout le temps, je comprends rien à ce qu’ils font là », avoua-t-elle, un peu désemparée. Les dialogues de l’extrait ne laissaient pourtant aucune place au doute. Le réalisateur avait fait en sorte que les différents groupes soient clairement identifiés.
Il suffit de demander à des élèves de lire un court texte à voix haute pour constater que nombre d’entre eux ne comprennent pas ce qu’ils lisent, même en classe de troisième. La lecture peut ne pas être fluide et des élèves buter sur des mots. La ponctuation n’est parfois pas marquée par le lecteur et la manière de lire témoigne de l’incompréhension, ce qui débouche parfois sur des dialogues cocasses :
« Alors, tu as lu ce texte ? Qu’as-tu compris ?
– Ben, j’ai rien compris, je lisais ! »
Tandis que certains se concentrent tellement sur les termes à déchiffrer qu’ils ne sont pas en mesure de comprendre ce qu’ils lisent, les autres, qui écoutent, ont bien du mal, du fait de cette lecture difficile, à saisir le sens du texte… Le professeur doit donc le relire et se lancer dans des explications de vocabulaire et de sens. Et le temps passe… Ce qui pourrait être fait en une heure de cours doit être sérieusement revu à la baisse : un court texte ou un extrait de film, quelques questions, et au mieux, quelques phrases rédigées à la fin. Les bons élèves, qui suivent sans difficulté, peuvent vite s’ennuyer et il est nécessaire de prévoir des activités supplémentaires ou de leur demander d’épauler des camarades qui ont plus de mal à réaliser le travail demandé.
Un enseignant sait, aujourd’hui, que les différences de niveau entre les élèves d’une même classe peuvent être immenses. Ils n’avancent pas au même rythme, n’ont pas la même compréhension des documents et des événements étudiés, n’ont pas les mêmes facultés pour répondre à un questionnaire, remplir un schéma, rédiger un paragraphe logiquement construit. Le professeur doit donc réfléchir à occuper et nourrir intellectuellement les élèves les plus rapides et prévoir l’organisation nécessaire de sa classe face aux rythmes différents des élèves. Ce n’est donc pas un cours qu’il doit préparer, mais deux ou trois, s’il veut bien faire et que chacun y trouve son compte. Cela n’est pas possible pour l’ensemble des cours, qui d’ailleurs ne le nécessitent pas systématiquement. Le temps de travail demandé devient en effet trop important. Les enseignants ont beau être, pour l’immense majorité d’entre eux, impliqués, volontaires et dévoués, ils ne peuvent, dans les conditions qui sont les leurs et la reconnaissance qu’on leur porte, sacrifier leur vie personnelle et familiale pour que chaque élève puisse travailler à son rythme. Le collège unique, malgré les efforts des professeurs, crée nécessairement des inégalités de traitement.
Il y a déjà des années que ce terrible constat a été fait2 et la situation semble ne pas évoluer. Les élèves continuent d’entrer au collège avec, pour certains d’entre eux, de réelles difficultés de lecture et d’écriture et ils en sortent, en fin de troisième, avec ces mêmes difficultés.
Au collège, c’est trop tard
Régulièrement, la question de l’apprentissage de la lecture, qui conditionne nécessairement celle de l’écriture, revient sous les feux de l’actualité. Le dramatique constat fait par les enseignants du secondaire est aujourd’hui dénoncé par ceux du supérieur. Si ces derniers se voient obligés de mettre en place, dans des premiers cycles universitaires, des cours de français, notamment d’orthographe et de grammaire, c’est bien que quelque chose dysfonctionne ! Et chacun de se renvoyer la responsabilité : les universitaires blâment les professeurs du lycée qui se tournent vers les enseignants de collège, lesquels s’interrogent sur ce qui a été fait dans le premier degré pour qu’on ait des enfants quasi illettrés à l’entrée en classe de sixième. Il n’est pas rare d’entendre des collègues du lycée voisin nous demander : « Mais pourquoi nous envoyez-vous des élèves qui ont un tel niveau d’expression écrite ? » Auquel répond, comme en écho : « Mais qu’ont-ils fait en primaire ? », tout aussi désemparé.
Il faut bien chercher d’où vient le mal… Le constat est pourtant simple : un élève qui entre au collège avec de grandes difficultés de lecture et d’écriture en sortira avec, à peu près, les mêmes lacunes, en ayant traversé le collège avec sa souffrance et ses échecs. Les progrès sont en effet peu nombreux. Les expériences menées au collège, notamment en divisant les classes et en offrant aux élèves la possibilité, en français et en mathématiques par exemple, d’évoluer par groupes de huit, n’ont pas eu de résultats probants. Cette expérience pédagogique coûteuse (un professeur de lettres pour huit élèves) a été menée pendant plus de cinq ans dans mon établissement, sans qu’il en soit fait une évaluation scientifique sérieuse. Les professeurs constataient que les élèves les plus faibles, regroupés dans un « groupe de besoins », ne progressaient pas ou très peu. Les élèves de niveau moyen et les bons élèves profitaient davantage de ce dispositif. Mais celui-ci avait d’abord été pensé pour les élèves en difficulté ! Cela ne leur servit à rien ou presque et ce n’était pas faute de bonne volonté, d’engagement et d’ingéniosité pédagogique de la part de professeurs confirmés qui firent d’ailleurs le choix de terminer leurs carrières au collège après y avoir enseigné plus de trente ans pour certains3. Le constat est donc sans appel pourvu qu’on accepte de le voir : au collège, c’est trop tard. Un élève qui présente un retard important en termes de langage, de lecture et d’écriture à son entrée au collège ne le rattrapera pas. Cela se joue donc avant, à l’école élémentaire.
La défaite de la lecture :
il était temps de le voir
À la rentrée de...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Introduction
- PREMIÈRE PARTIE - L'école peut travailler autrement
- DEUXIÈME PARTIE - L'histoire, un enseignement politique
- TROISIÈME PARTIE - L'école à l'épreuve du réel
- « De notre part »
- Conclusion
- Table