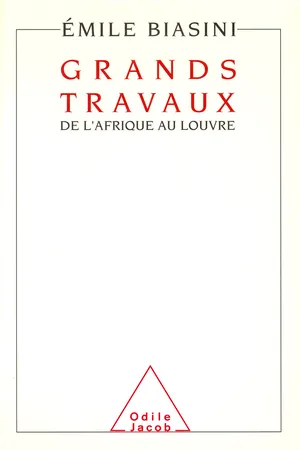
- 350 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Travailler avec André Malraux, intellectuel captivé par la politique, puis avec François Mitterrand, politique fasciné par les intellectuels : telle fut la chance d'Émile Biasini. Serviteur de la France coloniale en Afrique, acteur de la création du ministère de la Culture sous de Gaulle, directeur de la télévision au temps de l'ORTF, artisan de l'aménagement de la région Aquitaine, cheville ouvrière du projet du Grand Louvre, puis secrétaire d'État aux Grands Travaux, il raconte une vie au croisement des cultures, une vie au service de la culture.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Grands Travaux par Émile Biasini en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politique et relations internationales et Politique. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
PREMIÈRE PARTIE
Afrique noire
1946-1960
CHAPITRE 1
Pourquoi l’Afrique ?
J’avais dix-huit ans en 1940, et c’est la guerre qui m’a permis de réaliser l’émancipation dont je rêvais depuis l’adolescence et de m’éloigner d’une famille déchirée. Malgré son aisance matérielle, mon enfance, privée de refuge maternel, ne m’a laissé qu’un souvenir de solitude, de mélancolie, et de révolte.
Les chantiers de jeunesse, le refus du travail obligatoire en Allemagne, puis le maquis et la clandestinité ont alors servi de cadre à l’indépendance pour laquelle j’ai quitté définitivement la Provence. Devenu, à la Libération, élève-administrateur des colonies, j’ai finalement été affecté en Afrique, où ma vraie vie a commencé.
Mon parcours africain s’est achevé en 1960, et s’est ainsi déroulé tout entier dans le temps de la décolonisation. À des titres divers, j’ai effectivement participé à cette évolution. Je dois cependant à l’honnêteté de dire que je n’étais pas parti en Afrique pour la décoloniser. Je n’avais pas reçu de formation politique, et les colonies, dans ma jeunesse, me préoccupaient moins que l’Espagne, et que Hitler : dans mon enfance, chaque roulement de tambour de l’appariteur municipal m’inspirait la crainte d’une déclaration de guerre, telle qu’on m’avait décrit celle de 1914.
Essentiellement provençale, ma famille se consacrait à deux activités, mon père à la maçonnerie à Noves, et le groupe maternel à l’expédition des fruits et légumes, principale ressource de Châteaurenard. Mon patronyme, lui, vient du Tessin, apporté par mon arrière-grand-père, un pauvre maçon de Lugano qui s’était mêlé avec sa truelle à un convoi de rapatriement de militaires français réfugiés en Suisse à la débâcle de 1870. Marié en Provence, il y avait créé une petite entreprise que son fils, géant chaleureux et entreprenant, avait développée jusqu’à en faire l’une des plus importantes de toute la région. Généreux, infatigable, bon vivant, ce grand-père était, comme on dit au théâtre, une « présence », et j’imagine comment il a su, en deux tours de valse, conquérir la jolie et pieuse descendante d’une famille désargentée de vieille souche provençale. Ainsi ai-je pu naître dans la maison de Laure de Noves, la « Belle Laure » de Pétrarque.
Rien donc ne me destinait à l’outre-mer, non plus qu’à devenir fonctionnaire, et il m’est difficile d’expliquer les raisons profondes de ce choix, en dehors de mon désir de fuir une atmosphère que je détestais.
Il date de 1940. Les colonies prenaient alors une importance majeure dans la France résistante, et j’avais eu le privilège d’entendre l’appel de De Gaulle auprès d’amis de l’ambassade tchécoslovaque, repliée depuis 1939 à Marseille dans un bateau prêt à lever l’ancre selon la tournure des événements : la trahison de Munich avait mis les Tchèques en alerte. En juin 1940, le pire devenant réalité, leur bateau quitta le Vieux Port pour l’Angleterre. Pourquoi ne suis-je pas parti avec eux, comme ils m’y invitaient ? Pourquoi n’ai-je pas franchi le pas qui m’aurait libéré de mon milieu et permis d’obéir à la rébellion qui était née en moi aux discours de Pétain et à l’appel irréel de De Gaulle ? Sans doute n’étais-je pas prêt encore à m’assumer, et la source des comportements est souvent bien confuse. L’alchimie des actes essentiels d’une existence est complexe, qui mêle l’important et le futile, et devient difficile à juger rétroactivement, alors que tous les paramètres ont évolué. Je peux simplement dire, plus de cinquante années plus tard, que j’ai vécu cette histoire de Marius à l’envers dans un déchirement passionné, et que j’ai sans doute, ma vie durant, réglé au fond de moi ce compte avec moi-même.
La visée sur l’outre-mer résulte probablement de cette évasion manquée. Je crois aussi y trouver la trace d’un séjour de punition effectué, alors que j’avais onze ans, dans un monastère de Châteauneuf-du-Gard, sur un de ces pitons calcaires plantés de pins dominant la plaine de Tavel.
Sauvageon à mon entrée au lycée, j’avais fait une très mauvaise 6e, et m’étais enfui plusieurs fois, si bien que ma famille m’avait condamné à passer mes vacances dans ce qui était une maison de retraite pour vieux missionnaires venus d’Afrique. Les familles ont l’art de dénicher des lieux impossibles pour y mettre en punition les enfants rétifs ! Ce couvent des plus rustiques était habité par quelques bonnes sœurs et quelques vieux curés dont l’un était censé me donner des leçons de latin. C’était un prêtre chenu, barbu et en soutane blanche délavée, qui m’emmenait tous les après-midi sur un versant dominant les vignes pour m’enseigner le latin au milieu des pins et des cigales. Il me racontait en réalité (mais pas en latin !) des histoires de nègres, de sorciers et de lions, et je passais grâce à lui de fabuleux moments, d’autant qu’il portait toujours une vieille gourde militaire qu’il emplissait chaque matin de rosé de Tavel et qui, mieux que le soleil, lui servait à mesurer le temps : la gourde finie, c’était l’heure du dîner. Comble de licence, il m’autorisait à lamper quelques gouttes de son vin (pas trop !) si bien que je gagnais le réfectoire chaque soir pompette comme une grive, dans une euphorie qui me faisait supporter l’odeur renfermée et surie de toutes ces bonnes sœurs survêtues malgré l’été. Grâce au Père Rublon, ce séjour punitif à Châteauneuf-du-Gard fut transformé en vacances extraordinaires, un de ces moments qui m’ont le plus marqué.
Je trouve aussi dans mon souvenir la trace d’un roman, Malaisie1, qui fut, je crois, la seule œuvre de son auteur, et qui reçut le prix Goncourt dans les années trente : c’était l’histoire d’un planteur d’hévéas solitaire, orgueilleux et secret, de ces êtres qui cachent une blessure profonde derrière une sensibilité hautaine. Je crois aussi, enfin, et plus simplement que le programme du concours de « Colo » me convenait.
Quelles qu’en soient les causes profondes, c’est en Afrique que je suis finalement arrivé en 1946. Je m’y suis consacré jusqu’en 1960 en y vivant pendant douze ans, dont dix au Dahomey2. Mon séjour coïncide à peu près avec la période de décolonisation, marquée par quatre étapes majeures : la constitution de 1946 qui mit un terme à l’Empire français de l’avant-guerre en instaurant l’Union française ; la loi-cadre de juillet 1956 qui accorda aux territoires la responsabilité de gestion de leurs affaires internes ; le référendum de 1958 qui leur permit de choisir entre une communauté fédérale et l’indépendance. Celle-ci, enfin, acquise par tous les territoires en 1960.
CHAPITRE 2
Le voyage
À l’époque où l’avion n’avait pas raccourci les distances, les vieux coloniaux évoquaient avec nostalgie leurs longs voyages en bateau, temps irréel de luxe et de farniente entre l’inconfort de leurs postes de brousse et la routine des vies familiales retrouvées en métropole.
C’est effectivement en bateau que j’ai quitté Marseille en novembre 1946. Mais le Pasteur, orgueil de notre flotte sud-atlantique, avait été pendant la guerre transformé en transport de troupes, et servait alors à la relève vers l’Afrique.
Militaires et fonctionnaires mêlés, nous y étions entassés au point qu’il était impossible d’y trouver le moindre recoin d’isolement. Logé dans un pont inférieur, juste au-dessus de la ligne de flottaison, au milieu de tirailleurs sénégalais rapatriés, j’avais, par manque d’attention, accroché mon hamac à côté d’un pilier contre lequel le roulis me balançait régulièrement : on étouffait sous le plafond bas, de sorte que les nuits se passaient à la recherche d’un morceau de pont où l’on pût s’allonger. Les tirailleurs, eux, riaient et chantaient sous les veilleuses du dortoir, dans un remugle étouffant. Dans la journée, les panneaux restaient ouverts, et l’on pouvait s’y tenir pour respirer la mer, dont les vagues nous éclaboussaient.
On mangeait à la gamelle : on aurait cru partir pour la guerre.
Nous n’allions qu’à Dakar et le pacifique voyage ne dura que quatre jours, au bout desquels on nous débarqua au fin fond du port, où se fit le premier tri des passagers.
Les tirailleurs et tous les fonctionnaires destinés au Sénégal ou à la Mauritanie allèrent de leur côté. Les autres furent mis en convoi dans un train qui les conduisit à Thiès, centre ferroviaire majeur du « Dakar-Niger ». Nous nous répartîmes là dans les logements disponibles, et passâmes quarante-huit heures à découvrir en badauds cette ville sans grâce, ni africaine ni européenne, et qui, envahie de « petits Blancs », vivait du chemin de fer dans un climat disparate de pastis et d’arachides, de cheminots et de commerçants libanais, de savates et de boubous – ville sale, bruyante, où les chiens disputaient les ordures aux charognards, auxiliaires naturels des services de la voirie.
Ce fut un lugubre premier contact, une course vers les équipements indispensables, casques, shorts et chemises cousus à prix d’urgence par les tailleurs en plein air sur les marchés. L’ordre nous vint enfin de nous munir de provisions pour le voyage vers Bamako. Les hôtels avaient préparé les repas en les divisant en portions dans des morceaux de nappes en papier, et chacun prit le train avec une valise en osier remplie de bananes, d’oranges vertes, d’eau d’Évian et de quarts de poulet qui allaient rapidement s’avarier, s’ils ne l’étaient déjà au départ.
Dès la première nuit, entassés sur la plate-forme du wagon où pleuvaient selon le vent les escarbilles, nous découvrîmes l’Afrique à ses odeurs, et, à chaque halte pour faire de l’eau ou du bois, aux marchés que la brousse génère spontanément au moindre rassemblement de chalands.
Le convoi se décongestionna à Tambacouda et à Kayes qui reçurent leur part de fonctionnaires. Allégé, il ne comptait plus que les passagers pour le Soudan, la Haute-Volta, le Niger, le Dahomey et le Togo quand nous arrivâmes à Bamako.
Nous eûmes tout le temps de bien flâner dans une ville qui, enfin, ressemblait à l’Afrique, avec ses murs rouges et ses marchés bruyants, théâtres permanents de la rencontre du Nord sahélien et du Sud forestier.
J’y connus la première ivresse du voyageur et le temps, pour inconfortable qu’il fût, me parut trop court, à découvrir ses contrastes et à longer le Niger indolent et plat, mais fourmillant de vie.
Mais nous n’étions pas des touristes. On nous écoula peu à peu avec des réquisitions qui nous permirent d’emprunter les camions de transport indigènes, dont la jauge paraît infinie et qui, surchargés de grappes humaines, circulent acrobatiquement et tanguent dangereusement sur les pistes en soulevant des nuages de poussière.
Il fallait souvent les attendre plusieurs heures dans les campements où nous nous disputions les places, à Bougouni, Sikasso, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Fada N’Gourma. Les hasards de la route créaient en compensation des compagnonnages distrayants. Ignorant la durée du voyage, nous étions tous à court d’argent et les chefs de poste rencontrés sur le parcours nous faisaient des « avances » régularisées par des bons de caisse que nous mîmes longtemps à rembourser. Les administrateurs étaient peu nombreux au milieu des agents de tous ordres, travaux publics, agriculture, magistrature, santé, postes.
Ce voyage a constitué pour moi une immersion inattendue de plus d’un mois, à la fois multiple et superficielle, dans une Afrique entrevue dans sa diversité et sa continuité : Ouolofs, Bambaras, Mossis, Haoussas, Foullas, Baribas, deux jours par-ci, trois jours par-là, ce fut un véritable « tour » à la manière de ceux qui prétendent vous faire aujourd’hui découvrir la Chine en quinze jours, mais sans organisation aucune. Chaque chef de poste transitaire avait pour souci principal de se débarrasser au plus vite de l’encombrant convoi.
Mais, peu à peu, les conditions devinrent plus confortables, et il était notamment plus facile de se loger car notre troupe se réduisait à chaque étape.
À Niamey, nous n’étions plus que trois administrateurs, dont deux devaient rester dans le territoire. Nous étant présentés dès l’arrivée au cabinet du gouverneur, ce dernier choisit de m’offrir l’hospitalité au Palais, non sur ma bonne mine – nous étions également hirsutes, suants et poussiéreux – mais sur mon nom, d’apparence corse. Je bénéficiai ainsi pendant deux jours d’un confort oublié, mais angoissé, car il était tellement évident pour mon hôte que j’étais corse que je me sentais comme un usurpateur, craignant à tout moment une question directe sur mon village. Le temps des repas était à cause de cela redoutable. Quand je pris congé, je le remerciai de m’avoir fait connaître ce qu’on m’avait dit être l’hospitalité coloniale : « Mais surtout l’hospitalité corse », me précisa sa femme. Je détalai. Beaucoup plus tard, je revis ce gouverneur C. et lui fis l’aveu de ma gêne d’alors. Il en rit beaucoup.
Peu nombreux, les autres fonctionnaires avaient été récupérés par leurs services et je fis seul, de Niamey à Cotonou, la dernière partie de mon trajet, la descente vers le Sud. Quelle tranquillité enfin pendant ces derniers jours !
J’avais choisi le Dahomey de façon tout à fait hasardeuse, caractéristique au fond de la manière dont j’ai conduit toute ma carrière.
En 1940, à Marseille, j’avais pour camarade de préparation à « Colo » le fils du gouverneur du Dahomey, Jean Truitard. Nous étions devenus très amis. Tous les mois, il recevait de sa mère un colis de provisions (les restrictions étaient rudes !) et il le partageait généreusement avec moi. C’étaient essentiellement des confitures, du chocolat et des bananes séchées préparés par les sœurs d’Abomey-Calavi, auxquelles je pus faire plus tard une visite de reconnaissance émue.
Ce fut ensuite pour moi Paris, le maquis, la clandestinité. Quand je fus reçu à « Colo », je choisis la section indochinoise (j’ai même commencé à apprendre l’annamite et le cambodgien !). Mais je n’avais vraiment plus le goût à l’étude et, pour partir plus rapidement, je réussis, étant mobilisé, à me faire affecter en Afrique. J’allais donc vers l’inconnu, car je n’y étais pas préparé.
C’est sur le bateau, à la veille de l’arrivée à Dakar, que furent affichées les affectations décidées par le gouverneur général. J’appris ainsi que j’étais destiné au Niger.
Ce territoire avait un pouvoir d’attraction si fort que je fus immédiatement assailli par des camarades qui souhaitaient y servir. J’eus ainsi le choix entre plusieurs permutants. N’ayant aucune préférence, je choisis le Dahomey en souvenir des colis de Jean Truitard !
Mon entrée dans le territoire où j’allais vivre pendant dix ans se fit en franchissant le Niger à Gaya. J’ai conservé un souvenir particulièrement vif de cette dernière halte nigérienne.
Le soir, au campement, le chef de subdivision, Michel Sellier, vint me chercher et me logea chez lui. Devant sa résidence, qui dominait le fleuve sur un piton, il s’était fait construire une cage de grillage moustiquaire de la dimension d’une grande pièce dans laquelle il pouvait vivre ses soirées. Les deux nuits que j’y passai demeurent pour moi inoubliables. Je me sentais au bout du monde, sous cette lumière lunaire propre aux approches du désert, le fleuve scintillant en contrebas, dans la fraîcheur des brises alternées chargées d’odeurs différentes à chaque renversement, et des bruits lointains éclatant dans le silence, grésillements, aboiements, coassements, miaulements, rugissements – parfois un tam-tam insolite. J’aurais voulu ne jamais dormir. Sellier m’a fait vivre avec lui toute une journée de son métier de brousse. J’étais radieux, cur...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Avant-propos
- Première partie - Afrique noire 1946-1960
- Deuxième partie - La Métropole 1960-1982
- Troisième partie - Les Grands Travaux 1982-1993
- Finie l’histoire
- Index
- Table