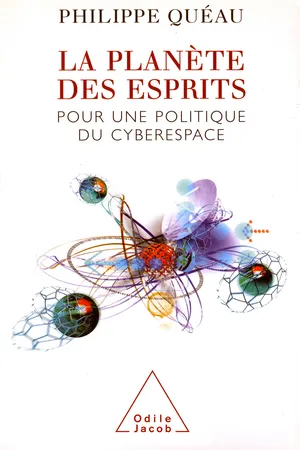
- 334 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Comment la "réalité virtuelle" influe-t-elle sur nos façons de voir le monde, sur nos relations avec les autres, sur notre sens du "réel" ? N'est-ce pas l'image même de l'homme qui se modifie, à mesure des évolutions technologiques ? La société planétaire qu'on nous annonce saura-t-elle nous redonner le sens du "bien commun" ou bien signera-t-elle le triomphe du marché ? Une révolution est en marche. Nous pouvons cependant encore l'infléchir. Raison de plus pour tenter de mieux mesurer, dès aujourd'hui, ses enjeux, son ampleur, ses conséquences. Philippe Quéau est philosophe. Il a fondé le salon "Imagina" sur les nouvelles images. Conseiller à l'Unesco, il a notamment publié Le Virtuel.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à La Planète des esprits par Philippe Quéau en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Technology & Engineering et Electrical Engineering & Telecommunications. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
ISBN de l'eBook
9782738140791TROISIÈME PARTIE
La nouvelle Réforme :
le bien commun, mondial abstraction politique
CHAPITRE XI
L’abstraction du bien commun
Le bien commun est toujours plus divin que celui de l’individu.
SAINT THOMAS D’AQUIN1
Le bonheur n’est pas une idée abstraite, mais un ensemble concret.
JOHN STUART MILL
Le bien commun n’est pas un certain état de choses, mais réside dans un ordre abstrait.
Friedrich A. HAYEK
La recherche du bien commun est l’essence de la politique. « Le bien relève de la science souveraine, de la science la plus fondamentale de toutes. Et celle-là, c’est précisément la science politique2. » Pour le Philosophe, l’affaire est claire, évidente, limpide. « Nous devons poser que la politique existe en vue de l’accomplissement du bon et non pas seulement de la vie en société3. »
Mais aujourd’hui comment définir le bien commun ? Comment définir le « bon » à une époque qui a perdu tout sens métaphysique ?
Est-ce que le bien commun est une « idée abstraite » ou un « ensemble concret » ?
Est-ce un certain « état des choses » ou un « ordre abstrait » ?
Le bien commun est-il une utopie irréalisable ou un objectif politique réaliste ?
Les opinions sont partagées. D’un côté, le bien, comme le bonheur, est éminemment concret, tangible. Mais d’autre part le concept de « commun » n’est-il pas particulièrement abstrait, comme le général ou l’universel ? Et d’ailleurs, existe-t-il un sujet collectif, une entité sociale, capable d’éprouver effectivement et de jouir de ce « bien commun » ?
Le bien commun, mélange contradictoire de concret et d’abstrait, n’est-il donc en fin de compte qu’un oxymore ?
De plus, le bien « commun » est-il compatible avec le bien « propre », le bien de l’individu ? Le bien de la personne, sujet de base de la civilisation occidentale, entre-t-il en conflit avec le bien collectif ?
Comment la personne se situe-t-elle par rapport à la sphère commune, comment l’intérêt privé se combine-t-il à la chose publique ?
La chute des idéologies collectivistes atteste la victoire de l’individualisme, tout au moins en Occident. En Orient, on tient encore aux fameuses « valeurs asiatiques » qui placent avant l’individu la famille, le groupe, la société, la nation… Pour combien de temps encore ?
La chute de la sphère publique, la perte de foi en cette abstraction qu’est l’« intérêt général » sont d’autres symptômes du cynisme rampant de la Real Politik mondialisée, de la société de marché mondiale qui se met en place.
La société de marché n’est pas d’abord fondée sur l’économique, ou sur la rationalité quantifiée du gain. Elle est d’abord fondée sur l’intérêt personnel, sur l’égoïsme des individus. Avant d’être « économique », l’Homo œconomicus est égoïste, séparé, indifférent, a-politique : il est l’antithèse du zoos politikos d’Aristote, qui n’existe que par la parole partagée avec les autres, par la cité construite en commun.
Le triomphe, peut-être passager, de l’individualisme dans les cultures occidentales n’est pas seulement une victoire qui semble définitive sur le collectivisme mais c’est aussi le symptôme de la perte de vitesse et de l’échec (provisoire ?) d’une forme d’humanisme. Il se traduit par une inflation tous azimuts de la sphère privée, sous l’influence des forces centripètes du désir de possession et de connaissance, et des forces centrifuges du désir de puissance.
La victoire de l’individu (étiqueté comme seule réalité effective dans le monde) sur le groupe, la société ou l’humanité (qui ne seraient que des abstractions idéologiques) avait été préparée de longue date par le travail de sape des nominalistes avant d’être théorisée par une certaine pensée économiste libérale.
Mais cette victoire n’apporte évidemment pas de réponse à la question essentiellement politique du bien commun, du bien de la communauté en tant que telle. L’individualiste ne recherche que son bien propre. Le bien de la communauté ne le concerne en rien. L’individualiste peut finir par se rendre compte que son idéologie pose vite des problèmes d’arbitrage lorsque des intérêts privés divergents sont en concurrence. Il faut bien alors une instance d’arbitrage, qui doit en principe se déterminer en fonction d’un critère supérieur. Mais quel critère choisir ? La « justice » ? Le « droit » ? L’« équité » ? L’« intérêt général » ?
Encore une fois, comment définir en général l’intérêt général ?
Il y a eu, dans l’histoire, des moments où cette question s’est posée avec virulence, de manière extrêmement concrète. Car le bien commun n’a pas d’abord été une idée abstraite, mais bien un « ensemble concret ». Les « biens communaux » en sont le prototype.
Il faut ici évoquer l’exemple fameux de l’appropriation des terrains « communaux » (les commons) en Angleterre. La clôture des terrains communaux et des champs ouverts (enclosures) et la conversion des terres arables en pâturages dans l’Angleterre des Tudor et des Stuart produisirent une véritable catastrophe sociale. Elles permirent certes aux riches investisseurs de développer l’élevage et l’industrie lainière, ce qui devait être bénéfique à très long terme, mais inaugurèrent aussi une assez longue période d’immenses souffrances sociales. « Les seigneurs et les nobles bouleversaient l’ordre social et ébranlaient le droit et la coutume d’antan, en employant parfois la violence, souvent les pressions et l’intimidation. Ils volaient littéralement leur part de communaux aux pauvres, et abattaient les maisons que ceux-ci, grâce à la force jusque-là inébranlable de la coutume, avaient longtemps considérées comme leur appartenant, à eux et à leurs héritiers. Le tissu de la société se déchirait4. »
Des régions entières furent décimées. De 1490 à 1640, la dépopulation prit des proportions gigantesques. Les Tudor et les premiers Stuart tentèrent délibérément d’empêcher par la législation que les demeures des laboureurs ne fussent détruites par les propriétaires, qui trouvaient plus rentable de convertir la terre à labour en terre à pâturages. Ils ne parvinrent qu’à ralentir ce processus, tant la pression économique fut forte. « Le simple expédient de tracer un unique sillon à travers un champ permettait parfois au seigneur contrevenant d’échapper à la condamnation5. »
Avec la « mobilisation des terres », tout un ordre du monde s’effondrait. Alors que « ni dans l’Antiquité ni dans le haut Moyen Âge – il faut l’affirmer avec force – les biens de la vie quotidienne n’ont été normalement vendus ou achetés6 », on transforma les produits de la terre en marchandises mobiles, susceptibles de circuler à grande distance. La division du travail entre industrie et agriculture avait commencé. Ce processus ne devait plus jamais s’arrêter, mais s’étendre dès lors jusqu’aux confins de la Terre. Le libre-échange et l’interdépendance planétaire commencèrent alors leur processus d’intégration économique de l’humanité, mais aussi de désintégration des valeurs anciennes.
Les valeurs féodales, pour « réactionnaires » qu’elles fussent aux yeux des « modernes » du capitalisme industriel naissant, n’en comportaient pas moins des aspects positifs, du moins du point de vue d’un certain équilibre social. Le cultivateur s’engageait, se fixait dans un environnement particulier, il créait les conditions concrètes de l’établissement d’une communauté humaine viable. Des générations patientes ont permis de construire peu à peu un tissu humain, un territoire habité, structuré, une substance sociale.
Ce sont ces valeurs, ces enracinements, ces coutumes, qui furent brutalement remis en cause. Les intérêts terriens n’étaient plus en phase avec le libéralisme économique en germination.
Cent cinquante ans plus tard, un bouleversement d’importance comparable au phénomène des enclosures s’abattit à nouveau sur l’Angleterre avec la révolution industrielle anglaise du XVIIIe siècle. Celle-ci s’est certes traduite par l’amélioration extraordinaire des moyens de production mais aussi par une désagrégation tragique de la vie du peuple. Les gens de la campagne s’entassèrent dans les taudis déshumanisés des villes, véritables abîmes de dégradation humaine. Les liens sociaux furent brisés. La substance même de la civilisation, les relations sociales, fut anéantie. « L’image même de l’homme avait été profanée par [cette] terrible catastrophe (…) Jeté dans le morne bourbier de la misère, le paysan immigrant se transformait bientôt en un indéfinissable animal de la fange (…) Il vivait maintenant dans des conditions matérielles qui étaient la négation de ce qui fait la forme humaine de la vie (…) Si les ouvriers étaient physiquement déshumanisés, les classes possédantes étaient moralement dégradées (…) À l’ahurissement des esprits réfléchis, une richesse inouïe se trouvait être inséparable d’une pauvreté inouïe (…) La compassion fut ôtée des cœurs et une détermination stoïque à renoncer à la solidarité humaine au nom du plus grand bonheur du plus grand nombre acquit la dignité d’une religion séculière7. »
On ne comprenait pas bien d’où ce paupérisme exacerbé pouvait bien venir. Mais on découvrait peu à peu, sans pouvoir les concevoir clairement car elles bafouaient la logique habituelle, les forces effrayantes de lois cachées, mais toujours à l’œuvre, tapies dans les circonvolutions du marché et dans les profondeurs réactives de la société, des lois non dites, mais capables de soumettre n’importe quel pouvoir apparent, y compris celui de l’État, à ses filets invisibles.
Jusqu’alors certaines valeurs morales inspirées du puritanisme anglais servaient de base d’analyse à la situation des pauvres. Le pauvre méritait sans doute de l’être par quelque atroce « prédestination », ou alors parce qu’il s’était rendu coupable d’un des nombreux péchés que la religion aime à trouver aux hommes. Autre hypothèse encore, il pouvait s’agir d’une épreuve comme celle que Job, dans son malheur, dut subir.
On se mit néanmoins à considérer la violence du développement du paupérisme et l’aggravation incroyable de leur situation suite à des mesures pourtant prises de bonne foi, mais qui accéléraient la déconfiture sociale, telle la loi sur les pauvres ou la loi de Speenhamland, dite du « système des secours », du 6 mai 1795, qui décida qu’un revenu minimum devait être assuré aux pauvres indépendamment de leurs gains.
Le résultat de cette loi fut paradoxalement calamiteux. « L’homme du commun perdit tout amour-propre au point de préférer à un salaire le secours aux indigents, son salaire, subventionné sur les fonds publics, étant voué à tomber si bas qu’il devait en être réduit à vivre on the rates, aux frais du contribuable (…) Sans l’effet prolongé du système des allocations, on ne saurait expliquer la dégradation humaine et sociale des débuts du capitalisme (…) Les masses en perdirent presque forme humaine », assène Polanyi.
On commença donc à découvrir que la « société » n’était pas innocente, qu’elle est bien « réelle » et non « nominale », n’en déplaise aux nominalistes. La « société » produit directement ou indirectement des effets d’une puissance telle qu’ils peuvent briser n’importe quel individu, pour peu qu’il soit placé au mauvais endroit, au point d’exercice de ces lois fantastiques, qui imposent leur tyrannie aux hommes, éberlués d’avoir ainsi ouvert la boîte de Pandore, sans même savoir comment.
Avec le problème lancinant de la pauvreté comme une énorme tache au milieu de la richesse inouïe et du progrès rapide de l’industrie, on avait découvert que la société humaine se trouvait désormais, par quelque magie, soumise à des lois invisibles, des lois non voulues par l’homme, et donc non humaines, et même proprement inhumaines, qui contrevenaient à toutes les bonnes volontés, à toutes les idées reçues.
On avait découvert l’économie politique.
On se mit à la recherche de ces lois invisibles, capables de casser les sociétés en morceaux, de briser les uns tout en apportant la prospérité aux autres, indépendamment de leurs mérites propres.
Adam Smith, l’un des premiers économistes « politiques », posa qu’une « main invisible » permet aux intérêts individuels de poursuivre tranquillement, en toute bonne conscience, leur activité : ils travaillent ce faisant au bien commun. Smith note très pragmatiquement que la tendance naturelle de l’homme à l’échange, au troc, au trafic, repose sur l’égoïsme. « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage8. »
Mais il nuance cependant son propos. Les comportements de l’individu sont certes autocentrés, mais sont aussi susceptibles de se décentrer, de s’ouvrir aux autres. Pour Adam Smith, certains hommes cherchent en fait, contre toute attente, à transcender leur propre intérêt : « Qu’est-ce qui porte constamment les hommes généreux, et souvent les autres, à sacrifier leur intérêt propre à l’intérêt supérieur de leurs semblables ? C’est l’amour de ce qui est honorable et noble, l’amour de la grandeur, de la dignité et de la supériorité de notre propre caractère9. »
L’homme est donc double : il est d’une part égoïste et tourné vers son propre intérêt, et il est aussi capable d’altruisme, en tant qu’il peut se rendre indispensable à certains êtres, et qu’il lui est indispensable (par amour-propre, ou pour d’autres raisons d’estime de soi) d’être indispensable à ces quelques êtres qui dépendent de lui. Ceci ouvre la voie aux théoriciens du lien social, les observateurs avisés de la compénétration et de la solidarité intrinsèque de la société et de l’individu, qui ne peuvent être niées sans contradiction patente.
L’individu ne s’oppose pas à la société. Il s’oppose à lui-même, et aux autres, et il collabore avec eux, dans son intérêt, mais aussi dans leur intérêt. Il est lui-même partagé, à la fois égoïste et social, solidaire et contradictoire.
La position « équilibrée » de Smith est intéressante à garder en mémoire, ne serait-ce que pour la confronter aux théories des libéraux contemporains, comme Friedrich Hayek, chez qui l’égoïsme est revendiqué sereinement, avec un parfait aplomb, comme une qualité fondamentale du bon fonctionnement de la « société ouverte ».
Les lignes d’intérêt et de partage entre individu et société sont confuses, mêlées. L’égoïsme sert la société, et l’altruisme social n’est pas sans récompense narcissique pour l’individu.
L’individu est dans un lieu paradoxal, « intermédiaire » (au sens platonicien des « intermédiaires », des metaxu10). Il est le passeur entre deux zones ontologiques, entre deux attracteurs de sens, entre deux espaces de significatio...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Avant-propos
- Les bergers de l’autre
- Première partie - La nouvelle Amérique : mondialisation et abstraction
- Deuxième partie - La nouvelle imprimerie : le virtuel, abstraction concrète
- Troisième partie - La nouvelle Réforme : le bien commun, mondial abstraction politique
- Quatrième partie - Le bonheur du monde
- Table
- Du même auteur