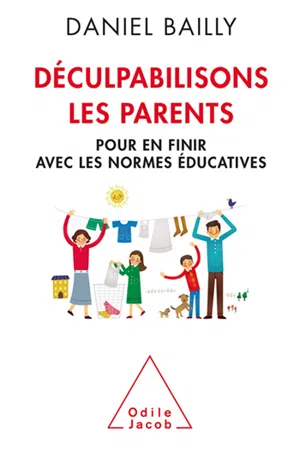
- 192 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Comment faire pour être de « bons » parents ? Comment faire pour bien élever son enfant et lui apporter tout ce dont il a besoin afin qu'il devienne un individu bien dans sa tête et dans son corps ? Parce que, aujourd'hui, le « bien » et le « mal » se conjuguent essentiellement en termes de « normal » et de « pathologique ». Et gare à ceux qui transgressent les règles du code de bonne santé ! Mais les normes qui ont modelé notre façon de concevoir l'éducation aident-elles vraiment les parents ? Font-elles de nos enfants des êtres plus épanouis, de meilleurs élèves ? Quel est le rôle, à titre personnel ou professionnel, de chacun d'entre nous dans cette approche normative des questions éducatives ? N'attendons plus. Il est urgent de retrouver une certaine liberté de penser et d'agir, nourrie de l'écoute des besoins de l'enfant, de ce qu'il est, et des valeurs que nous voulons lui transmettre. Daniel Bailly est pédopsychiatre, professeur de psychiatrie à l'université d'Aix-Marseille et exerce à l'hôpital Sainte- Marguerite de Marseille. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les questions d'éducation : La Peur de la séparation ; Alcool, drogues chez les jeunes : agissons.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Déculpabilisons les parents par Daniel Bailly en format PDF et/ou ePUB. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Éditeur
Odile JacobAnnée
2013Imprimer l'ISBN
9782738130044ISBN de l'eBook
9782738175755CHAPITRE 1
Et si le monde pouvait tourner aussi en écoutant les parents ?
Tous les parents se posent les mêmes questions. Comment faire pour être de « bons » parents ? Comment faire pour bien élever notre enfant, pour lui apporter tout ce dont il a besoin, pour le protéger des dangers qui l’attendent, pour qu’il devienne un homme ou une femme honnête et respectable, bien dans sa tête et dans son corps ? Et comme de nos jours le bien et le mal se conjuguent en termes de « normal » et de « pathologique », c’est tout naturellement vers la science et la médecine qu’ils se tournent pour essayer de trouver des réponses aux difficultés réelles ou supposées auxquelles ils peuvent un jour être confrontés.
Quand éducation se confond avec prévention
Contrairement à la médecine chinoise traditionnelle, fondée sur une théorie que l’on pourrait qualifier d’écologique du fonctionnement de l’être humain en bonne santé, la médecine occidentale s’est, pendant longtemps et aujourd’hui encore, essentiellement focalisée sur la maladie. Dans cette perspective, l’objectif n’est pas de définir les moyens pour aider les hommes à rester en bonne santé, mais de maintenir et, si nécessaire, de restaurer la santé en luttant contre la maladie, perçue comme un état déficitaire, comme une déviation par rapport à la « norme » qui serait ici l’absence d’indicateurs de maladie, voire de risque de maladie. Avec le temps, les progrès de la science et des techniques ont permis, et permettent encore de nos jours, de mieux définir les maladies, de les détecter plus tôt, d’en mieux connaître les causes et l’évolution. Ces progrès ont permis et permettent encore de nos jours de mieux préciser les différents types de maladies (maladies héréditaires, maladies d’origine traumatique, toxique, infectieuse, psychologique, sociale, etc.), de mieux les traiter et surtout de mieux les prévenir. Progressivement, sous l’influence de facteurs scientifiques et médicaux mais aussi économiques, s’est ainsi développée, à côté de la médecine de soins, une médecine de prévention qui va conduire à l’élaboration de politiques de santé publique à destination des sujets dits « bien portants », dont les dérives possibles ont été depuis longtemps soulignées16. Aujourd’hui, personne ne conteste le bien-fondé de ce qu’on appelle l’éducation pour la santé, même si, en se limitant aux comportements jugés « négatifs » et à leurs dangers, l’éducation pour la santé peut aussi rapidement devenir un instrument d’interdiction, de contrôle social et de « normalisation ».
Dans une société où la valeur dominante est la santé et le bien public, la science et la médecine, tant préventive que de soins, apparaissent désormais comme les garantes de l’ordre. Tout ce qui peut promouvoir la santé et maintenir l’ordre, comme la bonne nourriture, les bons médicaments, une bonne hérédité, de bonnes habitudes de vie, de bonnes attitudes éducatives, doit être intégré et encouragé. Tout ce qui peut favoriser la maladie et engendrer le désordre, comme les toxiques, les microbes, les mauvais aliments, l’hérédité chargée, les mauvaises habitudes de vie et les attitudes éducatives inappropriées, doit être découragé et éliminé17. L’énoncé des motifs de la loi du 31 décembre 1970 sur la toxicomanie en est un bon exemple. Il y est écrit : « À une époque où le droit à la santé et aux soins est progressivement reconnu à l’individu…, il paraît normal, en contrepartie, que la société puisse lui imposer certaines limites à l’utilisation que chacun peut faire de son propre corps, surtout lorsqu’il s’agit d’interdire l’usage de substances dont les spécialistes dénoncent unanimement la nocivité18. » Et que dire du décret publié au Journal officiel du 23 janvier 2011 qui prévoit la possibilité de suspendre les allocations familiales lorsqu’un élève mineur est absent de l’école sans motif valable au moins quatre demi-journées dans un même mois. Gare à ceux qui transgressent les règles du code de bonne santé ! Ceux-là menacent l’humanité d’un châtiment universel19.
Comme Philippe à propos des pleurs de son bébé, on peut comprendre aisément dans un tel contexte l’angoisse et les craintes suscitées chez les parents par tout comportement supposé ou réellement déviant présenté par leurs enfants. Mon enfant dort peu, est-ce normal ? Il mange trop (ou pas assez), est-ce normal ? Il n’aime pas la viande, est-ce normal ? Il est indiscipliné, est-ce normal ? Il s’oppose et ment, est-ce normal ? Il est fatigué, est-ce normal ? Il apprend mal à l’école, est-ce normal ? Il refuse d’y aller, est-ce normal ? Il passe beaucoup de temps sur son ordinateur ou devant la télévision, est-ce normal ? Il s’est enivré, est-ce normal ? Il a fumé du cannabis, est-ce normal ? On pourrait ainsi multiplier les exemples à l’infini. J’ai même rencontré des parents inquiets parce que leur petit garçon âgé de 3 ans préférait jouer avec les filles. De même que la maladie réelle d’un enfant mobilise toujours plus ou moins chez les parents des sentiments d’angoisse et de culpabilité, dans une société où la santé représente un devoir20, tout comportement supposé ou réellement déviant d’un enfant engendre chez les parents des sentiments d’angoisse et la crainte de n’avoir pas fait « ce qu’il faut », de ne pas être de « bons parents ». Curieusement (mais est-ce si paradoxal que cela en a l’air ?), cette pression sociale de conformité à la normalité s’exerce aussi, et de façon peut-être encore plus contraignante, au travers des parents eux-mêmes. Pour s’en convaincre, il suffit d’aller à la sortie des écoles et d’écouter ce que disent les parents à propos de ceux dont l’enfant n’est pas ou ne fait pas « comme les autres ». Et c’est fort logiquement que ces derniers vont s’en remettre au bon docteur.
C’est un fait, qu’on le veuille ou non, de nos jours, les parents demandent à la science et à la médecine de les aider à prévenir et à résoudre des problèmes, dont certains sont certes en rapport avec des maladies réelles mais d’autres en rapport surtout avec les difficultés de la vie quotidienne. Ainsi voit-on des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues intervenir sur des sujets aussi divers que le divorce, le choix du mode de garde des enfants, la place des grands-parents, la punition et les fessées, la rentrée scolaire, la télévision, le choix des amis, les sorties, les premières expériences amoureuses, les préférences vestimentaires et musicales, etc. Ce glissement d’une position d’aide et de soins à celle de contrôle dans une perspective normalisatrice a certes renforcé le pouvoir de la science et de la médecine sur la société. Mais que peuvent nous dire la science et la médecine sur de tels sujets ? Ne nous y trompons pas, face aux difficultés de la vie quotidienne, les pédiatres, pédopsychiatres et autres psychologues d’aujourd’hui sont certainement aussi impuissants que le furent leurs prédécesseurs. La différence est que, désormais, ces mêmes difficultés donnent lieu à des discussions passionnées, interminables et fortement médiatisées, sur leur caractère normal ou pathologique, leurs causes, leurs conséquences, la façon de les traiter et… de les prévenir21. Si l’Émile ou De l’éducation de Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762, qui se présente comme un traité sur « l’art de former les hommes » et qui aborde étape par étape les questions éducatives qui se posent au fur et à mesure que grandit l’enfant22, peut être considéré comme l’un des premiers ouvrages ayant trait à la prévention, de nos jours, ce sont les professionnels de la santé qui se sont emparés de l’éducation. Avec souvent cette drôle d’idée : que les parents sont incompétents et qu’il faut leur apprendre comment faire23.
Dans une société où le bien et le mal se conjuguent en termes de « normal » et de « pathologique », la préoccupation principale des parents n’est pas de « former l’esprit de leur enfant, de développer ses aptitudes intellectuelles, physiques, son sens moral » (définition du terme « éduquer » donnée par Le Petit Larousse), mais bien que leur enfant soit « normal », c’est-à-dire en « bonne santé », et donc d’essayer d’éviter qu’il ne présente des comportements jugés « pathologiques ». Dans ce contexte, pour les parents comme pour la société tout entière, la notion de risque a pris une importance majeure et certainement démesurée, souvent au détriment de l’attention qui devrait être portée aux besoins réels des enfants.
Messieurs les savants,
arrêtez de trouver des facteurs de risque, ça déborde !
Comme le rappelle M. Tubiana, « dès le XVIIIe siècle et les débuts de la Société royale de médecine, on avait compris que toute action de santé publique doit, pour être efficace, être fondée sur des données objectives ». En permettant d’identifier des groupes à risque et des facteurs de risque, les progrès de l’épidémiologie ont largement contribué au développement de la médecine de prévention24.
Un facteur de risque est un facteur dont la présence augmente de façon significative la probabilité pour un individu de présenter la maladie considérée. Lorsqu’on compare deux groupes d’individus, les uns présentant la maladie, les autres non, si un facteur donné est retrouvé avec une fréquence statistiquement plus élevée dans le groupe des individus malades, ce facteur peut alors être considéré potentiellement comme un facteur de risque pour la maladie en question. La notion de facteur de risque résulte donc d’abord d’une association statistique significative entre le facteur étudié et la maladie considérée. Une association statistique n’implique cependant pas obligatoirement un lien de causalité. Certains résultats peuvent être le fruit du hasard ou liés à des erreurs de méthodologie. C’est dire que d’autres critères vont intervenir pour juger si l’association statistique retrouvée témoigne d’une relation effectivement causale entre le facteur étudié et la maladie considérée. Quand un même facteur est retrouvé dans plusieurs études, sur des populations différentes, étudiées avec des méthodes différentes, on peut penser que ce facteur joue effectivement un rôle dans le déterminisme de la maladie. On peut d’autant plus le penser si l’association statistique est forte et le risque élevé. Il en est de même si le risque de la maladie augmente avec l’intensité de ce facteur. Le délai écoulé entre la présence du facteur étudié et la survenue de la maladie considérée doit aussi être compatible avec le développement de cette maladie. Enfin, il faut que la nature du facteur étudié s’accorde avec les connaissances que nous avons des mécanismes en jeu dans la maladie considérée. C’est-à-dire qu’il faut que nous disposions d’une théorie, qu’elle soit biologique, psychologique ou sociale, qui puisse rendre compte du rôle joué par ce facteur dans le déterminisme de la maladie. À la lecture de ces critères, on peut constater qu’en définitive, l’hypothèse de la causalité relève toujours d’un jugement personnel25. On est loin des données « objectives » tant espérées par la Société royale de médecine. Comme le soulignait à juste titre Albert Einstein : « C’est (toujours) la théorie qui décide de ce que nous sommes en mesure d’observer. »
Forts de ces précautions introductives, examinons maintenant quelques facteurs de risque identifiés sur deux sujets simplement, l’obésité et les troubles du comportement, qui font régulièrement la une de l’actualité et qui préoccupent les parents.
L’obésité de l’enfant pose de nos jours un problème majeur, tant par sa fréquence que par la gravité des complications qu’elle peut entraîner. C’est ce qu’on appelle un « véritable problème de santé publique ». Les deux grands facteurs impliqués dans le développement de l’obésité de l’enfant sont la surconsommation alimentaire et le manque de dépense énergétique26. La surabondance de nourriture, attribuable aux moyens industriels de sa production, apparaît comme l’une des premières causes de cette surconsommation. C’est logique. Si les enfants et les adolescents d’aujourd’hui mangent beaucoup, c’est bien, d’abord et avant tout, parce que de très nombreux aliments sont disponibles et facilement accessibles, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. De plus, les enfants et les adolescents d’aujourd’hui sont exposés à de nombreuses publicités, en particulier télévisées, pour des produits alimentaires souvent gras et sucrés, à haute densité énergétique27. Ainsi, ce n’est pas seulement la quantité de nourriture ingérée mais aussi sa qualité (schématiquement, riche en « mauvais » gras et en « mauvais » sucre) qui, en altérant les mécanismes régulateurs de la faim et de la satiété, concourt à cette surconsommation28. Dans ce contexte, l’influence des parents, et plus généralement de l’environnement familial, apparaît considérable dans le processus des choix alimentaires29. L’évolution actuelle vers une plus grande sédentarité, due notamment au développement des moyens de transport et surtout des nouvelles technologies (ordinateur, télévision, consoles de jeux vidéo) explique par ailleurs le manque de dépense énergétique30. Si la prise de poids est une question de comptabilité énergétique, le métabolisme joue aussi un rôle important. Celui-ci peut varier considérablement d’un individu à l’autre, et certains enfants sont donc plus à risque que d’autres de devenir obèses. À ce titre, il est aujourd’hui établi que des facteurs héréditaires entrent également en ligne de compte31. Et ce n’est pas tout. Le manque de sommeil chez l’enfant est reconnu comme favorisant la prise de poids32. La thermorégulation assistée (climatisation artificielle et chauffage), en limitant les dépenses énergétiques33, et les polluants organiques (pesticides, plastifiants, antimicrobiens, retardateurs de flammes), en perturbant le système endocrinien34, ont aussi été incriminés. Enfin, il ne faut pas oublier l’importance de la période périnatale. Certains facteurs in utero, comme un surpoids de la mère en début de grossesse, une prise de poids excessive ou le tabagisme maternel en cours de grossesse, affectent déjà le métabolisme du fœtus et prédisposent l’enfant à l’obésité35. Et, comme nous l’avons vu, l’allaitement artificiel, en raison de la composition des préparations pour nourrissons, favorise la constitution d’une obésité36. À moins d’être parfaitement zen ou d’avoir les connaissances nécessaires pour interpréter avec lucidité toutes ces données, difficile, au vu de ce catalogue, de ne pas craindre que son enfant devienne obèse.
Prenons maintenant l’exemple des troubles du comportement. On regroupe habituellement sous ce terme, parce qu’ils se trouvent souvent associés et qu’ils partagent de nombreux facteurs de risque communs, l’hyperactivité, les comportements provocateurs, opposants et agressifs, les conduites antisociales (bagarres, vols, destruction de biens, fugues, école buissonnière) et les conduites d’abus d’alcool et de drogues. C’est la hantise et le cauchemar des parents et bien sûr, par leur fréquence et la gravité de leurs conséquences, un « véritable problème de santé publique ». Mais ça, c’est une évidence. De nos jours, tout problème de santé est devenu un « véritable problème de santé publique ». Toutes les études soulignent la fréquence des troubles du comportement retrouvés chez les enfants et les adolescents issus de milieux socio-économiques et culturels défavorisés. Ce lien fort, constaté depuis longtemps, entre conduites déviantes et désorganisation de l’environnement psychosocial a même conduit certains auteurs à parler de « sous-culture délinquante », ou plus récemment de « culture de la pauvreté ». En fait, la pauvreté expose souvent l’enfant à de nombreux facteurs de risque (et de stress) qui s’ajoutent les uns aux autres et se renforcent37. Indépendamment de cette situation, le fait d’avoir des parents qui présentent eux-mêmes des troubles affectifs ou comportementaux (essentiellement abus de substances et troubles de la personnalité antisociale chez les pères, troubles anxieux et dépressifs chez les mères), par l’intermédiaire de facteurs génétiques et/ou en raison de l’ambiance familiale qu’ils engendrent, favorise la survenue de troubles du comportement chez l’enfant38. La discorde parentale et le divorce des parents, surtout si les dissensions persistent après la séparation, ont aussi une influence directe sur les troubles du comportement de l’enfant39. Il en est de même des pratique...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Dédicace
- Avant-propos
- Introduction
- CHAPITRE 1. Et si le monde pouvait tourner aussi en écoutant les parents ?
- CHAPITRE 2. Les chiens ne font pas des chats (et vice versa)
- CHAPITRE 3. Pourvu qu’il ne lui arrive rien !
- CHAPITRE 4. L’école, cette amie qui vous veut toujours du bien
- CHAPITRE 5. IL faut bien vivre avec son temps
- Conclusion
- Postface
- Notes
- Table des matières
- Du même auteur
- Appendice
- 4e de couverture