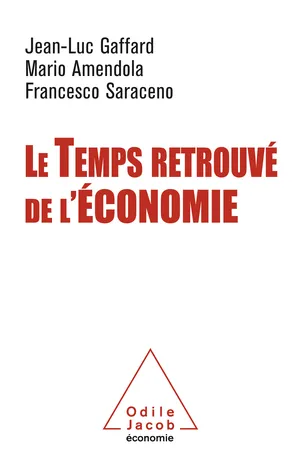
- 288 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Le Temps retrouvé de l'économie
À propos de ce livre
Le temps est le grand absent de la théorie économique. Telle est la thèse de ce livre qui dénonce l'impuissance des économistes à proposer des remèdes adéquats face à l'instabilité actuelle ou, tout simplement, à saisir l'économie dans sa réalité, toujours singulière et mouvante. Renvoyant dos à dos néoclassiques et kéneysiens, s'opposant à l'idée que le retour à l'équilibre est la fin de l'histoire, les auteurs soulignent que les phénomènes économiques sont faits d'incertitude et d'irréversibilité. Ils montrent que le regard sur les acteurs économiques se trouve radicalement modifié par la prise en compte du temps : l'entrepreneur, initiateur de ruptures, redevient un arbitre entre le court et le long terme ; la monnaie et le crédit sont vus comme des ponts indispensables vers le futur ; les pouvoirs publics sont appelés à renouer avec leurs fonctions de régulation. Les économies de marché se voient ainsi dotées d'une nouvelle capacité de résilience qui réside principalement dans cette maîtrise – décisive – des horloges multiples. Jean-Luc Gaffard est professeur émérite à l'université Côte d'Azur, chercheur à l'OFCE-Sciences Po et à Skema Business School, et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Mario Amendola est professeur émérite à l'Université de Rome La Sapienza. Francesco Saraceno est chercheur senior à l'OFCE-Sciences Po, professeur à Sciences Po et à la LUISS Guido Carli de Rome.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Le Temps retrouvé de l'économie par Jean-Luc Gaffard,Mario Amendola,Francesco Saraceno en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Commerce et Commerce Général. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
DEUXIÈME PARTIE
Instabilité et résilience d’une économie dans le temps
CHAPITRE 4
Le temps pour produire
Il existe deux façons d’appréhender le long terme en économie. L’une consiste, comme nous l’avons vu (chapitre 1), à en faire l’expression de données « réelles », essentiellement technologiques, les événements à court terme n’étant, au pire, que des déviations par rapport au sentier ainsi déterminé, un sentier qui peut être fait de petites fluctuations, qualifiées de naturelles, attribuées à des chocs positifs ou négatifs de productivité. L’autre façon consiste à voir dans le long terme une succession de périodes que l’on peut qualifier de court terme, articulées les unes avec les autres à raison des distorsions et des déséquilibres transmis. Court terme et long terme n’existent pas en eux-mêmes. Ils n’existent que l’un par rapport à l’autre. L’essentiel réside dans le processus qui se construit en cours de route dont la viabilité, non l’optimalité, est en jeu (Amendola et Gaffard, 1988, 1998, 2006).
Cette dernière démarche repose sur l’observation que la production prend du temps au sens où les capacités de production doivent être construites avant d’être utilisées. Dans ces conditions, l’investissement des entreprises est non seulement une demande qui donne lieu à création d’emplois et distribution de revenus à court terme, mais aussi une création de nouveaux processus de production qui se rapporte à un marché futur essentiellement inconnu et structure l’évolution sur la longue période. Incertitude et irréversibilité caractérisent cette évolution qui répond à de multiples interactions et peut emprunter de multiples sentiers.
C’est à une révision de l’analyse du fait productif que l’on est ainsi convié en tout premier lieu. De fait technique, il devient un fait organisationnel dont dépend le choix des technologies mises en œuvre, sinon même créées. L’organisation dite industrielle de l’activité est, à la fois, la source du taux d’utilisation maximal possible des ressources productives existantes et une incitation à en créer de nouvelles. Les changements récurrents qu’elle suscite provoquent des ruptures systématiques de la structure productive Des fluctuations du produit et de l’emploi en résultent à raison des défauts de coordination qui ne manquent pas de survenir en cours de route, sans qu’il soit besoin d’en appeler aux propriétés de la technologie ou à l’existence de troubles monétaires et financiers pour les expliquer.
Dans cette perspective, le marché en tant qu’il est créateur, dans le temps, d’informations et de connaissances participe du processus de coordination. Pour autant, ce n’est pas le marché de concurrence parfaite qui est ici considéré, supposant une coordination parfaite et instantanée, mais un marché « normalement » imparfait, caractérisé par des restrictions naturelles ou contractuelles auxquelles les entreprises sont soumises : des restrictions de comportement qui concourent au processus de coordination et s’avèrent déterminantes de l’incitation à investir dès lors qu’elles permettent à l’entreprise de maîtriser le profil temporel de la production et de tabler sur la fiabilité des anticipations à long terme.
Ces restrictions affectent la nature de la technologie mise en œuvre, ou plus exactement l’usage qui est fait des connaissances scientifiques et technologiques disponibles dès lors que ce sont elles qui déterminent l’horizon décisionnel des entreprises. La création de technologie n’est pas une condition préalable du processus d’innovation. Elle en est le résultat, un résultat commandé par les conditions organisationnelles et institutionnelles qui structurent ce processus.
Les processus de production
Contrairement à l’image qui en est généralement donnée, la production n’est pas réductible à une relation technique entre des quantités données de facteurs et de produits. Elle doit être vue comme un processus qui prend du temps et mobilise des ressources utilisées à des moments différents, en quantités différentes et pendant des durées différentes. Les unes sont ce que l’on appelle des consommations intermédiaires (énergie, matériaux) et sont absorbées (détruites) dans chaque processus élémentaire de production (la production d’une unité de bien particulier). Les autres sont utilisées et rendent les mêmes services dans plusieurs processus de production successifs : ce sont les équipements et les ressources humaines. De ce fait, l’efficacité de la production n’est pas d’ordre uniquement technique. Elle dépend du mode d’organisation choisi (Georgescu-Roegen, 1971, p. 211-275).
Avec une organisation artisanale signifiant qu’un processus de production élémentaire n’est engagé qu’une fois le précédent achevé, les équipements ou les ressources humaines spécifiques de l’une ou l’autre étape de ce processus ne sont utilisés qu’une faible fraction du temps. Le faible taux d’utilisation (ou le fort taux d’oisiveté) de ces facteurs de production, que Georgescu-Roegen (1971) désigne comme des fonds de services, est source d’inefficacité. Il constitue un problème économique majeur en compromettant jusqu’à l’opportunité de leur usage. Ce problème est, en grande partie, résolu avec la mise en place d’une organisation industrielle de la production signifiant que la même machine et le même travailleur, une fois achevée la tâche qui leur est assignée pour un processus élémentaire donné, la répliquent immédiatement dans le processus de production élémentaire suivant. À la dimension diachronique de la production vient se superposer une dimension synchronique : tous les stades d’une production donnée, quoique relevant de lignes différentes, sont réalisés simultanément une fois l’organisation industrielle constituée. Il en résulte l’obtention de gains substantiels de productivité liés à l’organisation avant de l’être à la technologie, du fait de l’augmentation substantielle du taux d’utilisation des facteurs de fonds.
Il y a à cela une contrepartie : le volume de production réalisé augmente fortement. Il y a à cela une condition, dont rien ne permet de dire qu’elle est automatiquement remplie : la demande doit être suffisamment large. D’un point de vue global, il peut s’agir aussi bien d’une demande basée sur la conquête de marchés à l’exportation que d’une demande interne alimentée par des salaires indicés sur les gains de productivité. Un contenu analytique précis est ainsi donné à la proposition de Smith (1776) suivant laquelle la division du travail interagit avec l’extension des marchés.
Le mode d’organisation de type industriel assure, certes, une efficacité maximale dans l’usage des ressources existantes en permettant de s’abstraire concrètement de la durée des processus de production, autrement dit de la contrainte de temps, mais il crée aussi les incitations à faire usage de ces facteurs que sont les fonds de service et suscite, en permanence, la recherche de nouvelles opportunités technologiques et de marché, en clair des innovations qui remettent systématiquement en cause l’état de choses existant, faisant resurgir la contrainte de temps.
Dans les faits, en dehors des régimes réguliers qui constituent des solutions imaginaires, les coûts sont dissociés des revenus, leurs profils temporels ne sont jamais définitivement synchronisés. Les distorsions qui en résultent se répercutent au cours du temps de telle sorte qu’aucune grandeur économique n’est indépendante de la façon dont s’articulent division du travail et extension des marchés étape après étape.
La raison en est que, fondamentalement, les marchandises ne sont pas produites par des marchandises. Elles le sont par des processus. Aucune adaptation instantanée, qui procéderait d’une substitution de facteurs, n’est ici possible dans la mesure où nombre de fonds de services (équipements ou ressources humaines) sont spécifiques des processus de production dans lesquels ils sont engagés et doivent être construits avant de pouvoir être utilisés. Si substitution il y a, c’est entre processus. Cette substitution prend du temps, exige de disposer en temps voulu des moyens pour la mettre en œuvre, en l’occurrence de moyens financiers et humains.
Ainsi, la relation, qui structure fondamentalement le développement de l’économie comme celui de l’entreprise, désigne non pas une technologie préconçue, mais une capacité de production composée d’une population de processus de production, appartenant à différentes technologies, de différents âges (des usines pourrait-on dire), les uns en cours de construction, les autres en cours d’utilisation, population dont la démographie change au cours du temps sous l’effet des ruptures successives initiées par les entreprises (Hicks, 1973). Une structure par âges de la capacité de production (une démographie) équilibrée, impliquant qu’il y ait cohérence entre construction et utilisation de capacité, entre dépenses d’investissement et dépenses de consommation, est la condition nécessaire d’une croissance régulière. Or la nouveauté (l’innovation) est génératrice de ruptures de l’équilibre de cette structure temporelle de la capacité productive dont les déformations se propagent d’elles-mêmes. De nouveaux processus de production doivent se substituer aux anciens. Ils doivent être construits avant de pouvoir être utilisés. Alors que, dans un modèle canonique de croissance à la Solow, dès que le taux d’épargne augmente, le niveau du produit brut augmente (et par suite le niveau de la productivité du travail), ce tour de force est impossible dans les conditions normales du changement technologique. Un accroissement du produit et de la productivité requiert que des processus additionnels soient créés préalablement. Il n’interviendra qu’avec le temps, s’il intervient.
Les ressources que l’on qualifiera de productives, celles qui sont affectées à construire et à utiliser des processus de production, sont déterminantes du niveau d’activité : elles sont constitutives du capital tel qu’il était défini par les économistes classiques et tel qu’il est toujours reconnu par les hommes d’affaires. Le volume d’emploi ainsi engendré est, éventuellement, insuffisant pour absorber le produit courant, cette surproduction pouvant conduire à réduire, au cours de la période suivante, le taux d’investissement et de nouveau l’emploi. Une instabilité s’installe du type de celle implicitement considérée par Keynes. Il peut aussi arriver que l’existence de capacités inutilisées dans de telles circonstances permette, ultérieurement, à l’économie de fonctionner au-dessus de son potentiel dès lors qu’une nouvelle demande est formulée. Ce sont là les épisodes de fluctuations essentiellement endogènes de l’activité.
La nature des fluctuations
Les fluctuations ou les cycles ont été l’objet de très nombreuses analyses censées en identifier les causes. La controverse, au tournant du XXe siècle, a porté sur la question de savoir si les causes des cycles étaient réelles ou monétaires, les uns incriminant la suraccumulation du capital physique, les autres dénonçant l’injection excessive de crédit bancaire. Sans doute, les analyses les plus pertinentes sont celles établies par Wicksell et Hayek, qui mettent l’accent sur les déformations de la structure productive induites par un écart entre le taux d’intérêt naturel et le taux monétaire, en l’occurrence un excès ou un déficit de la production de biens de production en regard de celle des biens de consommation.
La première synthèse néoclassique s’est éloignée de ce type d’approche en insistant sur l’existence d’un sentier de croissance régulière répondant aux seules forces de l’offre et en faisant des fluctuations un phénomène de courte période impulsé par les forces de la demande. La nouvelle synthèse, quant à elle, met en avant la déformation des fonctions d’utilité intertemporelle en faisant des cycles une réponse immédiate et optimale des consommateurs aux chocs réels de productivité ou à des chocs nominaux interprétés à tort comme des chocs réels.
Les choses deviennent plus complexes quand il est fait état du processus schumpétérien de destruction créatrice, autrement dit d’innovations impliquant de détruire des équipements et des emplois pour en créer de nouveaux, ce qui, en principe, exige du temps. Il est pourtant une façon d’en détourner le sens. Il suffit de n’en considérer que le résultat et de ne s’interroger que sur la taille effective ou présumée optimale des flux de destruction et de création d’activités ou d’emplois. L’intensité de ces flux seule compte et constitue une donnée technologique et institutionnelle qui caractérise le profil de long terme de l’économie. En particulier, les innovations peuvent se traduire par une hausse du taux de croissance potentiel et du taux de chômage d’équilibre, lequel ne fait que traduire l’augmentation simultanée du nombre de chômeurs en recherche d’emploi et de postes vacants, sachant que les durées de chômage et de vacance de poste restent courtes et n’ont aucune influence sur la trajectoire de long terme.
Ce dont il va être question est bien différent. Il s’agit de l’articulation au cours du temps de la construction et de l’utilisation de processus de production variés en termes de caractéristiques techniques, de cibles de marché, de dates de mise en œuvre, impliquant de mettre l’accent dans l’analyse sur la durée des différents phénomènes. De cette façon est réintroduite dans l’analyse la déformation de la structure productive : en l’occurrence la déformation de sa structure temporelle bien davantage que celle de sa dimension sectorielle, par définition atemporelle.
Cette déformation est au cœur de l’analyse que Hicks (1973) propose de la période de transition ouverte par le choix d’innover et qui montre que le profil de l’activité et de l’emploi procède de l’évolution du ratio entre construction et utilisation de la capacité productive, soit entre investissement et consommation. Dans tout régime régulier de croissance, ce ratio est, par définition, constant : il est déterminé par la technologie et par le taux de croissance exogène de l’offre de travail. Hors de ce régime, ce ratio varie d’une période à l’autre sous l’effet de chocs successifs et des contraintes suscitées en chemin, comme cela est naturel dans une économie soumise de manière récurrente à des innovations de différentes natures dont Schumpeter (1934) nous rappelle qu’elles ont en commun de rompre avec les équilibres existants.
L’introduction d’une nouvelle technologie dans une économie d’échange réel (sans monnaie et assimilée à un troc parfait) en fournit un bon exemple (Hicks, 1973). Imaginons que la nouvelle technologie, quoique supérieure à l’ancienne en termes de productivité en régime permanent, implique une hausse des coûts de construction plus que compensée par la baisse des coûts d’utilisation. Au cours d’une première étape, appelée phase initiale de la transition, le même montant de ressources héritées du passé étant disponible, l’investissement en capacité (le nombre d’usines), divorcé de l’investissement en coût, diminue. Il s’ensuit une distorsion de la structure par âges de la capacité, entre construction et utilisation, entre investissement et consommation, avec pour conséquence, au terme de la période initiale, à taux de salaire fixe, une réduction du produit brut et de l’emploi qui répond à la baisse temporaire de la capacité de production en phase d’utilisation. Cette distorsion engendre ce que Ricardo (1821) appelait l’effet-machine, en fait un chômage attribuable non aux propriétés de la nouvelle technologie, mais aux conditions économiques de la transition, plus précisément au montant des ressources disponibles ici déterminé, à chaque période, par le produit des ventes effectuées au cours de la période précédente. Si l’hypothèse opposée de salaires flexibles est retenue, permettant à l’économie de rester en plein-emploi, la diminution de l’investissement en capacité demeure, le produit brut diminue quand les premiers processus de la nouvelle capacité parviennent en phase d’utilisation, mais le plein-emploi est conservé au prix d’une baisse du taux de salaire, et la productivité du travail diminue. La productivité dont il est question n’est pas la productivité de la technique seulement mesurable en régime régulier de croissance. Elle rend compte, également, des distorsions intervenues dans la structure par âges de la capacité de production. Sa chute n’a rien de paradoxal. Elle témoigne, comme l’effet-machine dans le cas polaire, des difficultés de la transition, du temps nécessaire pour les vaincre, sans qu’il soit nécessaire de faire état de défauts de coordination entre l’offre et la demande sur le marché des biens, sans mention non plus d’éventuels effets sur le choix de technique des variations du taux de salaire. Le chômage sera réabsorbé, et la productivité du travail n’au...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- INTRODUCTION – Le temps, défi théorique et politique
- PREMIÈRE PARTIE - Les déconvenues d'une économie hors du temps
- DEUXIÈME PARTIE - Instabilité et résilience d'une économie dans le temps
- TROISIÈME PARTIE - La politique économique à l'épreuve du temps
- CONCLUSION - L'enjeu philosophique et politique
- APPENDICE – Équilibre, séquence et temps dans l'histoire de la pensée économique
- Bibliographie
- Table
- Des mêmes auteurs