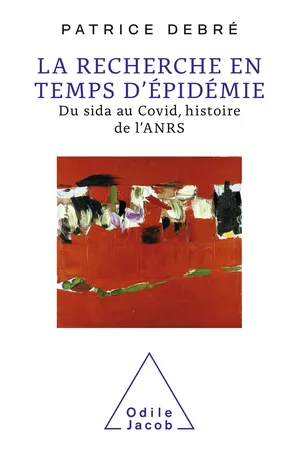
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Lorsque l'épidémie de sida frappe, au début des années 1980, il s'agit d'une maladie dont les mécanismes sont méconnus. Un groupe de chercheurs reçoit la mission de fédérer les acteurs de la recherche dans la lutte et le développement des premiers traitements. Seize ans plus tard, la trithérapie montrait son efficacité. Cette aventure, celle de l'Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS), Patrice Debré en témoigne ici, offrant un aperçu de ce qu'est, au jour le jour, la recherche en temps d'épidémie. Cette aventure, c'est aussi celle d'un changement de paradigme : pour la première fois, les malades et les associations militantes ont travaillé main dans la main avec les chercheurs. Grâce à eux, les perspectives de la lutte contre les épidémies ont été radicalement rénovées. C'est aux chercheurs, aux victimes, à tous les citoyens impliqués dans ces luttes, que ce livre rend hommage. Connaître leur combat, c'est se préparer aux fléaux futurs. Patrice Debré est professeur d'immunologie émérite à Sorbonne Université. Ancien directeur d'un service hospitalier à la Pitié-Salpêtrière et d'un institut de recherche, il a été ambassadeur chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles. Il est membre titulaire de l'Académie nationale de médecine.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informations
PREMIÈRE PARTIE
La recherche sur le sida
CHAPITRE 1
Traiter
Trente ans après les premières études françaises qui testaient de possibles médicaments contre le VIH, un après-midi d’automne 2019, je retrouvai Jean Dormont pour évoquer ses souvenirs d’alors. Ces temps paraissaient loin et proches. Professeur de médecine, infectiologue réputé, il avait été nommé en mars 1987 par le directeur général de l’Inserm, Philippe Lazar, coordinateur des essais thérapeutiques de l’ANRS.
« Regardez cette lettre, me dit-il en montrant le document qui annonçait ses nouvelles fonctions. Elle est très particulière car le directeur général s’adresse aux responsables des services cliniques concernés par la lutte contre le sida. Dans le système cloisonné de nos administrations, il est assez inhabituel que le directeur d’un établissement de recherche comme l’Inserm nomme une personnalité dans des fonctions qui engagent les hôpitaux même si, comme l’écriture le précisait, il “n’entrait nullement dans les vues de l’Inserm de se substituer en quoi que ce soit au déroulement normal des procédures habituelles de libre choix, par les équipes concernées, de leurs thèmes de travail et de leurs partenaires, publics et privés”. »
Pour qui connaît les subtilités de langage administratif, le geste avait son importance. L’Inserm voulait jouer un rôle de « coordination et de fédération des efforts entrepris ici et là pour gagner de vitesse le développement de cette pathologie » et – sous-entendu – gagner aussi de vitesse les tentatives françaises concurrentes. Afin de tester l’efficacité de médicaments capables de lutter contre le virus, rien de sérieux n’avait été tenté en France jusqu’alors ! L’initiative était judicieuse.
« Peu après, nous raconte Jean Dormont, je me suis rendu aux États-Unis pour observer les interventions effectuées par les Américains. Bien sûr, je connaissais leur potentiel, mais étais loin de m’imaginer ce qu’ils avaient déjà mis en place : une énorme organisation pour étudier de possibles molécules actives avait été établie au cœur des National Institutes of Health de Bethesda, dans le Maryland. Avec un état-major d’une vingtaine de personnes, ils avaient déjà piloté plus de cent essais, inclus 14 000 malades sur 50 sites répartis dans tout le pays pour tester tous les produits candidats. En m’apercevant de notre retard, j’avais beau me rassurer en constatant que beaucoup de ces essais étaient de petite taille, la leçon était cinglante ! À mon retour, ou presque, nous avons réuni la communauté scientifique et médicale française dans un grand amphithéâtre de l’hôpital de Bicêtre pour prendre le pouls de ceux qui souhaitaient s’engager en recherche thérapeutique. Ce jour-là, l’amphi était plein à craquer. On nous attendait. Nous avons commencé par un long plaidoyer pour raconter nos efforts et particulièrement ces études de cohortes, qui se contentaient de colliger le suivi des patients. Nous en étions assez fiers. Mais je me souviens d’avoir été bien vite interrompu. “Comment peut-on imaginer que la recherche française se contente d’observer des malades, sans comparer le moindre traitement !” entendait-on dans la salle. Les critiques pleuvaient. Les immunologistes étaient parmi les plus virulents. Nous étions déjà en 1988, il devenait évident qu’il fallait agir. Il était plus que temps d’étudier l’effet des quelques molécules dont on entendait parler. »
C’est l’histoire qui allait parler, notamment celle des milliers de patients, et aussi de leurs médecins, qui allaient participer à ces essais thérapeutiques.
ANRS, année zéro
« L’ANRS fera des essais thérapeutiques l’une de ses priorités. » Ainsi s’exprimait en 1990 son directeur en commentant les premiers mois de la jeune agence et plantant les décors de ceux à venir. Il ne fut jamais démenti. Jusqu’à ce jour encore, cet aspect de la recherche clinique en reste le principal fleuron. A fortiori quand il était clair dans ces premières années qu’on ne pouvait rester les bras ballants à attendre l’inexorable chute des CD4, faute d’un médicament capable de l’enrayer. S’il était bien une mission qui justifiait la création de cette nouvelle entité, c’était de répondre à ce besoin vital, comme l’indiquait le ministre de la Recherche en assignant à Jean-Paul Lévy ce qu’il attendait de lui. On estimait alors à 150 000 le nombre de séropositifs et la survenue annuelle de 5 000 à 7 000 cas de sida.
L’épidémie bouleversait la société française. L’affaire du sang contaminé avait donné un éclairage nouveau sur les nécessités de la prévention et les missions de l’autre agence de lutte contre le sida, l’AFLS. L’ANRS devait agir et, avant tout, initier la recherche de nouveaux traitements. Certes quelques molécules, dont il fallait d’ailleurs guider les indications, pouvaient être proposées pour traiter ou prévenir les infections des germes opportunistes que favorisait le déficit immunitaire, mais c’était avant tout le VIH qu’il fallait combattre, à défaut de pouvoir l’éradiquer comme on le pensait possible alors. Or, contre le VIH, dont on avait appris qu’il était bien responsable de l’immunodépression, il n’y avait rien ou presque sinon quelques substances tout juste bonnes à désinfecter les paillasses de laboratoires de microbiologie. On donnait quelques conseils de prévention, mais aucun ne pouvait servir à traiter les patients. La tâche était immense, les médias et les militants d’Act Up-Paris dénonçaient le manque de réactivité du monde de la recherche. Les biologistes au cœur du dispositif hospitalier n’étaient pas éduqués pour la découverte de nouveaux produits, même s’ils possédaient les technologies pour les tester.
Quant aux cliniciens, pour ceux qui étaient entraînés à monter des essais, ils ne pouvaient agir que s’ils disposaient de molécules à étudier. On se tourna alors vers l’industrie pharmaceutique, cherchant à tester ce qu’elle possédait dans son escarcelle, et vers les banques de molécules de synthèse chimique ou extraits naturels dont elle disposait et dont il fallait montrer un éventuel effet contre le virus.
Faute de produits disponibles, il avait bien fallu se contenter d’abord de suivre des cohortes de patients, celles d’enfants en 1986, puis d’adultes en 1987, avant que ne puissent débuter les premiers essais en France en 1989. Ceux-ci avaient cependant commencé à l’étranger, notamment aux États-Unis, qui avaient lancé deux ans plus tôt cet ambitieux programme d’essais thérapeutiques dont parlait Jean Dormont : l’ACTG pour AIDS Clinical Trials Group, soutenu par la division des maladies infectieuses des NIH, le NIAD.
« Il était clair que les Américains n’avaient pas besoin de nous, avait-il ajouté. D’emblée, pourtant, il semblait préférable que les essais soient montés à l’échelle internationale. Ne valait-il pas mieux lutter ensemble que d’en faire l’enjeu de compétitions farouches ? L’Europe avait à s’affirmer et les Britanniques, qui en faisaient alors partie, furent approchés dans le cadre des contacts qui s’étaient effectués depuis 1987 avec le Medical Research Council auquel, sur leur demande, s’associa le laboratoire britannique Wellcome. »
De quoi discutait-on alors, sinon de la seule molécule dont on pouvait disposer pour des études chez l’homme, la zidovudine ou AZT ? Ce produit semblait prometteur, du moins d’après les premières données des essais américains sur les courbes d’évolution des lymphocytes. Ce médicament est un analogue de la thymidine, connu depuis 1964 pour ses potentialités anticancéreuses. Il avait été découvert par un chercheur américain, Jerome Horwitz, dans le cadre d’un grand programme fédéral soutenu par le gouvernement des États-Unis. Il avait cependant été mis de côté, car l’effet sur les tumeurs avait été jugé modeste, et surtout le produit semblait présenter des effets secondaires inacceptables. Mais cela n’avait pas empêché en 1974 un scientifique allemand de l’Institut Max-Planck de tester son effet sur des rétrovirus murins et d’en montrer une certaine efficacité. Ces résultats étaient totalement passés inaperçus, inexploités, et de plus restés inexpliqués, jusqu’à certains jours de janvier 1985 où trois chercheurs du NCI (National Cancer Institute) en collaboration avec d’autres scientifiques de Burroughs Wellcome (antérieurement GlaxoSmithKline) testèrent à nouveau ce médicament, cette fois contre le VIH. Leur découverte jeta un nouvel éclairage sur les perspectives offertes à cette drogue de placard.
L’AZT inhibait in vitro la rétrotranscriptase, qui, comme nous l’avons vu, était l’enzyme clé du VIH, impliquée dans son intégration cellulaire. Devant l’urgence et la pénurie de candidats thérapeutiques, les barrières réglementaires américaines furent franchies rapidement et l’on s’empara de l’AZT pour monter un des premiers essais du genre. Les résultats pionniers chez l’homme avaient pu montrer que le produit induisait une augmentation des lymphocytes CD4 chez les patients infectés. Poursuivi à plus large échelle sur six mois chez des malades en phase terminale du sida, un essai ultérieur confirmait la tendance, mais, mieux, semblait prolonger l’espérance de vie, doublant l’appréciation biologique sur son efficacité par des arguments bien plus convaincant pour des cliniciens. Il n’y eut pas qu’eux à être convaincus. L’industriel s’était empressé de déposer un brevet d’exploitation en 1984, et l’agence fédérale américaine du médicament, la FDA, d’approuver l’utilisation clinique dès 1987. Mais la dose alors proposée, en six prises, élevée et contraignante, suscitait des critiques. Surtout, le maniement de ce médicament restait à trouver : à quel stade de la maladie fallait-il l’utiliser ? Devait-on attendre une chute importante des lymphocytes comme les Américains semblaient le proposer ? D’ailleurs que voulait dire « importante » pour des scientifiques qui raisonnent en nombre de globules et recherchent plus l’objectivité qu’un adjectif qualitatif ? C’est sur ces questions que s’arrêtèrent les stratèges français et leurs collègues anglais. Elles avaient leur opportunité et permettaient également d’entrer dans la cour des grands, de ceux qui testaient l’effet des médicaments, limités alors à un face-à-face (dont on verra d’autres exemples) entre les chercheurs américains et leur industrie.
Concorde et la méthodologie des essais
Premier essai français d’efficacité thérapeutique, Concorde était le deuxième de la jeune agence, précédé d’une étude plus modeste en taille sur la pharmacocinétique et biodisponibilité de l’AZT. Il s’agissait là de savoir à quel stade d’évolution de la maladie les personnes infectées par le VIH devaient débuter leur traitement avec ce médicament.
L’utilisation d’un nouveau produit thérapeutique chez l’homme, depuis sa conception au laboratoire, qu’il soit industriel ou public, jusqu’à sa mise sur le marché, passe par une série d’étapes pour confirmer son effet médical et valider sa tolérance. Les molécules issues de la recherche, dont l’activité et l’absence de toxicité sont d’abord testées in vitro en culture cellulaire et sur des modèles animaux, doivent franchir les différentes phases d’étude chez l’homme. On nomme protocole le dessin de ces essais, phase I leur tolérance (doses, modes d’administration, etc.). Les phases II et III en testent l’efficacité chez des groupes de plus en plus importants de malades jusqu’à la phase IV qui étudie son introduction dans les communautés de patients. C’est bien ainsi, chez les malades, qu’il faut recueillir les données aussi bien cliniques que biologiques ou autres. Or il faut s’assurer de leur adhésion.
Les patients ne peuvent ainsi être inclus qu’après une information précise des recherches poursuivies et un recueil de leur consentement. Ces modalités réglementaires ne sont pas propres au VIH et ne sont pas nouvelles, mais la loi qui les encadre du nom des sénateurs Huriet et Serusclat n’est pas très ancienne puisqu’elle date de 1988, l’année du démarrage de l’essai Concorde. L’histoire avait un temps bégayé car si la notion qu’on ne peut expérimenter chez l’homme sans son accord remonte à 1945 et au procès des médecins de Nuremberg, il fallut une série d’incidents et d’inculpations pour qu’on note les dérives que la recherche avait fait courir à la dignité humaine. Qui ne se souvient ainsi des expériences menées aux États-Unis jusqu’aux années 1970 sur les Noirs américains qu’on observait, sans les traiter et sans les informer des médicaments possibles, pour étudier les effets de la syphilis, ne les indemnisant que le jour de leur enterrement ?
Un essai thérapeutique encadré ainsi par le règlement juridique repose sur l’autonomie de la personne, mais aussi sur un principe de précaution. Le patient doit connaître les objectifs des recherches, les avantages attendus et risques des médicaments testés, sachant que les règles éthiques ne rendent plus obligatoire un possible bénéfice thérapeutique. Pour le VIH, comme pour d’autres pathologies, mais plus particulièrement lors de cette infection, au fur et à mesure du déroulement des essais, il devint important de mieux connaître la sociologie et les motivations des patients qui acceptaient d’y participer. Ce devint un sujet de recherche en soi, mais aussi une aide pour le dessin et la mise en place de telles études, de sorte que des chercheurs spécialisés en sciences humaines et sociales participèrent activement aux délibérations conduisant aux essais. Progressivement, il devint important de recueillir également l’avis des patients et de leurs associations pour concevoir les protocoles thérapeutiques. La rencontre des médecins et de la société civile, dont on reverra les fondements et les influences croisées par ailleurs, fut un fait majeur, déterminant sur le fond et la forme des essais, et plus largement encore sur la médecine et recherche médicale. Les militants des associations de malades allaient ainsi intervenir aussi bien sur l’urgence que les modalités du traitement.
Tester un nouveau médicament, en l’occurrence contre le VIH, dépend des questions posées. S’il s’agit d’évaluer un effet clinique, celui-ci dépend du stade où le traitement est proposé. Utilisé en phase de sida, état avancé de la maladie, il lui sera plus difficile d’être efficace. Plus précocement, avant l’apparition des symptômes cliniques, l’effet possible nécessite une observation plus longue. D’un autre côté la biologie peut aider à mesurer l’efficacité, même si pour des cliniciens l’effet clinique doit primer. La mesure de la quantité de virus, facilitée par l’introduction de la technique appelée amplification en chaîne par polymérase (PCR), apparaît à l’évidence la méthode de choix, mais ne fut mise en place qu’au début des années 1990, et ne pouvait être appliquée à Concorde. Quant au taux de lymphocytes CD4, il est certes adéquat pour évaluer l’état du déficit immunitaire, mais ne mesure que la conséquence indirecte de l’activité thérapeutique sur le virus.
L’essai Concorde fut confronté d’emblée à ces problèmes car le protocole avait pour but de tester l’efficacité précoce de l’AZT dans le but de retarder la progression de la maladie. L’inclusion s’adressait ainsi à des sujets sans manifestations cliniques qui avaient une séropositivité connue depuis au moins trois ans. Afin d’apprécier scientifiquement un possible effet de ce traitement, encore fallait-il comparer ces résultats à ceux obtenus par administration d’un placebo.
« Ce fut un des premiers points de discussion avec les Anglais, se rappelle Jean Dormont. Il ne semblait pas éthique de laisser ses patients sous placebo si la situation s’aggravait. Mais que voulait dire aggravation ? Maxime Seligmann, en brillant immunologiste et investigateur principal, penchait pour la biologie et voulait imposer un chiffre de CD4 pour proposer l’AZT aux patients sous placebo dont la situation se détériorait. Les Anglais refusaient. La situation s’éternisait. Nous nous réunissions dans les aéroports de Heathrow ou Roissy, mais n’arrivions pas à prendre une décision. Seligmann parlait d’une limite de 200 CD4. Je lui dis alors :
– Mais comment as-tu la preuve qu’il faut appliquer ce chiffre plutôt qu’un autre ?
– Je n’en ai pas, répondit-il.
Comme il persistait, je le pris à part :
– C’est la clinique qui va trancher. Il faut qu’il en soit ainsi.
Les Anglais approuvèrent et il dut s’y résoudre. »
Mais le rôle de Maxime Seligmann n’était pas fini, loin de là. D’ailleurs il animait remarquablement un des axes prioritaires de l’agence, celui de la recherche clinique.
C’est ainsi que les malades furent répartis en deux groupes : le groupe « immédiat » dans lequel les patients reçurent d’emblée l’AZT et le groupe « différé » où l’on donna le placebo jusqu’à l’apparition des premiers symptômes de la maladie, légitimant alors la prise d’AZT. Parce qu’il s’agissait avant tout de critères cliniques, l’essai allait inclure un grand nombre de patients : 1 749 personnes infectées par le VIH y participèrent. Il débuta en France en janvier 1989 dans 35 centres. Les Anglais avaient commencé les inclusions dès novembre 1988. Un conseil scientifique, un comité de coordination furent mis en place, ainsi qu’un comité de surveillance qui, disposant des résultats, se réunissait régulièrement pour juger du bon déroulement de l’étude. Les cliniciens ignoraient le traitement qu’ils donnaient au patient. Les malades également.
Dans chacun des deux pays, les données étaient recueillies de manière rigoureuse et transmises par Minitel, une invention française qui avait son heure de gloire car Internet n’existait pas encore. Mais l’Europe n’était pas seule à se préoccuper de l’utilisation de l’AZT. En poursuivant leurs études préliminaires, les Américains allaient jeter un pavé dans la mare. Ils annoncèrent à grand fracas qu’ils interrompaient l’essai d’administration d’AZT contre placebo qu’ils poursuivaient indépendamment de leur côté : la drogue ayant fait définitivement la preuve de son efficacité chez les patients ayant moins de 500 CD4, l’utilisation du placebo n’était dès lors plus licite.
Cette annonce mit les investigateurs franco-britanniques dans l’embarras. Que fallait-il faire ? Arrêter toute investigation, c’était se plier aux résultats américains ; poursuivre, c’était risquer de donner un placebo à des patients qui auraient pu bénéficier de l’AZT.
Finalement ce fut le comité de surveillance qui trancha et suggéra la poursuite de l’essai. Il était licite de tester l’effet à long terme de l’AZT. Le protocole permettrait de voir si le traitement par AZT retardait l’évolution clinique vers le sida, son effet sur la qualité de vie et sur la survie, et puis aussi, préoccupation des virologues, si l’on induisait une résistance de certains isolats viraux à ce médicament. Restait aussi à examiner la possible toxicité. Bref, i...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Prologue
- Introduction
- Première partie - La recherche sur le sida
- Seconde partie - Un modèle de politiques publiques
- Conclusion
- Bibliographie
- Index chronologique
- Glossaire terminologique et des acronymes
- Remerciements
- Du même auteur
- Pour en savoir plus
- Table
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrir comment résilier votre abonnement
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Apprendre à télécharger des livres hors ligne
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 990 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! En savoir plus sur notre mission
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. En savoir plus sur la fonctionnalité Écouter
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application
Oui, vous pouvez accéder à La Recherche en temps d'épidémie par Patrice Debré en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Médecine et Maladies infectieuses. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.