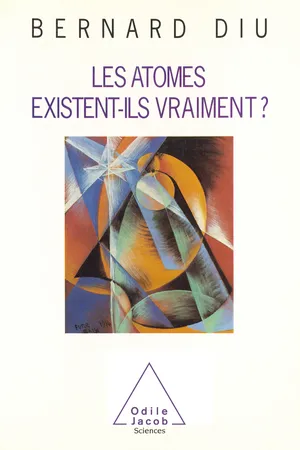
- 324 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Les atomes existent-ils vraiment ?
À propos de ce livre
Que l'on se rassure : les atomes existent bel et bien. Pourtant, quelque puriste pointilleux pourrait s'interroger sur la signification de cette expression : que doit-on entendre par « existence réelle » s'agissant d'objets dont la taille se mesure en cent-millionièmes de centimètre et dont le comportement obéit à des lois (celles de la mécanique quantique) si fondamentalement distinctes de celles que nous avaient enseignées plusieurs siècles de physique dite « classique » depuis Galilée et Newton ? D'ailleurs, la réalité des atomes et des molécules a donné lieu, au tournant du siècle (vers 1900), principalement autour des phénomènes et concepts qui font l'objet de cet ouvrage, à une controverse parfois féroce. Ainsi, Paul Pascal qui avait été un chimiste hors pair racontait pourtant que, alors jeune étudiant et candidat en 1905 au certificat de chimie générale à la Sorbonne, il fut collé par un professeur qui niait l'existence des atomes et n'admettait pas qu'on l'envisageât. Pire encore : le viennois Ludwig Bolztmann, génial promoteur de la mécanique statistique fut poussé au suicide en 1906 par les sarcasmes de ses détracteurs. Or quelques mois plus tard cette même année, un français, Jean Perrin démontrait par une série d'expériences irréfutables la présence des atomes et la validité de la mécanique statistique. Peut-être faut-il quand même être juste et reconnaître que les anti-atomistes, pour se montrer si intraitables et percutants, disposaient eux aussi d'une théorie physique remarquable par sa cohérence et son efficacité - la thermodynamique, dont Bernard Diu parle abondamment, et qui n'avait apparemment que faire des atomes. Après avoir clarifié en tout premier ce qu'est une théorie physique, ce qu'est la physique et ce qu'elle n'est pas, Bernard Diu nous explique très simplement les intrications et les éventuelles oppositions entre la thermodynamique et la mécanique statistique. Bernard Diu, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, est professeur à l'Université Paris VII.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Les atomes existent-ils vraiment ? par Bernard Diu en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences physiques et Physique atomique et moléculaire. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
DEUXIÈME PARTIE
LA THERMODYNAMIQUE :
UNE SCIENCE EN PLEINE MATURITÉ
CHAPITRE PREMIER
Chaleur et travail : balbutiements
Le meunier qui l’habite est un joli blondin :
Il a la barbe rousse et les cheveux châtains.
(Chanson populaire.)
Une fourmi de dix-huit mètres
avec un chapeau sur la tête,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Une fourmi traînant un char
plein de pingouins et de canards,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Une fourmi parlant français,
parlant latin et javanais,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Eh ! Pourquoi pas ?
Robert DESNOS,
Chantefables et Chantefleurs.
Naissance de la thermodynamique
Au début de notre histoire était Denis Papin (1647-1712) : nous avons appris sur les bancs de l’école comment son attention (scientifique) avait été attirée par le comportement du couvercle de sa bouilloire, soulevé spasmodiquement mais irrésistiblement par la vapeur que produisait l’ébullition de l’eau et qui se frayait ainsi un passage vers l’extérieur. Il est difficile d’avérer cette anecdote, de même nature que celle de la pomme de Newton. Bouilloire ou pas, Denis Papin publia en 1687 un mémoire intitulé Description et usage de la nouvelle machine à élever l’eau, que l’on s’accorde à considérer comme la première proposition visant à réaliser une machine à vapeur (où était déjà utilisé le va-et-vient d’un piston dans un cylindre). Songeons que, dans les conditions habituelles de notre environnement, le volume occupé par une goutte d’eau liquide augmente mille sept cents fois lorsqu’elle se vaporise ! Cette différence colossale donne lieu à une force d’expansion qui peut pousser des pistons (ou des couvercles de marmite), et permettre ainsi de soulever des poids, ou d’effectuer plus généralement ce que l’on nomme du travail mécanique (celui qui met en mouvement des bateaux ou des trains, par exemple). Mais il faut, pour obtenir un tel travail, chauffer l’eau liquide afin qu’elle se vaporise : il faut lui fournir de la chaleur. Donc un moteur thermique absorbe de la chaleur et restitue du travail.
La machine à vapeur s’introduisit dans l’industrie vers les années 1710. Il fallut cependant attendre un siècle pour qu’elle s’y impose : le premier service régulier de bateaux à vapeur est inauguré en 1807 aux États-Unis ; c’est au cours de la même période que la locomotive à vapeur est développée, tant en Angleterre qu’en France, avec ce record spectaculaire des 56 kilomètres à l’heure atteints en 1829 par « The Rocket » (« La Fusée »), œuvre de l’ingénieur anglais George Stephenson.
La thermodynamique, dont le nom associe les deux mots grecs thermon et dynamis (chaleur et puissance), est alors née du désir – et de la nécessité technique – d’analyser ce que Sadi Carnot appela, en 1824, la « puissance motrice du feu » : il s’agissait de rechercher les conditions optimales dans lesquelles la chaleur fournie par une chaudière peut être transformée en travail mécanique par une machine thermique. Il est assez remarquable, du point de vue épistémologique, que ces préoccupations principalement techniques, voire utilitaires, aient donné naissance à une théorie physique subtile, extrêmement élaborée, fondée sur des concepts particulièrement abstraits (restés longtemps mystérieux) tels que l’énergie et l’entropie.
La thermodynamique est maintenant la science des propriétés et processus qui mettent en jeu la température et la chaleur. Pour éviter de nous égarer dans les méandres qu’a forcément dessinés la découverte de la thermodynamique « sur le terrain », pour ainsi dire, nous n’essaierons pas de suivre son développement historique. Nous prendrons en quelque sorte le problème à l’envers, ce qui nous permettra en même temps de dégager la place, bien particulière, de la thermodynamique en tant que théorie physique dans le paysage scientifique actuel.
Le microscopique et le macroscopique
On sait depuis un siècle – on sait au sens que nous avons explicité à la fin du premier chapitre – que tous les objets sont constitués de molécules1 et d’atomes. On connaît aussi les lois d’interaction entre ces particules. Il convient de distinguer deux catégories de phénomènes, dont les ordres de grandeur sont sans commune mesure : d’une part, ceux qui concernent les objets à notre échelle ; d’autre part, ceux qui caractérisent les atomes et les molécules. On utilise une terminologie universellement admise et codifiée : ce qui est perçu à notre échelle est macroscopique, ce qui relève des atomes est microscopique2. On peut regretter qu’une seule petite voyelle, non accentuée en français, sépare ces deux termes, qui renvoient pourtant à des réalités extraordinairement différentes : le facteur multiplicatif caractérisant le passage du microscopique au macroscopique est le célèbre nombre d’Avogadro NA, qui vaut environ :
NA ≈ 6 x 1023,
c’est-à-dire le chiffre 6 suivi de 23 zéros ! Ce nombre – nous le préciserons au chapitre suivant – est celui des molécules que contient une certaine quantité macroscopique d’un corps pur quelconque : par exemple, c’est le nombre de molécules qui composent 18 grammes d’eau. Pour ce qui nous occupe ici, il suffira de savoir qu’un échantillon macroscopique d’un corps englobe un nombre fabuleux de molécules.
Précisons ce point, qui va s’avérer capital. Dans une pièce ordinaire d’un appartement ordinaire, chaque millimètre cube d’air renferme 3 x 1016 molécules (savoir, un nombre constitué du chiffre 3 suivi de 16 zéros). Imaginons que nous voulions repérer dans l’espace toutes ces molécules (trois coordonnées de position pour chacune d’elles) et préciser en même temps leurs vitesses (trois composantes pour chaque vecteur-vitesse), comme nous le demande la mécanique classique. En effet, l’état instantané d’un système mécanique (ici, le millimètre cube d’air) est caractérisé dans le cas le plus simple par la position et la vitesse de tous les points du système. Donc, pour déterminer l’état, à un instant donné, du système que constitue ce millimètre cube d’air, il faudrait connaître environ 2 x 1017 nombres. C’est totalement exclu : songez qu’un ordinateur qui écrirait quarante nombres par lignes et une ligne par centimètre devrait utiliser cinquante milliards de kilomètres de papier pour répertorier cet état instantané ! Comme élément de comparaison, sachez que la distance Soleil-Terre est de cent cinquante millions de kilomètres. Bien évidemment, le même travail serait à répéter à un instant ultérieur. Soyons justes, tout de même : il n’est pas question d’écrire in extenso les données dont nous parlons, mais de les emmagasiner dans les mémoires de l’ordinateur. Ceux dont on dispose actuellement sont capables de « suivre » le mouvement de systèmes comportant tout au plus un millier de particules ponctuelles. On est loin du 1017 de notre millimètre cube d’air !
Le dilemme fondamental
Si l’on connaît les lois de mouvement et d’interaction des molécules qui le constituent, les propriétés et l’évolution d’un corps macroscopique devraient pouvoir être entièrement décrites par la mécanique (fût-elle quantique, comme c’est le cas à l’échelle atomique et moléculaire). Mais la mécanique parle de forces et d’énergie – énergie cinétique associée au mouvement des molécules, énergie potentielle liée à leurs interactions –, de vitesses et d’accélérations. Comment les concepts de température et de chaleur peuvent-ils alors s’insérer dans un contexte aussi strict et rigoureusement fermé ?
Au XIXe siècle, quand la thermodynamique triomphait et l’atomisme faisait ses premiers pas, les tenants de cette dernière idée s’entendaient reprocher – au mieux ! – que « leurs » atomes étaient si ridiculement minuscules que personne ne parviendrait jamais à les mettre en évidence. Ces détracteurs de l’atomisme se trompai...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Du même auteur
- Copyright
- Remerciements
- Prologue
- Avertissement
- Première partie - Le livre de la nature ou la physique effleurée
- Deuxième partie - La thermodynamique : une science en pleine maturité
- Troisième partie - La mécanique statistique ou l’existence avérée des atomes
- Finale - Allegro ma non troppo
- Table