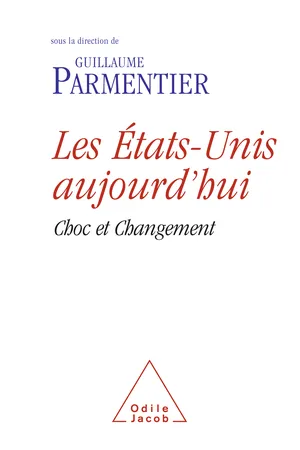
- 368 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
L'Amérique est-elle à un tournant de son histoire ? À cette question, depuis le 11 septembre 2001, les Américains répondent oui sans hésiter. Mais si tel est bien le cas, comment les États-Unis changent-ils ? Dix essais, écrits par des experts de tout premier ordre, pour la plupart américains et de sensibilités différentes, analysent en profondeur cette évolution, sur dix thèmes concrets, concernant aussi bien l'équilibre des pouvoirs ou les modes de régulation que la place des États-Unis dans le monde, qui divisent les élites dirigeantes américaines. Car l'Amérique est avant tout un lieu de pluralisme ! Pour mieux saisir la complexité et la diversité des États-Unis, trop souvent sous-estimées en Europe. Guillaume Parmentier dirige le Centre français sur les États-Unis (CFE) à l'Ifri, un centre de recherches indépendant ayant pour mission d'étudier et de faire comprendre les développements politiques, économiques et sociaux aux États-Unis. Contributions de Lionel Barber, Charles E. Cook, David S. Evans, David C. Gompert, Sylvie Kauffmann, Charles A. Kupchan, Thomas E. Mann, Vincent Michelot, Jeffrey Rosen, Gary J. Schmitt.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Les États-Unis aujourd'hui par Guillaume Parmentier en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politique et relations internationales et Gouvernement américain. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Chapitre 1
Les nouveaux visages de l’Amérique
Sylvie Kauffmann
Fidèle à sa réputation, la Californie a innové, une fois de plus. Le 7 octobre 2003 marquera sans doute, dans l’histoire électorale américaine, une étape nouvelle. Pas seulement parce qu’un référendum, organisé à coups de millions de dollars versés par un homme d’affaires local, a permis la révocation d’un gouverneur démocratiquement réélu à peine onze mois plus tôt. Pas seulement parce que, parmi les 135 candidats à sa succession, les électeurs californiens ont choisi un acteur de cinéma sans expérience politique, autrefois champion de body-building, immigré autrichien, républicain marié au clan Kennedy, Arnold Schwarzenegger. Mais aussi parce que, pour la première fois, dans cet État où depuis l’an 2000, les Blancs non-hispaniques ne sont plus majoritaires, l’électorat latino a été divisé.
La Californie abrite 11,9 millions d’Hispaniques1, qui constituent à peu près le tiers de sa population et la plus grosse communauté latino aux États-Unis. Il y avait bien un candidat latino, et il n’était pas mal placé : Cruz Bustamante, démocrate, l’adjoint du gouverneur sortant Gray Davis, Mexicain-Américain de la troisième génération. L’expérience des précédents scrutins pouvait aussi laisser penser que le vote latino favoriserait le gouverneur démocrate Gray Davis qui, in extremis, avait promulgué une loi le mois précédent autorisant les immigrés clandestins à passer leur permis de conduire : dans un pays où la carte d’identité n’existe pas, c’était leur ouvrir le sésame d’un début de légitimité – donner, en quelque sorte, des papiers aux sans-papiers. Arnold Schwarzenegger, lui, était opposé à cette mesure, et s’était engagé à tenter de la faire abroger – peut-être au prix, d’ailleurs, d’un nouveau référendum, la procédure étant confuse à cet égard – s’il était élu. En 1998, 70 % des électeurs hispaniques avaient voté pour le démocrate Gray Davis et, en novembre 2002, ils avaient encore été près des deux tiers à le reconduire au pouvoir. En Californie, depuis la bataille de la proposition 187, initiative destinée, en 1994, à priver les immigrés clandestins de l’accès aux services publics et soutenue par le gouverneur républicain de l’époque, Pete Wilson, le parti démocrate avait tendance à considérer que le vote latino lui était acquis.
Mais le 7 octobre 2003, ni Bustamante, ni Davis, ni Schwarzenegger n’ont massivement emporté le vote latino. Au référendum sur la révocation du gouverneur, 46 % des électeurs hispaniques ont voté pour la révocation, 54 % contre. Selon des sondages de sortie des urnes, 52 % des électeurs hispaniques ont ensuite voté pour Cruz Bustamante, et 30 % pour Arnold Schwarzenegger. Échec personnel d’un gouverneur très affaibli et d’un candidat hispanique sans charisme, ou tournant politique pour la communauté latino ? Les résultats du scrutin californien montrent en tout cas que l’électorat hispanique, loin d’être monolithique, ne réagit plus seulement en fonction de ses intérêts ethniques mais, de plus en plus, selon les mêmes critères que le reste de la population : comme les autres Californiens, une bonne partie des Latinos considéraient que le temps était venu de changer de cap. Ils confirment aussi que, comme l’avait relevé une étude du Pew Hispanic Center and Kaiser Family Foundation2, un institut de recherche basé à Washington, l’attachement des latinos au parti démocrate n’est pas forcément profond, même si une majorité d’entre eux s’identifie à ce parti.
Cette surprise californienne est l’une des innombrables facettes du nouveau visage de l’Amérique, profondément transformé par une vague d’immigration sans précédent pendant la décennie 1990. Démographes, sociologues, politologues n’en finissent pas de découvrir des conséquences insoupçonnées de ce bouleversement. Hormis le peuplement de l’Amérique au cours du XIXe siècle, la seule période d’immigration comparable par son intensité, compte tenu de la population de l’époque (76 millions en 1900), est celle du début du XXe siècle, avant que le système des quotas ne vienne strictement limiter l’immigration des Européens de l’est en 1921. Entre 1990 et 2000, au moins un tiers de la croissance démographique des États-Unis est provenue de l’immigration. À mesure que le taux de natalité baisse parmi les Américains de souche, blancs et noirs, la croissance de la population est essentiellement nourrie par les immigrés et leurs enfants.
L’onde de choc du recensement de l’an 2000
Nul ne peut, à cet égard, surestimer l’onde de choc du recensement de l’an 2000, effectué, comme le fait méthodiquement l’État fédéral américain depuis 1790, dix ans après celui de 1990, et dont les résultats servent de base à ce chapitre. Premier choc de ce recensement : la population américaine – 281421906 personnes en 2000, selon des chiffres rendus publics en avril 2001, et 288368698 personnes au 1er juillet 2002 d’après les chiffres actuels du Bureau du recensement – augmente à un rythme beaucoup plus rapide que ne pouvait le laissait prévoir le recensement de 1990. Les projections de populations faites à partir des chiffres de 1990 permettaient d’envisager une population de 275 millions en l’an 2000. Or en dix ans, les États-Unis se sont enrichis de 32,7 millions d’individus, soit une augmentation de 13,2 % – un record dans l’histoire du pays. À ce rythme, calculait en août 2002 l’hebdomadaire The Economist, en 2040, les Américains seront plus nombreux que les Européens, alors qu’en 1950 l’Europe occidentale était deux fois plus peuplée que les États-Unis : 304 millions d’Européens d’un côté de l’Atlantique, 152 millions d’Américains de l’autre.
Le rôle de l’immigration dans cette croissance démographique est primordial. D’abord parce que, dans la décennie 1990, l’Amérique a intégré officiellement plus de 11 millions d’immigrés (contre six millions dans les années 1970 et sept millions dans les années 1980). Les Hispaniques ont, en particulier, enregistré une augmentation spectaculaire : + 60 %. Ensuite parce que le taux de fertilité est supérieur au sein de la population latino (3,0) à celui qui prévaut au sein de la population blanche non hispanique (1,8) et noire (2,1). Si l’on tient compte de la dizaine de millions d’immigrés illégaux aux États-Unis non comptabilisés dans les chiffres officiels mais dont les enfants contribuent à la croissance démographique – puisque, nés sur le sol américain, ils deviennent aussitôt citoyens américains –, cela signifie que les immigrés contribuent doublement à la croissance démographique américaine3.
De toutes les couleurs
Le recensement de 2000 contenait d’autres surprises. Pour la première fois, en ce début de millénaire, les Américains ont eu au cours de cette opération la possibilité de se définir différemment en termes de race : c’est l’officialisation du concept multiracial. Le cheminement vers cette étape mérite qu’on s’y attarde, tant il est révélateur de l’évolution des relations raciales au XXe siècle aux États-Unis, ainsi que des notions d’ethnie et de race, sujets de débats intenses.
Le recensement de 1930 avait institué la règle du one drop rule, aussi appelée règle de « l’hypodescendance » : une goutte de sang noir dans les veines, si diluée fût-elle, rangeait automatiquement le citoyen américain dans la catégorie de race noire. Dans les années 1960, le mouvement des droits civiques a imposé l’adoption de lois sur la non-discrimination raciale, dont le recensement de 1970 allait être le reflet, puisque à partir de cette date il revenait désormais à l’individu lui-même de déterminer la race à laquelle il appartenait. S’il se considérait comme blanc, il s’inscrivait dans la catégorie raciale blanche, s’il se considérait comme noir, il s’inscrivait dans la catégorie raciale noire. En 1980, sous la pression des leaders de la communauté hispanique qui cherchent à obtenir pour les latinos les mêmes protections et les mêmes programmes d’affirmative action dont bénéficient déjà les Noirs, le Bureau du recensement institue la catégorie « Hispanique ».
En novembre 1993 se tient au Congrès une série d’auditions sous la houlette du représentant Tom Sawyer, président de la sous-commission de la Chambre des représentants, sur le recensement et les statistiques4. Quatre propositions de réformes du recensement y sont formulées, dont aucune ne sera adoptée : ajouter une catégorie « multiraciale » ; créer une catégorie spéciale pour les Américains originaires du Proche-Orient ou les Américains arabes ; classer les Hawaïens de souche dans la même catégorie que les Indiens américains de souche ; et classer les Hispaniques comme catégorie raciale, plutôt que comme catégorie ethnique. Un consensus émerge : seules deux de ces questions – la catégorie multiraciale et la qualification du groupe hispanique – méritent de retenir l’attention, mais pour faire l’objet de recherches plus approfondies. Bref, il est urgent d’attendre. L’idée de définir la communauté hispanique comme une race à part sera d’ailleurs abandonnée en 1996.
Malgré cela, le seul fait que ces propositions, tout particulièrement celle de la création d’une catégorie multiraciale, aient été sérieusement examinées montre que l’approche conventionnelle de la définition des races est ébranlée. De même, la demande d’une classification ethnique, « non raciale », pour les habitants originaires du Proche-Orient, qu’ils soient arabes ou non, remet en cause les notions traditionnelles de race et d’ethnicité. Les Arabes-Américains étaient jusque-là classés comme blancs, alors que certains se définissent comme personnes de couleur et souhaiteraient, par la même occasion, pouvoir bénéficier des programmes de discrimination positive (affirmative action). Il existait, en tout état de cause, une catégorie « attrape-tout » dans le recensement, la catégorie « autre race » pour ceux qui ne se voyaient ni noirs, ni blancs, ni indiens, ni asiatiques, et les statisticiens avaient observé une croissance constante de la colonne « autre », en grande partie alimentée par les Hispaniques, dont le contingent constituait, en 1990, 97,5 % de la rubrique « autre race »5.
C’est donc tout à fait logiquement que, lorsqu’ils reçoivent leur formulaire de recensement en 2000, les Américains constatent qu’ils peuvent désormais se ranger dans plusieurs catégories raciales à la fois, suivant le mélange de sangs dont ils ont hérité. Près de sept millions d’Américains saisissent l’occasion pour se déclarer hybrides, ou multiraciaux. Le chercheur français Denis Lacorne voit là « un tournant dans l’histoire de l’Amérique », en même temps que la première évaluation chiffrée de la taille du melting-pot6. Fascinés, les médias publient toutes sortes de projections futuristes, créées par ordinateur, du visage du « nouvel Américain ». Figure emblématique de ce melting-pot et de l’étonnante diversité du peuple américain, le champion Tiger Woods règne alors en maître sur les terrains de golf ; métis de Noir, de Blanc, d’Indien et d’Asiatique, il se définit un jour devant la presse comme « Cablinasian » (Caucasian/Black/Indian/ Asian).
Ces sept millions d’Américains « d’origines raciales multiples » font aussi sonner le glas, croient déjà pouvoir affirmer certains experts, du multiculturalisme, « idéologie qui promeut la coexistence permanente de cultures séparées mais égales », selon l’expression de Gregory Rodriguez, expert de la communauté hispanique auprès de la New American Foundation. Pour lui, « la reconnaissance officielle de l’hybridité par le Bureau du recensement n’a pas seulement brouillé le portrait statistique de la nation, elle a aussi ébranlé l’idée établie que la race et la culture peuvent être réduites à des catégories permanentes et mutuellement exclusives7 ». Le rythme de la croissance démographique et la jeunesse de ces sept millions d’Américains de toutes les couleurs permettant de penser qu’ils seront beaucoup plus nombreux en 2010, plus d’un commentateur se laisse alors aller à envisager une Amérique « postminorités », voire « postraciale ». À l’appui de cette vision idyllique, d’autres experts soulignent l’augmentation des mariages interraciaux : un sur quinze en 2000, contre un sur vingt-trois en 1990.
La montée des Hispaniques
La troisième bombe, à retardement celle-là, lâchée par le recensement de 2000 concerne la montée de la population hispanique. Cette ascension est, bien sûr, visible à l’œil nu au cours des années 1990 dans l’ensemble des États-Unis, où l’usage de l’espagnol se répand d’est en ouest y compris dans les services publics, transports, télécommunications, éducation, dans les médias et sur le marché publicitaire. N’importe où aux États-Unis, les fournisseurs d’accès au câble offrent une, deux, voire plusieurs chaînes télévisées en espagnol. En mai 2001, le président George W. Bush a innové en prononçant son allocution radiophonique hebdomadaire en espagnol. Dans la rue, dans les conversations de tous les jours, une nouvelle langue émerge, le « spanglish », sabir de transition pour immigrés en voie d’intégration, qu’un universitaire américain, lui-même juif né au Mexique, Ilan Stavans, va officialiser dans un livre aussi vivant que la langue qu’il décrit8. Pour Ilan Stavans, le spanglish peut même être comparé au yiddish qui, à partir d’un dialecte allemand truffé d’hébreu, était devenu la langue véhiculaire des juifs d’Europe centrale.
En juin 2003, de nouveaux chiffres du Bureau du recensement viennent confirmer avec quelques années d’avance ce que les projections des démographes prévoyaient pour 2014 : avec 38,8 millions de personnes, soit 13 % de la population américaine, les latinos constituent depuis juillet 2002 la plus importante minorité ethnique aux États-Unis, détrônant la minorité noire (38,3millions) au niveau national. C’était déjà le cas, depuis 2000, dans 23 États sur 50 – en Californie, par exemple. « Nous sommes désormais en terrain inconnu », annonce Roberto Suro, directeur du Pew Hispanic Center. La communauté hispanique américaine a plus que doublé depuis 1980. Un tiers des latinos ont moins de dix-huit ans. Accessoirement, cela veut dire aussi que la plus grosse minorité n’est plus un groupe racial, mais un groupe ethnique de races diverses, dont le principal facteur de cohésion est la langue, puisque environ 1,7 million d’Hispaniques se définissent comme noirs (ceux-ci, pour beaucoup originaires des Caraïbes, sont surtout concentrés en Floride et dans la région de New York) : les pistes de l’identité américaine sont de plus en plus brouillées.
Qui sont ces Hispaniques ? Ce sont, d’abord, des gens qui, en dehors de leur langue maternelle, de quelques modèles culturels et d’une religion dominante, le catholicisme, n’ont guère de dénominateurs communs, ni race, ni nationalité, ni classe sociale ; c’est avant tout, donc, une communauté très hétérogène. Le terme « latino » lui-même ne les définit que par rapport au reste des Nord-Américains : « En dehors des États-Unis, on ne parle pas des latinos ; on parle des Mexicains, des Cubains, des Portoricains, et ainsi de suite. Les latinos sont fabriqués aux USA », soulignent Marcelo Suarez-Orozco et Mariela Paez, du David Rockefeller Center for Latin American Studies à Harvard University9. Ils viennent, pour la grande majorité d’entre eux (58,5 %, d’après le recensement de 2000), du Mexique voisin, puis, dans l’ordre décroissant, de Porto Rico (9,6 %), État associé aux États-Unis et dont les ressortissants peuvent donc aller et venir librement, des petits pays d’Amérique centrale (4,8 %), d’Amérique du sud (3,8 %, dont les Colombiens forment le plus gros contingent), de Cuba (3,5 %) et de la République dominicaine (2,2 %). Ceux qui ne se sont classés dans aucune de ces catégories, ou bien qui correspondent à plusieurs à la fois, fournissent les 17,3 % restants. Selon le pays dont ils viennent et les conditions dans lesquelles ils l’ont quitté, ils vivent leur émigration et leur installation aux États-Unis de façon très différente : peut-on comparer, par exemple, le riche entrepreneur cubain poussé à l’exil à Miami par la révolution castriste et le manœuvre mexicain qui vient chercher un tr...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Remerciements
- Avant-propos
- Introduction
- Chapitre 1 - Les nouveaux visages de l’Amérique - Sylvie Kauffmann
- Chapitre 2 - L’avenir est-il républicain ? - Charles E. COOK, Jr
- Chapitre 3 - Argent et politique : la réforme de 2002 - Thomas E. Mann
- Chapitre 4 - Du judiciaire en politique - Vincent Michelot
- Chapitre 5 - La protection de la vie privée à l’ère du numérique - Jeffrey Rosen
- Chapitre 6 - Après enron : une révolution de velours - Lionel Barber
- Chapitre 7 - Les États-Unis face à la politique européenne de la concurrence - David S. Evans
- Chapitre 8 - La transformation de l’appareil militaire Américain - David C. Gompert
- Chapitre 9 - La stratégie de sécurité nationale de l’administration Bush - Gary J. Schmitt
- Chapitre 10 - La légitimité de la puissance américaine en question - Charles A. Kupchan
- Annexe 1
- Annexe 2
- Annexe 3
- Annexe 4
- Annexe 5
- Index
- Les auteurs