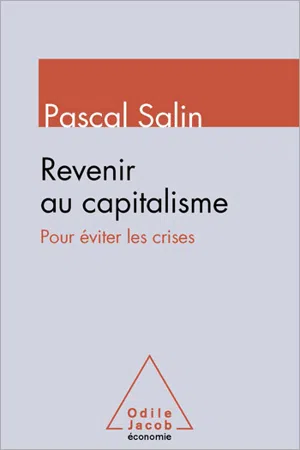
- 256 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Conséquence d'un manque d'éthique des banquiers, la crise ? Effet d'un esprit de lucre insensé incitant à prendre trop de risques pour obtenir davantage de bonus ? Trop simpliste, réplique Pascal Salin. Produit d'une déréglementation excessive ? Faux, corrige-t-il. Plutôt de trop de mauvaises réglementations, de mauvaises politiques économiques et monétaires… et d'une insuffisance de capitalisme. Dès lors, l'État redevient-il la solution, comme le prônent les partisans de l'interventionnisme et de la régulation, de nouveau à la mode ? Rien de moins sûr, souligne-t-il. Le « retour de l'État » risque plutôt de nous enfoncer encore plus…Par un esprit libre, le décryptage de la crise et des hypocrisies auxquelles son interprétation dominante donne lieu. Pascal Salin est professeur émérite à l'université Paris-Dauphine. Il est notamment l'auteur de La Vérité sur la monnaie et de Libéralisme.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l'application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux forfaits: Essentiel et Intégral
- Essentiel est idéal pour les apprenants et professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la Bibliothèque Essentielle avec plus de 800 000 titres fiables et best-sellers en business, développement personnel et sciences humaines. Comprend un temps de lecture illimité et une voix standard pour la fonction Écouter.
- Intégral: Parfait pour les apprenants avancés et les chercheurs qui ont besoin d’un accès complet et sans restriction. Débloquez plus de 1,4 million de livres dans des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. Le forfait Intégral inclut également des fonctionnalités avancées comme la fonctionnalité Écouter Premium et Research Assistant.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l’application Perlego sur appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n’importe où — même hors ligne. Parfait pour les trajets ou quand vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Oui, vous pouvez accéder à Revenir au capitalisme par Pascal Salin en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Économie et Théorie économique. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Chapitre 1
Pour en finir avec les idées fausses sur les vraies causes de la crise
La crise financière et économique est un phénomène complexe dont il n’est pas facile de démêler les tenants et aboutissants tellement ses différents éléments sont interdépendants entre eux. Malheureusement, on a généralement tendance à s’en tenir à quelques observations simplistes ou superficielles consistant par exemple à se focaliser sur les bonus des financiers ou les parachutes dorés de certains dirigeants d’entreprises. Ces faits sont avérés, excitent l’imagination, mais ne permettent absolument pas de comprendre les causes profondes de la crise. Si l’on veut non seulement décrypter ce qui s’est passé, mais aussi éviter de nouvelles crises dans le futur, il est essentiel d’avoir une vue cohérente de l’ensemble du système à partir duquel la crise la plus récente est née et s’est développée.
Si la crise financière et économique de 2007-2009 résulte de la conjonction de plusieurs causes, celle sans laquelle les autres n’auraient pas pu exister réside dans l’extraordinaire instabilité de la politique monétaire menée aux États-Unis, mais aussi dans d’autres régions du monde. C’est d’ailleurs cette même cause que l’on retrouve dans toutes les crises de l’époque moderne, et c’est pourquoi l’analyse de la plus récente peut être considérée comme une illustration particulière de phénomènes beaucoup plus généraux. C’est donc la politique monétaire qui retiendra d’abord notre attention, avant d’évoquer deux autres causes importantes de la crise récente, la politique du logement aux États-Unis et les méfaits de la réglementation financière. Il nous faudra aussi prendre du recul par rapport à ces événements et rechercher – ce qui sera fait dans le chapitre suivant – comment ils s’inscrivent dans une perspective plus large qui est celle du fonctionnement du capitalisme à notre époque. Faute d’accepter cet effort d’approfondissement, on risquerait de mal interpréter les phénomènes que l’on a connus, mais aussi de retomber ultérieurement dans les mêmes erreurs, avec les mêmes conséquences dommageables.
Une politique monétaire déstabilisatrice : la Fed, la BCE et les autres…
Il est habituel de dire que le capitalisme est fondamentalement instable et que le fonctionnement d’une économie de marché a nécessairement un caractère cyclique, qui se manifeste notamment par l’apparition régulière de crises financières. On ajoute évidemment, en corollaire, que la politique macroéconomique doit jouer le rôle éminent de stabiliser l’économie. On l’appelle d’ailleurs « politique de stabilisation ».
L’observation des faits peut sembler effectivement corroborer cette vision. Il ne suffit cependant pas d’observer, il faut encore comprendre. Et peut-être sera-t-on placé sur le bon chemin de la réflexion en constatant tout d’abord qu’il y a eu un changement majeur dans la nature des crises au cours de l’histoire. Pendant la plus grande partie de la vie des hommes et pratiquement jusqu’au XIXe siècle, les crises ont été dues à des phénomènes « naturels » ou, disons plutôt, non monétaires : des épidémies, des guerres, de mauvaises récoltes résultant des caprices du temps. Pourtant, la monnaie existait et elle jouait bien son rôle. Les crises monétaires n’existaient pas, elles, tout simplement parce que les variations dans la quantité de monnaie étaient faibles. La finance existait bien aussi, puisqu’il y avait des banques, des transferts d’épargne et des placements de toutes sortes. Mais les crises financières n’existaient pas, elles, parce que les taux d’intérêt étaient très stables. Des êtres humains innombrables avaient réussi, par leurs efforts et leur imagination, à réduire les causes principales d’instabilité économique du passé – sauf, il faut tout de même le reconnaître, celle qui était et qui reste d’origine étatique, à savoir les guerres. Pour leur part, les progrès de la médecine avaient permis d’éviter les grandes épidémies ; les progrès techniques dans l’agriculture avaient éliminé les famines et la diversification des activités les avait rendues moins dépendantes des aléas extérieurs.
Parallèlement à ces progrès fantastiques, un obstacle majeur est venu interrompre cette marche vers la stabilité économique : l’interventionnisme étatique dans les systèmes monétaires et financiers. La monnaie n’a jamais aussi mal joué son rôle que depuis l’époque – du XIXe au XXIe siècle – où sa gestion a été placée sous le contrôle des autorités monétaires. Il n’y a jamais eu dans l’histoire autant d’inflation et de crises monétaires qu’au cours de cette période. Et puisque la monnaie est gérée par des autorités publiques, il faut bien admettre que ce sont elles qui se sont rendues coupables de l’instabilité monétaire. Ce caractère public n’empêche pas la banque centrale d’être éventuellement une entreprise privée. Ce fut le cas de la Banque de France jusqu’en 1936 et c’est encore le cas, dans une certaine mesure, du Federal Reserve System aux États-Unis (la Fed), puisqu’il est l’émanation des douze banques de réserve fédérales, qui appartiennent elles-mêmes à des banques privées. Mais toutes ces banques centrales, qu’elles soient publiques ou privées, font l’objet d’une législation spécifique, bénéficient de privilèges publics, sont contrôlées par les autorités publiques qui nomment généralement leurs dirigeants. Quels que soient les statuts précis des banques centrales et leurs pouvoirs, toutes ces dispositions sont à l’origine de la constitution d’un monopole monétaire d’origine publique : seules ont droit d’émettre de la monnaie les organisations qui appartiennent au système monétaire national, contrôlé et dirigé par la banque centrale, et l’utilisation d’autres monnaies par les résidents d’un pays est soit interdite soit limitée. En d’autres termes, la concurrence des monnaies est interdite ou limitée, si l’on veut bien – comme on le devrait – définir la concurrence par la liberté d’entrer sur un marché. Ainsi, loin de constituer une preuve du mauvais fonctionnement des économies capitalistes, il apparaît de manière éclatante que les crises monétaires et financières sont le résultat d’une faillite des États et non d’une faillite du capitalisme et des marchés ! Les événements des années récentes en donnent une illustration frappante.
Revenons d’abord un peu en arrière. Après la récession de 1992, la Fed s’est lancée dans une politique monétaire très expansionniste. Au cours de la période qui a suivi, le taux de croissance annuel de la masse monétaire (M3) a été d’environ 10 %, ce qui est considérable et ce qui impliquait un doublement de la quantité de monnaie circulant dans le monde à peu près tous les six ou sept ans. Bien évidemment, cette politique a été accompagnée par des taux d’intérêt faibles ou même négatifs. Cela a provoqué la création d’une bulle spéculative qui s’est manifestée par une augmentation sensible des prix des biens de capital, des actifs, des biens fonciers et, bien sûr, des actions, puisque celles-ci représentent des droits de propriété sur ces actifs. Ainsi, si l’on considère un indice mondial des actions1, on constate un sommet de l’indice à 240 en 2000 (sur une base 100 en 1995, ce qui implique bien une augmentation considérable en cinq ans), puis un creux à 120 en 2003 et une remontée presque jusqu’à 280 au milieu de 2007.
Or on n’a pas suffisamment porté d’attention à ce phénomène, ainsi que l’explique Jesus Huerta de Soto2 : « Comme dans les années “ronflantes” qui ont précédé la Grande Dépression de 1929, le choc dû à la croissance monétaire n’a pas significativement influencé les prix du sous-ensemble de biens et services situés au niveau du consommateur final de la structure de production… Au cours de la décennie passée [les années 1990], comme au cours des années 1920, il y a eu une augmentation remarquable de la productivité résultant de l’introduction à une échelle massive de nouvelles technologies et d’innovations entrepreneuriales significatives, qui, en l’absence de l’“orgie de monnaie et de crédit”, auraient donné lieu à une réduction saine et durable du prix unitaire de tous les biens et services consommés par les citoyens. En outre, l’incorporation complète d’économies comme celles de la Chine et de l’Inde dans le marché globalisé a également augmenté encore davantage la productivité dans la production des biens de consommation. L’absence d’une saine “déflation” des prix des biens de consommation au cours d’une période de croissance considérable de la productivité, comme celle des années récentes, apporte la preuve principale que le choc monétaire a sérieusement troublé le processus économique. »
Ces remarques sont très importantes. En effet, à peu près tout le monde, en dehors des économistes de l’école « autrichienne » (dont nous évoquerons les thèses au chapitre 3), est habitué à une approche globale des phénomènes économiques et c’est ainsi que l’on définit, à la suite d’un Milton Friedman aussi bien que d’un John Maynard Keynes, le taux d’inflation comme l’augmentation du prix des biens de consommation. Or s’il y a, comme ce fut le cas au cours des années 1990, mais aussi au début du XXIe siècle, des gains de productivité importants dans la production de ces biens, on n’est pas alerté par le phénomène inflationniste – le seul auquel on prête attention, avec le taux de chômage – lorsque l’indice des prix des biens de consommation reste à peu près stable ou augmente faiblement : on n’aura pas le sentiment que la politique monétaire est trop expansionniste si, par exemple, les prix augmentent de 2 ou 3 % par an3. Pourtant, un tel taux est considérable si intervient, par exemple, une augmentation moyenne de la productivité dans le secteur des biens de consommation de 3 à 5 % par an. Par ailleurs, pour des raisons qui ont été bien expliquées par les auteurs de l’école autrichienne (voir ci-dessous, chapitre 3), il est normal, dans des situations de croissance monétaire forte, que les excès de création monétaire se déversent particulièrement sur les marchés d’actifs, de matières premières, de biens capitaux ou de biens fonciers dont les prix augmentent beaucoup plus que ceux des biens de consommation. Au lieu de s’en préoccuper, on admire, bien souvent, l’augmentation rapide des prix de l’immobilier ou des actions. Ceux qui détiennent de tels avoirs ont le sentiment d’un enrichissement facile et rapide et peu à peu tout le monde se précipite, y compris les retardataires, pour prendre sa part dans cette grande fête de l’enrichissement sans peine. On a le sentiment, contrairement à toute logique économique, qu’il est possible d’accroître sa richesse sans avoir à supporter le sacrifice qu’implique normalement la constitution de toute épargne. Telle est l’une des grandes illusions créées par la politique monétaire expansionniste. Or les illusions ne peuvent jamais durer longtemps. Et lorsque la politique de bas taux d’intérêt et de forte expansion monétaire prend fin, on assiste inéluctablement à l’explosion de la « bulle financière ». C’est la crise.
C’est bien ce schéma qui s’est réalisé au cours des années 2000 du fait d’une politique monétaire catastrophique menée par les autorités monétaires américaines et, plus précisément, par celui qui était apparu pendant longtemps comme un formidable démiurge de la monnaie, le président du Federal Reserve Board, Alan Greenspan. Quelques chiffres caractéristiques de l’évolution du taux d’intérêt l’illustrent de manière frappante. Observons tout d’abord l’évolution du « taux des fonds fédéraux ». Ce taux constitue en fait un objectif de politique monétaire de la Fed, qui ne le fixe pas directement, mais qui essaie de l’atteindre en achetant ou en vendant des actifs sur le marché, c’est-à-dire en faisant ce que l’on appelle une « politique d’open market ». Ce taux détermine les conditions auxquelles les établissements de crédit se prêtent mutuellement des liquidités à court terme et il influence évidemment les autres taux d’intérêt.
Les banques doivent en effet détenir des réserves auprès de la Fed et celles qui ont des réserves excédentaires prêtent aux autres à un taux qui est le federal funds rate. Par ailleurs, la Fed pratique des opérations d’open market – achats et ventes d’actifs financiers – à un taux qui est le taux d’escompte. Ce taux est généralement supérieur au federal funds rate pour inciter les banques à se procurer des réserves directement sur le marché interbancaire et non auprès de la Fed. En diminuant le taux d’escompte, la Fed incite donc les banques à lui emprunter directement. C’est donc sans doute le taux d’escompte qui est le plus significatif car c’est lui qui détermine le niveau global des réserves, alors que le federal funds rate détermine seulement l’échange de liquidités – c’est-à-dire de réserves auprès de la Fed – entre banques (les banques ayant toujours intérêt à prêter leurs réserves excédentaires, c’est surtout sur la demande de réserves que joue ce taux). Mais la Fed atteint son objectif de federal funds rate précisément par une politique d’open market : en fournissant plus de liquidités aux banques, elle crée des réserves excédentaires que les banques offrent sur le marché interbancaire, faisant ainsi diminuer le federal funds rate. C’est ainsi que de la nouvelle monnaie entre dans l’économie (création au multiple à partir des réserves créées).
Le taux des fonds fédéraux (federal funds rate), qui était de 8 % en juillet 1991, avait été ramené à 3 % en septembre 1992. Il avait ensuite effectué une remontée progressive pour atteindre 6 % en 2000, époque de l’éclatement de la « bulle Internet ». Pour lutter contre le ralentissement économique lié à cet événement, les autorités monétaires ont rapidement diminué ce taux, puisqu’il n’était plus que de 1,25 % en novembre 2002, et même de 1 % en juin 2003. C’est ainsi qu’a été lancé un nouvel épisode du cycle monétaire et financier, celui qui devait aboutir à une crise en 2007-2008. À partir de juin 2004, une lente remontée devait commencer jusqu’à ce que le taux atteigne 5,25 % en juin 2006. Il devait ensuite amorcer une chute spectaculaire à la suite du déclenchement de la crise monétaire, puisqu’il passait à 4,75 % en septembre 2007, avant d’atteindre le montant invraisemblable de 0-0,25 % en décembre 2008 !
Il faut bien être conscient du fait que passer ainsi en quelques années de 8 à 3 %, puis de 3 à 6 %, de 6 à 1 %, de 1 à 5,25 %, avant de tomber finalement à 0 % constitue la plus extraordinaire et irresponsable variabilité de taux d’intérêt que l’on puisse imaginer. Jamais une telle variabilité n’aurait pu se produire si les taux d’intérêt avaient été librement fixés sur les marchés financiers sans intervention arbitraire des autorités monétaires. La politique monétaire américaine a été le plus grand facteur d’instabilité économique des deux dernières décennies et le facteur déterminant de la crise financière ! En effet, le taux d’intérêt – qu’on peut considérer, ainsi que nous le rappelons ultérieurement, comme le prix du temps – joue un rôle fondamental dans la vie économique, en particulier parce qu’il influence les décisions d’épargne et d’investissement. Il est évident que les variations considérables de ce taux d’intérêt ne reflétaient en rien les évolutions normales de l’appréciation du temps par les individus, c’est-à-dire de leurs désirs d’investir et d’épargner. En manipulant de manière aussi fantastique et fantasque le taux d’intérêt, les autorités monétaires ont introduit le virus du déséquilibre dans le fonctionnement des marchés financiers. Il est donc d’autant plus étonnant d’entendre proclamer la faillite des marchés à propos de la crise financière que tout le monde devrait unanimement s’élever contre la faillite des autorités publiques ! Il est par ailleurs très inquiétant de constater qu’un système monétaire comme celui des États-Unis est construit de manière telle qu’un homme seul, ou presque seul, Alan Greenspan, peut provoquer des bouleversements sur les marchés financiers et dans l’économie réelle mondiale aussi démesurés que ceux des années 2007-2009 ! C’est cela que nous devrons méditer lorsque nous nous interrogerons sur les conséquences à tirer de ces événements.
La période de bas taux d’intérêt a évidemment coïncidé avec une période de forte création de monnaie (et, en contrepartie, de crédits puisqu’il n’y a pas de création monétaire sans création de crédits). Ainsi, comme le souligne George Reisman4 : « Au cours de la période de temps entre 2001 et 2008, la Fed a provoqué une augmentation dans l’offre de monnaie de plus de 70 % du montant total cumulé qu’elle avait créé au cours de la totalité des quatre-vingt-huit années de son existence, c’est-à-dire presque 2 000 milliards de dollars ! » En outre, la Fed a permis aux banques de fonctionner avec seulement 2 % de réserves. Elle a ainsi délibérément cherché à imposer des taux d’intérêt réels négatifs. Certes, les taux d’intérêt sur les marchés n’ont pas connu des fluctuations aussi spectaculaires que celles du taux des federal funds. Il est en tout cas certain que la Fed, inspirée implicitement par des principes de type keynésien en faveur de la stimulation de la demande globale, voulait que les gens dépensent toujours plus et elle a pour cela rendu le crédit abondant et peu coûteux. La grande illusion keynésienne selon laquelle la politique monétaire peut être utilisée pour stimuler l’activité économique a été à l’origine de la crise majeure de notre époque. Ce qui n’empêche pas la plupart des commentateurs de proclamer la victoire des idées keynésiennes en l’occurrence !
Ben Bernanke – qui a succédé à Alan Greenspan à la tête de la Fed – rend l’extérieur responsable des bas taux d’intérêt longs. D’après lui, une forte épargne en Chine et dans d’autres pays émergents a conduit à un excédent de capital qui est allé se placer aux États-Unis en grande partie et a exercé une pression à la baisse des taux d’intérêt longs. Cela aurait favorisé la bulle financière. Même s’il est impossible de savoir dans quelle mesure les taux d’intérêt du marché, à court, moyen et long terme, ont été affectés, respectivement, par la politique monétaire américaine et par l’abondance d’épargne de certains pays émerg...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Introduction
- Chapitre 1 - Pour en finir avec les idées fausses sur les vraies causes de la crise
- Chapitre 2 - La faute à la finance ?
- Chapitre 3 - Keynes a-t-il vraiment gagné ?
- Chapitre 4 - L’État redevient-il la solution ?
- Chapitre 5 - Que craindre maintenant pour demain ?
- Chapitre 6 - L’illusion de la coopération internationale
- Conclusion - Que faut-il « moraliser » ?
- Du même auteur Chez odile jacob