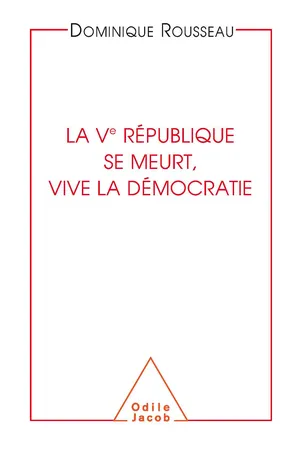
- 336 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
La Ve République se meurt, vive la démocratie
À propos de ce livre
N'est-ce pas notre Constitution qui est responsable de bien des difficultés politiques actuelles ? Ne devient-elle pas un handicap à une nécessaire évolution vers plus de participation et un meilleur équilibre des pouvoirs ? Que faire alors ? Aller jusqu'à une VIe République ?Dominique Rousseau retrace l'histoire politique et institutionnelle de la Ve République. Il montre comment la Constitution de 1958, toujours en quête d'équilibre, s'est transformée, souvent profondément, au point de perdre presque tous ses traits d'origine. Malgré ses succès et ses métamorphoses, née en bravant la démocratie parlementaire, elle continue de défier la démocratie des citoyens. Sans doute peut-elle encore durer, mais combien de temps et à quel prix ? L'un de nos meilleurs constitutionnalistes livre à point nommé sa vision de notre système politique et les directions qu'il entrevoit pour l'avenir. Dominique Rousseau est professeur de droit constitutionnel à l'université de Montpellier et membre de l'Institut universitaire de France.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à La Ve République se meurt, vive la démocratie par Dominique Rousseau en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politique et relations internationales et Constitutions. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Troisième partie
La Ve République
qui se reconstruit
qui se reconstruit
Chapitre 1
La Ve République
refait ses institutions
refait ses institutions
Une figure présidentielle redessinée
Beaucoup l’ont oublié mais la constitution adoptée en 1958 ne prévoyait pas l’élection populaire du président de la République ! Les partis politiques de la IVe République, dont de Gaulle a besoin pour assurer le succès du référendum de ratification, y sont hostiles, et Michel Debré également qui craint que le suffrage universel fasse du parti communiste, étant donné son influence électorale (entre 20 et 25 %), l’arbitre de l’élection du chef de l’État. Mais le général ne veut plus d’un président élu par et donc dépendant du Parlement. Le compromis est donc la création, par l’article 6 de la Constitution, d’un collège électoral de notables, composé des députés, des sénateurs mais aussi des conseillers généraux, des maires et des délégués des conseils municipaux dont le nombre varie en fonction de l’importance de la commune ; en tout, un collège de 80 000 grands électeurs où les parlementaires ne sont plus que 800. Ainsi est élu le général de Gaulle le 21 décembre 1958 avec 78 % des voix.
Le principe de l’élection du président de la République par le peuple est introduit par une révision de la Constitution adoptée par le référendum du 28 octobre 1962 et décidée pour résoudre le conflit de pouvoir qui oppose, après la fin de la guerre d’Algérie, le général de Gaulle aux parlementaires. Révision donc de circonstance, davantage commandée par les contraintes du jeu politique en cette année 1962 que par une philosophie constitutionnelle. Les propos et écrits du général révèlent, en effet, une indifférence certaine, au moins pour ce qui le concerne, à l’égard du mode de désignation du chef de l’État. Le 20 septembre 1962, il affirme clairement que, en raison des liens exceptionnels que les événements de l’Histoire ont tissés entre lui et les Français, il « n’a pas attaché en 1958 une importance particulière aux modalités de [sa] désignation, puisque celle-ci était d’avance prononcée par la force des choses » ; et, poursuit-il, « le mode de scrutin retenu alors ne pouvait, non plus qu’aucun autre, fixer [ses] responsabilités à l’égard de la France, ni exprimer à lui seul la confiance que veulent bien [lui] faire les Français ». Cette explication doit être complétée par la situation particulière de 1958 et l’hostilité des alliés politiques du général, alors indispensables à la réussite du projet constitutionnel, qui rendaient, de fait et de droit, impossible l’adoption du scrutin populaire pour la désignation du Président. Au demeurant, Michel Debré est également opposé à ce mode de désignation car il engage le chef de l’État dans l’œuvre quotidienne du gouvernement et la France dans un régime présidentiel « dangereux à mettre en œuvre ».
Le discours de Bayeux, référence obligée des gaullistes, fournit-il en la matière une doctrine constitutionnelle claire ? En lui-même, non, le général se limitant à évoquer un collège électoral « qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large ». Mais, Léon Blum, analysant ce discours trois jours après son énoncé, écrit que la conclusion logique du système proposé est l’élection du chef de l’État au suffrage universel car il donne à celui-ci une partie de la souveraineté et que toute souveraineté émane nécessairement du peuple. Et, en 1962, de Gaulle répond, en écho, que le Président étant désormais la clef de voûte du régime et ayant la mission d’assurer le destin de la France, il doit recevoir sa charge, directement, de l’ensemble des citoyens. Logique donc avec la conception gaulliste du chef de l’État, cette réforme ne ferait que réaliser ce qui n’avait pu l’être en 1958. Mais sans cesser d’être logique, elle est aussi pragmatique et stratégique : il s’agit de briser définitivement les espoirs de restauration parlementaire de la classe politique en lui enlevant tout pouvoir sur la désignation du président de la République.
Cet enjeu pratique est parfaitement compris par les oppositions qui dénoncent dans cette réforme « la suppression du régime représentatif qu’ont voulu les républicains restés fidèles à la grande tradition française », prédisent la naissance d’un pouvoir personnel, omniprésent, incontrôlable et qui réduira les droits et libertés des citoyens, invoquent le souvenir de l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 et de la dictature qui s’ensuivit, rappellent le boulangisme… À coup sûr, l’élection populaire du chef de l’État ne fait partie de la doctrine d’aucune des familles politiques françaises traditionnelles pour des raisons à la fois de conviction, de formation et aussi d’« interdits professionnels » puisque leur métier de faiseur de président est en cause.
Et pourtant, le principe de l’élection du président de la République au suffrage universel direct est approuvé par 68 % des électeurs. Dans un ultime sursaut, le président du Sénat, adversaire déterminé du général et de la révision, saisit le Conseil constitutionnel et lui demande de sanctionner l’inconstitutionnalité de la loi référendaire. Habilement, le Conseil, dans sa décision du 6 novembre 1962, distingue « les lois votées par le Parlement » pour lesquelles il est compétent, et « les lois adoptées par le peuple à la suite d’un référendum » pour lesquelles il se déclare incompétent au motif qu’elles « constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». Après cette décision du Conseil, tout est dit. La loi constitutionnelle est immédiatement promulguée : désormais le Président est élu par le peuple à la majorité absolue des suffrages exprimés ; si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, quinze jours plus tard, à un second tour où « seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ».
Aucune autre disposition de la Constitution n’était modifiée ; et pourtant beaucoup de choses allaient changer dans l’exercice du pouvoir et la vie politique de la France, même s’il convient de ne pas faire de cette révision constitutionnelle la cause unique de ces changements. Ne serait-ce que parce qu’au Portugal, en Autriche ou en Irlande, l’introduction de l’élection populaire du chef de l’État a produit des jeux politiques différents et, chaque fois, particuliers.
Dans une uchronie désormais célèbre, le doyen Georges Vedel a imaginé ce qui se serait passé si le « non » l’avait emporté au référendum du 28 octobre 1962 : le départ du général bien sûr, puis l’élection de son successeur selon les modalités de 1958 puisque la révision aurait échoué. Qui les 80 000 grands électeurs auraient-ils élu ? Antoine Pinay, qui « par son passé, sa culture politique, les conditions de son élection entendra sa mission comme celle d’un chef d’État parlementaire » laissant le gouvernement, avec le soutien du Parlement, déterminer et conduire la politique de la nation. Ainsi la pratique politique du général n’aurait été qu’une parenthèse justifiée par les circonstances exceptionnelles de la guerre d’Algérie et refermée aussitôt après le retrait de De Gaulle.
L’intérêt de cet exercice intellectuel est de mettre clairement en évidence que la défaite des « non » est celle de la lecture parlementaire de la Constitution de 1958 et plus encore du principe d’interprétation parlementaire des dispositions constitutionnelles né de la « Constitution Grévy ». En ce sens, et à juste titre, de nombreux observateurs ont qualifié le scrutin du 28 octobre 1962 de 16 mai 1877 à l’envers. Deux ans après l’entrée en application des lois constitutionnelles de la IIIe République, le maréchal de Mac-Mahon tente d’affirmer son pouvoir présidentiel en prononçant la dissolution de la Chambre des députés qui contestait ses choix politiques. Appelé ainsi à trancher entre deux pratiques, présidentielle ou parlementaire, des institutions, les électeurs désavouent le Président en élisant une majorité parlementaire hostile à ses thèses. Mac-Mahon se soumet d’abord puis démissionne, et est remplacé, le 31 janvier 1879, par Jules Grévy dont le premier discours a pour objet d’affirmer que jamais le président de la République n’entrera en conflit avec la volonté des chambres. De cette victoire des parlementaires a découlé une convention, implicite, selon laquelle chacun admettait que toutes les dispositions constitutionnelles, y compris celles relatives aux pouvoirs du Président, devaient s’interpréter dans un sens toujours favorable à la souveraineté parlementaire. Convention qui explique la lecture parlementaire de la Constitution de 1958 par les leaders de la IVe République, et en particulier de Guy Mollet, convaincus que les nouvelles prérogatives reconnues au chef de l’État s’insèrent naturellement dans ce cadre.
Pour avoir été l’enjeu du référendum du 28 octobre 1962 et pour avoir été désavouée par les électeurs, la « Constitution Grévy » est, à ce moment-là, remise en cause. Le rapport des forces a changé : à la différence de 1877, le peuple, en 1962, donne une majorité au Président et approuve sa pratique des institutions y compris celle d’utiliser l’article 11 pour réviser la Constitution. Une autre convention, un autre principe d’interprétation, émerge qui implique désormais que les dispositions constitutionnelles doivent s’interpréter dans un sens favorable à la primauté présidentielle. Mais l’année 1962 substitue-t-elle une convention à une autre ou fait-elle coexister deux règles d’interprétation du jeu politique ?
À entendre le général de Gaulle exposer sa doctrine constitutionnelle dans sa célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964, la réponse, positive, ne fait guère de doute. Le Président, bien sûr, bénéficie d’un traitement privilégié, les formules utilisées lui attribuant une nature radicalement différente, à la fois supérieure et extérieure aux autres institutions, en somme une nature transcendantale, divine ou à tout le moins monarchique : « Le Président, déclare en effet le général, est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’État ; il doit être évidemment entendu que l’autorité indivisible de l’État est confiée tout entière au Président par le peuple qui l’a élu, qu’il n’en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui. Le Président est, suivant notre Constitution, l’homme de la nation mis en place par elle-même pour répondre de son destin. » Cette position hors norme – dans tous les sens du terme – du Président, qui fait quelque peu souffrir le principe de la séparation des pouvoirs, est directement rapportée au fait qu’il est l’élu de la nation ; le sacre populaire joue ainsi le rôle du sacre de Reims !
La fonction de Premier ministre doit sans doute exister, précise le général, mais « on ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet de l’État ». Et il montre en quoi il n’en est rien, en quoi le Premier ministre lui est subordonné : le Président le choisit ainsi que les autres membres du gouvernement ; il a « la faculté de le changer, soit parce que se trouve accomplie la tâche qu’il lui destinait et qu’il veuille s’en faire une réserve en vue d’une phase ultérieure, soit parce qu’il ne l’approuverait plus » ; le Premier ministre a pour « lot la conjoncture, politique, parlementaire, économique, administrative », bref le quotidien, ou, selon un mot prêté au général, l’intendance. Mais, est-il aussitôt précisé, ce quotidien ne définit pas un domaine réservé du Premier ministre, car le Président peut toujours, s’il le juge nécessaire, se saisir de toute affaire ; c’est de lui, et de lui seul que procède la répartition des tâches en fonction des conjonctures. « Il ne saurait y avoir de séparation étanche entre les deux plans – le domaine suprême et le domaine quotidien – dans lesquels d’une part le Président, d’autre part celui qui le seconde, exercent quotidiennement leurs attributions. » Responsabilité du Premier ministre devant le chef de l’État, définition par ce dernier « de l’orientation de la politique nationale », autant d’affirmations en contradiction avec la Constitution, notamment dans ses articles 8, 5 et 20. Mais le général a prévenu, au début de sa conférence de presse : « Une Consti-tution, dit-il, c’est un esprit, des institutions, une pratique. »
À l’encontre de ceux qui considèrent la révision de 1962 comme une rupture définitive avec la tradition parlementaire classique, deux arguments, au moins, peuvent être opposés. D’abord, ce n’est pas la modification des articles 6 et 7 de la Constitution qui supprime la « Constitution Grévy » et établit le principe d’interprétation présidentielle. Le référendum du 28 octobre 1962 ne fait qu’enregistrer, que codifier la pratique des institutions imposée depuis 1958 par de Gaulle qui continue d’ailleurs à gouverner de la même manière avant comme après 1962 ou 1965, date de la première élection présidentielle au suffrage universel. Si 1962 peut cependant être présentée comme un tournant ou une révolution, c’est dans le sens où le texte de 1958 ne contient pas, de manière claire et non équivoque, le principe d’une pratique présidentielle, ce qui obligea le général, pendant quatre ans, à dépenser sans cesse une énergie considérable pour imposer sa vision des institutions contre celle des parlementaires. Avec la modification du texte, la réaffirmation continue et coûteuse de l’argumentation présidentielle peut être économisée, dans la mesure où son inscription dans la Constitution la fait bénéficier de la force propre du droit qui est de donner à ce qu’il énonce un caractère évident, irréprochable, légitime : la référence aux nouveaux articles 6 et 7 suffit désormais pour faire taire ou pour accuser de subversion du droit ceux qui voudraient continuer à défendre la primauté parlementaire. Ni véritable rupture ni vraiment continuité, la révision de 1962 enregistre une pratique – continuité – à laquelle elle donne le statut de parole d’ordre – rupture. Ensuite, la révision de 1962 ne modifie aucune autre disposition constitutionnelle et, en particulier, laisse intactes toutes celles qui identifient le caractère parlementaire du régime : la fonction de Premier ministre n’est pas supprimée, le gouvernement est toujours responsable de la détermination et de la conduite de la politique de la nation, le droit de dissolution est maintenu et l’Assemblée nationale peut toujours renverser le gouvernement. Autrement dit, l’élection du président de la République au suffrage universel ne supprime pas le ressort propre du régime parlementaire qui est d’être un gouvernement par des ministres responsables devant les députés. Autrement dit encore, la possibilité et la légitimité d’une interprétation et d’une pratique parlementaire de la Constitution ne deviennent pas caduques par la révision de 1962. Celle-ci n’a pas opéré une substitution de principe mais a mis à égalité de légitimité constitutionnelle le principe d’interprétation parlementaire et le principe d’interprétation présidentielle. Ou, comme l’écrit le doyen Georges Vedel, la France possède simultanément deux constitutions, celle de 1958 – parlementaire – et celle de 1962 – présidentielle. Que le temps ait donné l’avantage à la seconde n’empêche pas la première d’être toujours là, prête à « fonctionner ». Tout dépend de la conjoncture politique.
« Ceux qui ne sont pas encore défaits de la conception de jadis, déclare le général toujours dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, objectent que le gouvernement qui est celui du Président, est en même temps responsable devant le Parlement, comment concilier cela ? » La réponse fournie apparaît partielle et incomplète. Il rappelle d’abord et à nouveau que le fait essentiel est la confiance populaire dont bénéficie le Président par son élection, ce qui donne au gouvernement qu’il nomme une autorité supérieure à celle qu’il possédait « à l’époque où il ne procédait que des combinaisons de groupes ». Il remarque ensuite qu’une rupture de confiance entre le Parlement et le gouvernement ne peut être qu’exceptionnelle étant donné les conditions mises par la Constitution pour l’adoption d’une motion de censure. Il affirme enfin qu’en cas de crise ministérielle, il existe toujours une issue démocratique puisque le Président « peut recourir à la nation pour la faire juge du litige par voie de nouvelles élections, ou par celle du référendum ou par les deux à la fois ». C’est, en 1964, la justification du scénario retenu pour résoudre la crise de l’automne 1962.
Mais la situation qui n’est pas évoquée par le général est celle où le gouvernement appuyé par la majorité parlementaire s’oppose au Président, ou celle où, après la dissolution présidentielle, le peuple envoie à l’Assemblée une majorité hostile au chef de l’État. « Comment concilier cela ? », pour reprendre les propos du général. Pas de réponse. Ce silence est significatif de la fragilité constitutionnelle de la fonction présidentielle décrite par de Gaulle. Sans doute peut-il trouver dans le texte et dans la rédaction nouvelle de l’article 6 les arguments de droit favorables à sa thèse de la primauté présidentielle. Mais la « Constitution de Gaulle » de 1964 n’a pas supprimé la Constitution de 1958. Et, en particulier, le fait incontournable, quelles que soient les prouesses rhétoriques, que le gouvernement étant responsable devant l’Assemblée doit nécessairement avoir la confiance de ladite Assemblée et par conséquent être nécessairement pris dans la majorité de celle-ci.
Là réside l’équivoque constitutionnelle, selon le mot du doyen Vedel. De quelque manière que les choses soient tournées, le système politique français démontre, depuis 1958, l’incompatibilité entre une institution présidentielle active élue par le peuple et l’existence d’une responsabilité gouvernementale devant l’Assemblée nationale. Cette dernière signifie que les députés peuvent renverser le gouvernement, donc que le président de la République ne peut gouverner que s’il dispose d’une majorité personnelle à l’Assemblée, donc que l’élection populaire ne suffit pas pour faire un Président actif. François Mitterrand et Jacques Chirac en ont fait l’éclatante démonstration, le premier en prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale après chacune de ses élections – avouant ainsi qu’il ne pourrait être actif avec une majorité parlementaire opposée à ses orientations politiques –, le second en se découvrant « roi nu » après la dissolution manquée d’avril 1997. Et c’est en partie pour lever cette équi-voque, qui déplace en permanence l’équilibre des pouvoirs, que le quinquennat a été introduit en 2000.
Imposée au président Chirac par « son » Premier ministre, Lionel Jospin – avec la complicité active de VGE –, ratifiée par référendum le 20 septembre 2000, la durée du mandat présidentiel est désormais de cinq ans. Jusqu’à cette date, et depuis 1873, le chef de l’État était élu pour sept ans. Sans qu’il soit possible pour autant de faire de cette durée un élément de la tradition républicaine française. D’abord parce qu’en 1848 la IIe République avait fixé à quatre ans non renouvelables la durée du mandat présidentiel1. Ensuite parce que le choix du septennat en 1873 est un choix de circonstance fait pour faciliter la restauration de la monarchie. En effet, après la chute du second Empire, la République est proclamée le 4 septembre 1870 mais, aux élections législatives du 8 février 1871, les monarchistes, partisans de la paix immédiate, quand les républicains défendent la poursuite de la guerre, obtiennent la majorité. La question de la restauration de la monarchie est donc posée. Mais bute sur la personne du prétendant. Pour certains monarchistes, le trône doit revenir au comte de Chambord, petit-fils de Charles X et partisan d’un retour au modèle « Ancien Régime », symbolisé par son refus d’admettre le drapeau tricolore ; pour d’autres, il doit revenir au comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe et partisan d’une monarchie constitutionnelle acceptant les acquis de 1789. Faute d’entente, ils élisent un monarchiste, Mac-Mahon, président de la République, chargé de garder la place ...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Introduction
- Premiere partie - La Ve République qui attend… la IVe
- Deuxième partie - La Ve République qui s’enracine
- Troisième partie - La Ve République qui se reconstruit
- Quatrième partie - La Ve République qui défie la démocratie
- Conclusion