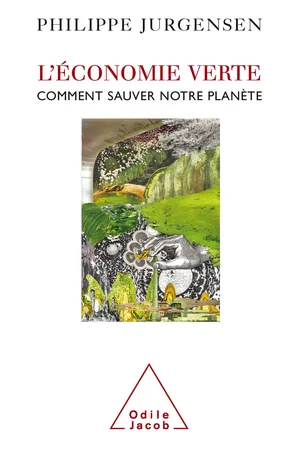
- 336 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Cyclones, inondations, incendies se succèdent à un rythme accéléré depuis quelques années. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les sols qui nous nourrissent continuent de se dégrader, sans parler du climat qui se réchauffe, de l'énergie qui se raréfie et de la biodiversité qui se réduit. Tout le monde, ou presque, s'accorde aujourd'hui pour reconnaître qu'il y a urgence ; mais, concrètement, que peut-on faire, à l'échelon individuel, national ou international ? Quelles sont les priorités, quels sont les obstacles ? Quelles sont les échéances raisonnables ? Quels sont les programmes réalistes ?Réagir efficacement, ce n'est pas lancer des anathèmes contre la mondialisation, faucher des cultures expérimentales ou préconiser l'arrêt de toutes les centrales nucléaires. C'est, au contraire, retourner, au profit de la nature, les deux grands instruments qui ont, parfois, contribué à la détruire : une science bien comprise, qui offre de multiples promesses, et une économie qui ne demande qu'à faire jouer ses lois en faveur de l'environnement, pourvu qu'on valorise, comme il convient, les productions écologiques. Professeur à Sciences-Po Paris, spécialiste des questions d'économie et d'environnement, Philippe Jurgensen dirige aujourd'hui l'Autorité de contrôle des assurances.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L' Économie verte par Philippe Jurgensen en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences biologiques et Science environnementale. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Notes
1- Il s’agit de sir John Houghton.
2- Joseph Stiglitz, professeur d’économie à Stanford, a reçu le prix Nobel d’économie en 2001 ; il a été « chef économiste » de la Banque mondiale, qu’il a quittée en 1999. Paul Krugman, professeur et éditorialiste renommé, spécialiste des échanges internationaux, vient de recevoir le Nobel d’économie 2008.
3- Il est de bon ton aujourd’hui de parler de « changement climatique » plutôt que de réchauffement. En réalité, les divers aspects du changement climatique semblent être en grande partie provoqués par le réchauffement, ou en tout cas fortement liés à l’élévation de la température du globe.
4- Ce réchauffement correspond à la tendance séculaire linéaire de 1906 à 2005. Si l’on compare les années 2001-2005 à la moyenne de la seconde moitié du XIXe siècle, la hausse de température du globe est de 0,76 °C. Le GIEC juge « très probable » (à plus de 90 %) que les températures de la seconde moitié du XXe siècle ont été les plus élevées depuis cinq cents ans, et « probable » (à plus de 66 %) qu’elles aient battu des records sur mille trois cents ans dans l’hémisphère Nord.
5- Les dix années les plus chaudes depuis le milieu du XIXe siècle ont été, dans l’ordre, 1998, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006, 2007, 2001, 1997 et 1995, selon l’OMM. En 2007, la température en France a été supérieure de 0,8 °C à la moyenne de long terme ; l’été a été particulièrement chaud dans le Sud européen, ainsi qu’en Inde (45 à 50 °C), mais le froid a sévi en Amérique du Sud, et l’Afrique du Sud a enregistré en 2007 ses plus fortes chutes de neige depuis 1981. L’Université d’East Anglia estime que 2008, tout en étant un peu plus froide que 2007 (avec 0,37 °C de température au-dessus de la moyenne de long terme des années 1961-1990 au lieu de 0,41 °C), se situera encore parmi les dix premières. Il n’y a pas de statistiques de température suffisamment suivies avant 1850 pour justifier autre chose que des estimations sur les périodes antérieures. Ce fait donne des arguments à ceux qui contestent la thèse largement majoritaire du réchauffement climatique ; cf. chapitre suivant.
6- Estimation du Meteorological Office britannique et de l’Université East Anglia. La température se serait située à 0,65 °C de plus que la moyenne 1860-1990 dans l’hémisphère Nord, mais seulement 0,32 °C dans l’hémisphère Sud, plus riche en océans, ce qui augmente l’inertie thermique. La température moyenne des pays du Nord se serait élevée de 0,4 °C en dix ans seulement.
7- L’automne 2006, où les températures ont dépassé de 3 °C en moyenne les normales saisonnières au nord des Alpes, a été jugé « exceptionnel » par l’OMM. Il fut le plus chaud que l’Europe ait connu depuis cinq siècles, selon une équipe de climatologues suisses associée à des historiens (Geophysical Research Letters, août 2007). Loin de se limiter à une seule année, le phénomène s’étendrait à toute la décennie 1997-2006.
8- Avril 2007 a été un mois particulièrement chaud dans toute l’Europe : 4 °C de plus que les moyennes établies. La température a atteint 33 °C à Moscou en mai 2007 !
9- Selon le GIEC, ce réchauffement s’étend en fait jusqu’à 3 000 mètres de profondeur ; les océans absorberaient 80 % de la chaleur supplémentaire apportée au système climatique.
10- Une étude publiée en mars 2006 par la revue Science lie la hausse du nombre de cyclones violents à l’augmentation de la température de surface des océans en zone tropicale dans cinq bassins océaniques où se forment ces cyclones ; + 0,5 °C entre 1970 et 2004. L’étude retient cependant aussi d’autres causes possibles : variation de la force des vents, voire cycles naturels de long terme ; cf. chapitre II. Une autre étude limitée à l’Atlantique nord donne une hausse de 0,8 °C depuis le début du XXe siècle, dont 0,4 °C pour la période plus récente, résultat tout à fait cohérent avec le précédent ; selon ses auteurs, « il existe une relation forte entre les températures océaniques et l’activité cyclonique ».
11- La mousson (de l’arabe mausim, « saison ») est un phénomène récurrent qui touche l’Amérique latine, l’Afrique, la Chine du Sud, mais surtout le sous-continent indien. Il s’agit de pluies diluviennes d’été provenant de masses d’air équatorial très humides poussées par les vents. Normalement bienfaisantes (la fertilité agricole de ces régions en dépend), elles peuvent tourner à la catastrophe en cas d’excès comme en 2002, 2004, 2006 et 2007 – la mousson « la plus importante de mémoire d’homme », selon l’ONU. Une étude de chercheurs indiens publiée dans Science en décembre 2006 lie cette nouvelle violence de la mousson au réchauffement climatique.
12- Les deux tiers du territoire du Bangladesh ont été sous les eaux en 2002, année où les inondations ont gagné toute l’Asie du Sud-Est ; en 2004, la mousson intense et les glissements de terrain ont provoqué 1 800 morts dans l’Inde du Nord, au Népal et au Bangladesh, et 1 000 morts en Chine de l’Est et du Sud ; en 2007, les inondations ont de nouveau recouvert la moitié du Bangladesh, les États indiens du Nord et le Balouchistan, provoquant 2 300 morts et 30 millions de sinistrés, tandis que la Chine et la Corée du Nord faisaient face aux pires inondations depuis dix ans selon la Croix-Rouge, causant plus de 500 morts et 5 millions d’évacuations.
13- Dans les régions de Gloucester, de Worcester et d’Oxford, près de 400 000 foyers ont été privés d’abri et d’eau potable en juillet 2007, à la suite de pluies diluviennes ayant fait déborder la Tamise, la Severn et les autres rivières. Ces inondations seraient les plus graves depuis soixante ans. En Allemagne, les pluies de 2007 ont aussi été les plus abondantes depuis le début des relevés, en 1901.
14- Les trois termes sont synonymes, le nom de typhon étant plus volontiers employé pour les cyclones qui frappent l’Asie orientale et celui d’ouragan (hurricane) pour l’Atlantique et le Pacifique Nord-Est. Une tempête (tropical storm pour les Anglo-Saxons) devient un cyclone lorsque les vents excèdent 117 km/h. Une échelle comparative, dite « Saffir-Simpson », a été établie pour calibrer la force des cyclones ; elle comporte cinq niveaux : la catégorie 1 débute au niveau précité de 117 km/h ; la catégorie 3 comporte des vents soufflant de 178 à 209 km/h ; pour le niveau 5, ils dépassent 249 km/h.
15- Le nombre total de cyclones – environ 90 par an en moyenne sur la planète – serait stable depuis 1970. Le rapport 2007 du GIEC admet d’ailleurs que, si les ouragans sont plus fréquents dans l’Atlantique Nord en corrélation avec le réchauffement des eaux – une étude récente (Nature, janvier 2008) lie précisément le réchauffement d’un demi-degré de la température de l’eau en surface dans le golfe du Mexique, les Caraïbes et l’Atlantique Nord à une augmentation de 40 % des tempêtes dans cette zone –, « il n’y a pas de tendance claire sur le nombre annuel de cyclones tropicaux ». Mais une étude de chercheurs américains montre que le nombre et la proportion d’ouragans des catégories 4 et 5, les deux plus élevées, a presque doublé depuis 1970 sur l’ensemble du globe : il s’en produirait en moyenne 7 à 8 par an, contre 3 il y a un siècle (Science, septembre 2005).
16- Les 1 300 morts recensés se situent pour la plupart à La Nouvelle-Orléans, mais aussi dans des États voisins du sud des États-Unis. L’ensemble du golfe du Mexique a été très touché en 2005 : Katrina a été précédée et suivie de deux autres cyclones de force maximale (5), Rita et Wilma ; le cyclone Stan avait causé plus de 2 000 morts au Guatemala peu avant.
17- En 1998, l’ouragan Mitch avait tué 24 000 personnes au Nicaragua. Le Nord-Est australien, habituellement sec, a été balayé en 2006 par le plus violent cyclone recensé depuis trente ans. En 2007, le cyclone Sidr a causé 4 000 morts au Bangladesh et dévasté l’archipel des Sundarbans, qui abrite sur 5 800 km2 la plus grande forêt de mangroves du monde. En mai 2008, le typhon Nargis a tué 84 000 personnes en Birmanie. Une récente étude climatologique, publiée par la Philosophical Transactions of the Royal Society, montre aussi un doublement du nombre d’ouragans pour l’Atlantique Nord par rapport au début du XXe siècle. En 2008, on en a compté huit, dont cinq majeurs.
18- La sécheresse de 2007, plus forte que celle de 2006, serait la pire depuis cent treize ans aux États-Unis.
19- L’Espagne, le Portugal, la France, l’Italie (12 000 décès supplémentaires) et le Benelux ont été les plus touchés par ce surcroît de décès, frappant les personnes les plus fragiles (vieux, handicapés, isolés…).
20- On a compté 500 morts en Hongrie, 60 en Roumanie, 65 en Grèce lors de deux canicules successives (juin et juillet 2007), avec des chaleurs dépassant 45 °C ; on a aussi enregistré des décès en Croatie, en Albanie, en Italie du Sud (13 morts) etc.
21- Au total, 280 000 hectares de forêts ont brûlé en Grèce à l’été 2007, y compris près d’Athènes les bois séculaires du mont Parnasse ; de violents incendies ont aussi dévasté au même moment le sud de la Macédoine, la Serbie et la Croatie, et les îles Canaries, qui ont perdu en un été 20 % de leur couverture végétale.
22- Voir Avis de tempêtes : la nouvelle donne climatique, de J.-L. Fellous.
23- Les catastrophes naturelles ont coûté aux assureurs (qui ne remboursent que la partie garantie de ces sinistres) 42 milliards de dollars en 2004 et 107 milliards en 2005, dont 48 pour les cyclones Katrina, Rita et Wilma aux États-Unis, qui ont failli conduire le prestigieux Lloyds à la faillite. Selon l’étude Sigma de Swiss Re, qui fait référence pour le secteur, le coût global a été nettement plus faible (16 milliards de dollars) pour une année plus faste comme 2006 ; il est remonté à 25 milliards de dollars en 2007 et 50 milliards en 2008 (dont 20 pour l’ouragan Ike). Mais ce coût pour les assureurs ne représente qu’une fraction des dommages totaux, qui approcheraient 200 milliards de dollars (140 milliards d’euros) en 2008, selon Munich Re. Le coût d’un ouragan qui frapperait directement Miami est estimé à plus de 100 milliards de dollars.
24- Selon Geographical Research Letters, la surface touchée par la fonte s’est accrue de 42 % au Groenland, tandis que la température en été augmentait de 2,4 °C dans cette zone. Deux études convergentes, se fondant sur des relevés par satellite, situent la perte nette de masse glaciaire subie par le Groenland entre 220 et 240 milliards de tonnes par an, ce qui provoquerait une hausse de 0,6 millimètre par an du niveau des océans ; le rythme de fonte aurait doublé en dix ans (Science, février 2006 et août 2007). Une troisième étude (Science, octobre 2006) donne un chiffre de pertes plus faible : 100 milliards de tonnes par an entre 2003 et 2005.
25- Dans son rapport 2007, le GIEC estime le recul de la banquise arctique à 2,7 % par an (moyenne depuis 1978). La calotte glaciaire a atteint son minimum absolu en septembre 2007, avec 4,2 millions de km2 ; en 2008, son rétrécissement a été un peu moins marqué, mais le niveau subsistant (4,52 millions de km2) demeure inférieur d’un tiers à la moyenne des minima observés entre 1979 (début des relevés par satellite) et 2000, selon le centre américain de données sur la neige et la glace (NSIDC).
26- La fonte de la banquise antarctique concerne essentiellement la zone ouest, d’où se détachent de grands morceaux de banquise (3 000 km2 en 2002 !). Mais le réchauffement mesuré est inégal : fort (+ 5 °C en cent ans) dans la péninsule antarctique, il serait négatif (– 0,5 °C) en terre Adélie. Le rapport 2007 du GIEC considère qu’il n’y a finalement pas de tendance démontrée sur l’ensemble polaire Sud. Une étude postérieure confirme un bilan stable pour la partie orientale, tandis que l’Antarctique Ouest et la péninsule de Larsen perdraient deux fois plus de glace qu’il y a dix ans : 190 milliards de tonnes en 2006 ; l’apport à la hausse du niveau des océans est estimé à 0,54 mm/an, chiffre encore faible, mais triple de celui retenu par le GIEC (Nature Geoscience, janvier 2008).
27- Le taux de fonte de la glace de m...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Avertissement
- Introduction
- Première partie - Faut-il se sentir menacé ?
- Deuxième partie - La science et l’économie au service de l’environnement
- Troisième partie - Les routes du « paradis vert »
- Conclusion
- Annexes
- Glossaire des sigles
- Notes
- Bibliographie
- Du même auteur