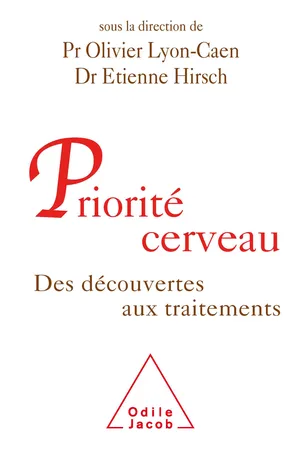
- 432 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Aujourd'hui, 15 millions de personnes en France souffrent d'une, voire de plusieurs maladies du cerveau : migraines, dépression, troubles du sommeil ou encore maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, etc. Ce chiffre ne cesse de croître. La connaissance du cerveau et notre compréhension des mécanismes à l'origine de ces maladies constituent donc un enjeu collectif majeur face au vieillissement de la population. Si, au cours des dernières années, les maladies neurologiques ont bénéficié de certains progrès thérapeutiques, les traitements curatifs font encore souvent défaut et les ressources financières sont insuffisantes face aux exigences et aux nécessités de la recherche. Ce livre réunit les plus grands spécialistes du cerveau et de ses maladies. Il propose la mise en place d'un « plan cerveau » fondé sur 10 propositions autour desquelles pourrait se développer une politique réaliste et ambitieuse. Un état des lieux de la recherche fondamentale et clinique sur le cerveau. Un point sur les traitements les plus prometteurs. Olivier Lyon-Caen est professeur à l'université Pierre-et-Marie-Curie, coordonnateur du pôle des maladies du système nerveux et responsable du département de neurologie de la Pitié-Salpêtrière. Etienne Hirsch est neurobiologiste. Il est actuellement directeur adjoint du centre de recherche de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Priorité cerveau par Olivier Lyon-Caen,Etienne Hirsch en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences biologiques et Neurosciences. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Troisième partie
Les principales pathologies
du cerveau
du cerveau
Chapitre 18
Pathologies du mouvement
Philippe Damier
Maladie de Parkinson et autres syndromes parkinsoniens dégénératifs
Définition, symptomatologie et traitement
La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative dont le cœur lésionnel est la destruction progressive des neurones dopaminergique nigrostriataux. L’absence de dopamine cérébrale qui en résulte est à l’origine de la symptomatologie caractéristique de cette maladie : tremblement de repos, lenteur et difficulté d’exécution des mouvements, rigidité. Elle touche de l’ordre de 120 000 personnes en France avec un âge de début moyen de 55-65 ans. Un début plus précoce n’est pas rare, plus de 10 % des formes débutant avant l’âge de 50 ans. Des traitements symptomatiques efficaces existent. Ils sont principalement médicamenteux avec la L-DOPA et les agonistes dopaminergiques qui compensent le déficit en dopamine. Pour certaines formes sévères de maladie, un traitement chirurgical est envisageable avec la neurostimulation cérébrale profonde qui corrige certains dysfonctionnements cérébraux provoqués par l’absence de dopamine. Même si leur gestion a fait d’importants progrès, ces traitements restent potentiellement source d’effets indésirables : fluctuations d’efficacité, mouvements anormaux (dyskinésies) et troubles psychiatriques provoqués par le traitement médicamenteux, complications neurochirurgicales pour la neurostimulation, pour ne citer que les plus fréquents. Avec le temps, le processus dégénératif progresse et se développent des lésions non dopaminergiques. Ces dernières sont en particulier responsables de troubles axiaux (troubles de l’équilibre, dysarthrie) et d’une altération cognitive. Ces symptômes non améliorés par les traitements symptomatiques disponibles sont souvent à l’origine d’un handicap important et de la perte d’autonomie des patients.
À côté de la maladie de Parkinson existent d’autres syndromes parkinsoniens dégénératifs plus rares, comme l’atrophie multisystématisée, la paralysie supranucléaire progressive ou la démence à corps de Lewy où les lésions sont d’emblée plus diffuses. La symptomatologie est par conséquent plus riche avec, à côté des symptômes observés dans la maladie de Parkinson, des troubles végétatifs (troubles sphinctériens, tensionnels), des troubles de l’équilibre ou une altération cognitive. Les possibilités de traitement symptomatique sont restreintes et un handicap majeur se développe le plus souvent en moins d’une dizaine d’années.
Connaissances scientifiques
La maladie de Parkinson est la maladie neurodégénérative où pathogénie et physiopathologie sont les mieux connues. Des progrès majeurs ont été obtenus ces cinquante dernières années. À la fin des années 1960, le déficit en dopamine a été identifié comme responsable de la symptomatologie, ce qui a conduit au développement des traitements médicamenteux symptomatiques, la L-DOPA, puis les agonistes dopaminergiques. Dans les années 1980-1990, ce sont les principaux dysfonctionnements cérébraux conséquents à l’absence de dopamine striatale qui ont été mieux compris, avec comme corollaire thérapeutique la neurostimulation cérébrale profonde. Sur ces dix dernières années, des essais thérapeutiques d’envergure ont permis d’affiner les stratégies de traitement en particulier en début de maladie. Parallèlement, la cause de la maladie de Parkinson s’est précisée. Elle est clairement non unique. Il existe des formes génétiques monogéniques dans 10 à 15 % des cas pour lesquels plusieurs gènes responsables ont été identifiés depuis 1997, date de l’identification de la première mutation causale. Des causes toxiques rares sont possibles avec principalement les quelques cas de syndromes parkinsoniens provoqués par le MPTP décrits à la fin des années 1970 sur la côte ouest des États-Unis. Dans la plupart des cas, l’origine est en fait multifactorielle avec une combinaison de facteurs génétiques, dont certains commencent à être connus, et probablement aussi de facteurs environnementaux. La nature du processus dégénératif se précise aussi avec l’implication d’une accumulation anormale d’agrégats protéiques intraneuronaux (comportant entre autres de l’alphasynucléine) et de stress oxydatif. L’origine primaire ou secondaire à la perte neuronale de ces phénomènes reste néanmoins à préciser.
Le niveau de connaissance sur les autres syndromes parkinsoniens dégénératifs est moindre. Sont essentiellement connus les principaux sites lésionnels et la nature des processus dégénératifs (à savoir synucléopathie avec des phénomènes proches de ceux observés dans la maladie de Parkinson ou tauopathie avec des phénomènes en partie similaires à ceux de la maladie d’Alzheimer).
Les défis à relever
Le principal défi est la meilleure connaissance du processus dégénératif. Il est déterminant d’en connaître les causes précises (génétiques et non génétiques), les facteurs (cofacteurs génétiques, environnementaux, âge) qui en modulent la sévérité et l’expression (formes de gravité ou de diffusion lésionnelle différentes) et les mécanismes. Ces connaissances sont le prérequis indispensable au développement de traitements susceptibles de freiner, voire de stopper l’évolution de la maladie. Il faut souligner que les connaissances acquises pour la maladie de Parkinson (probablement plus simples à obtenir en raison du caractère relativement focal des lésions) seront source de progrès dans la connaissance des processus en cause dans les autres affections neurodégénératives.
La meilleure compréhension des dysfonctionnements cérébraux provoqués par les lésions dopaminergiques et non dopaminergiques reste importante. Elle peut permettre d’affiner la qualité de la correction du déficit dopaminergique en agissant sur d’autres systèmes de neurotransmission et surtout en corrigeant les désordres conséquents aux lésions non dopaminergiques. Les connaissances acquises dans ce domaine sont susceptibles d’être utiles aussi dans la compréhension et le traitement d’autres affections où le système dopaminergique est en cause, comme les addictions et certaines affections psychiatriques.
Les autres pathologies du mouvement
D’autres affections neurodégénératives ou non sont susceptibles d’altérer aussi le mouvement. Seules les plus fréquentes seront ici évoquées.
Le tremblement essentiel
C’est une affection fréquente puisqu’elle touche environ 300 000 personnes en France. La symptomatologie consiste en un tremblement de posture et d’action, gênant sur le plan social et sur le plan fonctionnel dès lors qu’il est intense. La cause en est encore mal connue, même si des facteurs génétiques sont probables en raison d’un caractère familial du trouble dans 50 % des cas. Il s’agit probablement d’une affection neurodégénérative, bien que les lésions soient encore mal identifiées. Les possibilités thérapeutiques sont médicamenteuses, avec les bêtabloquants et certains antiépileptiques, et chirurgicales, avec la neurostimulation cérébrale profonde dans les cas sévères.
Beaucoup reste donc à faire dans la connaissance de cette affection fréquente tant en ce qui concerne son origine que les dysfonctionnements cérébraux qui la sous-tendent.
La maladie de Huntington
Il s’agit d’une maladie neurodégénérative monogénique autosomique dominante. Les symptômes apparaissent vers l’âge de 30-40 ans. Ils consistent en des mouvements anormaux involontaires, la chorée, des troubles de l’équilibre et une altération cognitive se manifestant initialement par une symptomatologie psychiatrique. À l’exception de médicaments réduisant l’intensité des mouvements anormaux ou contrôlant les symptômes psychiatriques, il n’existe pas de traitement efficace. Le principal progrès est venu de l’identification de la mutation génétique responsable en 1993. Les conséquences pathogéniques de cette mutation restent à mieux comprendre pour permettre le développement de traitements susceptibles de ralentir la progression, voire d’empêcher l’apparition de la symptomatologie.
Les dystonies
Il s’agit par définition de contractions musculaires involontaires à l’origine de mouvements de torsion répétitifs ou de postures anormales. Les dystonies peuvent être localisées, affectant un groupe musculaire restreint (le cou [torticolis spasmodique], la main [crampe de l’écrivain], la musculature périorbitaire [blépharospasme]) ou généralisées. Un grand nombre de causes en sont à l’origine. De façon schématique sont distinguées les dystonies secondaires où une cause précise est identifiée (lésion cérébrale, médicaments comme les neuroleptiques ou maladie neurodégénérative) et les dystonies primaires. Ces dernières ne sont probablement pas neurodégénératives, dans le sens où n’existent pas de lésions neuronales. Plusieurs causes génétiques ont été identifiées ces dix dernières années. Sur le plan thérapeutique, l’efficacité des médicaments est souvent modeste. La pratique d’injection de toxine botulinique améliore les dystonies localisées. La neurostimulation cérébrale profonde s’est révélée remarquablement efficace pour corriger les dystonies généralisées en particulier chez l’enfant.
Il reste par conséquent à identifier les causes dans les dystonies primaires pour lesquelles une cause génétique n’est pas encore connue et surtout mieux comprendre les dysfonctionnements cérébraux qui les sous-tendent. Les traitements actuels restent encore insuffisamment efficaces pour un grand nombre de patients. Ils doivent donc être améliorés et de nouvelles pistes thérapeutiques sont à trouver.
Maladie de Gilles de la Tourette
Comme pour les dystonies primaires, il ne s’agit pas d’une maladie neurodégénérative. Cette affection se manifeste par des mouvements anormaux brusques, les tics. Ils sont moteurs, au niveau des membres, de la musculature axiale, de la face et vocaux, avec des cris, des mots, voire de brefs segments de phrase. L’expression des tics est variable d’un patient à l’autre et se modifie dans le temps chez un même patient. Cette affection débute dans l’enfance, peut se résoudre spontanément, mais non systématiquement, en fin d’adolescence. La physiopathologie reste mal connue et les possibilités de traitements limitées. Quelques médicaments sont efficaces, mais souvent de façon partielle et avec des effets indésirables ; les psychothérapies peuvent parfois aider.
Points forts du domaine
• Connaissances importantes acquises sur la pathogénie et la physiopathologie de la maladie de Parkinson (en raison de la relative simplicité lésionnelle).
• Traitements symptomatiques médicamenteux et neurochirurgicaux efficaces pour la maladie de Parkinson.
• Connaissances de plusieurs mutations génétiques à l’origine de dystonies primaires.
• Efficacité du traitement neurochirurgical dans un grand nombre de pathologies du mouvement (maladie de Parkinson, tremblement essentiel, dystonie).
Points faibles du domaine
• Causes et mécanismes encore à préciser dans la maladie de Parkinson et autres syndromes parkinsoniens dégénératifs.
• Traitements susceptibles de freiner le processus dégénératif dans la maladie de Parkinson et autres syndromes parkinsoniens dégénératifs comme dans la maladie de Huntington restent à découvrir.
• Connaissance de la physiopathologie des dystonies et de la maladie de Gilles de la Tourette à améliorer.
Chapitre 19
Pathologie neuromusculaire
Claude Desnuelle, Jean-Marc Léger,
Jean-Michel Vallat et Jean Pouget
Jean-Michel Vallat et Jean Pouget
Sclérose latérale amyotrophique
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative définie sur la quasi-sélectivité de l’atteinte anatomique aux neurones moteurs spinaux et corticaux. C’est la plus fréquente des maladies du neurone moteur dans lesquelles on inclut les amyotrophies spinales et la maladie de Kennedy d’origine génétique, la poliomyélite antérieure aiguë d’origine virale et nombre de formes frontières : sclérose latérale primitive, atrophie musculaire progressive, forme pseudopolynévritique ou encore des variantes cliniques qui se distinguent de la SLA classique par la focalisation de l’atteinte motrice et un génie évolutif différent comme la diplégie brachiale ou pelvienne progressive (flail arm ou flail leg syndrome), la forme hémiplégique de Mills, les formes à début respiratoire ou encore des associations à d’autres manifestations neurodégénératives par la présence de signes extrapyramidaux, de troubles cognitifs touchant fréquemment les fonctions exécutives ou formant une véritable démence frontotemporale présente initialement, plus rarement avec d’autres types de démence.
Si les formes sporadiques représentent 90 % des SLA, il existe des formes familiales qui méritent une place à part avec plus de 50 % de formes liées à une mutation dans le gène SOD1 et alors le plus souvent de transmission autosomique dominante, mais ailleurs en relation avec des gènes variés dont la liste ne cesse de s’accroître : alsine, senataxine, FUS, VAPB, FIG4, ANG, TARDBP, etc. Il faut donner une place à part au gène TDP43 dont les mutations sont responsables d’environ 5 à 6 % des cas familiaux. Les modes de transmission peuvent être variables et même souvent sans évidence de transmission en ligne directe, rejoignant par là un concept de gène de susceptibilité favorisant le développement de la maladie.
Le corps commun de la SLA est représenté par son expression clinique avec perte de fonction des neurones moteurs pyramidaux et de la corne antérieure de la moelle entraînant une faiblesse musculaire progressive dans les territoires spinaux et/ou d’innervation bulbaire avec en conséquence une déficience motrice progressivement sévère au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs, dans les territoires axiaux et le diaphragme, mais aussi les territoires oro-buco-pharyngés avec dysarthrie, dysphagie et, dans tous les cas, une évolution fatale survenant entre 1 et 12 ans, à partir des manifestations initiales focales (médiane de 3 à 5 ans toutes formes confondues).
Il n’existe aucun élément marqueur, ni biologique ni radiologique, permettant d’affirmer le diagnostic ou de prévoir un pronostic évolutif. Des critères diagnostiques en termes de probable, possible ou défini, ont été établis, s’appuyant sur les notions de nombre de territoires où s’exprime de façon clinique ou électromyographique la souffrance motoneuronale et d’évolutivité. Ces critères n’ont pas de valeur véritablement clinique et restent discutés, mais sont utiles pour définir des populations par stades évolutifs. Le seul examen paraclinique informatif initial est ainsi l’électroneuromyogramme permettant de détecter une souffrance musculaire neurogène en relation avec la perte d’unités motrices.
Prise au sens strict de la définition anatomique et clinique, la SLA a une incidence de l’ordre de 1,5 à 2,5 pour 100 000 par an. Si l’on considère une durée d’évolution moyenne de trois ans, la prévalence peut être estimée à 6 pour 100 000 habitants (variation de 2,6 à 6,4). Le taux de mortalité est théoriquement similaire à l’incidence si on tient compte de la courte durée d’évolution. En fait, la littérature donne des chiffres plus faibles, de 0,5 à 2 pour 100 000 habitants, soit par exemple aux États-Unis où des études précises ont été menées, un risque de 1 pour 1 000 décès dans la population adulte. La proportion de SLA dans une population contemporaine adulte par rapport à la maladie d’Alzheimer est de 1 pour 2 000, ou par rapport à la maladie de Parkinson de 1 pour 50.
Les champs de recherche restent très étendus dans le thème de la SLA dont la physiopathologie reste encore imprécise. En corollaire se pose la question de savoir si ne sont pas regroupées sous ce terme générique clinique de SLA des maladies d’origines différentes, à expression clinique commune ou similaire, exprimant l’atteinte des neurones moteurs. Une question majeure d’actualité est ainsi de pouvoir définir des éléments marqueurs diagnostiques susceptibles de caractériser d’éventuelles sous-populations ou pouvant permettre de reconnaître des facteurs de risque génétiques ou environnementaux.
S’agissant de la physiopathologie, quelques pistes sont privilégiées à ce jour.
Le concept d’excitotoxicité reste toujours d’actualité. Mis en avant il y a déjà de nombreuses années avec le rôle neuroprotecteur des antiglutamates, il est couplé à la neurotoxicité de flux neuronaux calciques entrants. S’il ne s’agit pas d’un processus spécifique à la SLA, c’est très certainement un des acteurs importants à considérer dans la neuroprotection. Le bénéfice d’utilisation en termes de survie des antiglutamates a été mal considéré en prenant les résultats globaux d’études cliniques pour la molécule Riluzole faisant état d’un gain de survie de trois mois. En réalité, le bénéfice de survie est de l’ordre de 25 à 35 % selon que l’on considère ou non le risque relatif et, comparé aux thérapies anticancéreuses, ce résultat est plus qu’honorable. Le rôle des facteurs de croissance comme le VEGF est vraisemblable, mais à replacer dans le contexte d’hypoxémie qui caractérise la maladie lors de son évolution. Une autre piste physiopathologique porte sur l’analyse des causes de l’agrégation de protéines anormales, mal repliées, mutantes comme l’Aß42, l’ubiquitine, TDP43, l’α-synucléine ou SOD1. Considéré dans sa globalité, ce phénomène traduit vraisemblablement une dysfonction des synthèses protéiques, de leur maintien à l’état fonctionnel ou du moins de leur trafic. Comme démontré dans le modèle murin mutant SOD (G93A) et dans le sous-groupe de patients porteurs d’une forme familiale liée au gène SOD, un déficit fonctionnel du reticulum endoplasmique et des protéines chaperons contribue largement à l’expression de la maladie. Le métabolisme des ARN est également perturbé avec le rôle des gènes FUS/Syntaxine, TDP43 dont les protéines nucléaires contrôlent le processus de maturation des ARN. Le transport axonal est un sujet largement fléché dans la littérature avec le rôle de la dynactine qui assure le transport centripète le ...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Introduction
- Première partie - Organisation et fonction du cerveau
- Deuxième partie - Approche méthodologique du cerveau normal et pathologique
- Troisième partie - Les principales pathologies du cerveau
- Quatrième partie - Comment soigner le cerveau
- Cinquième partie - Dimension humaine et sociétale
- 10 priorités pour progresser dans la connaissance du cerveau et soigner ses maladies
- Glossaire
- Remerciements
- Présentation des auteurs