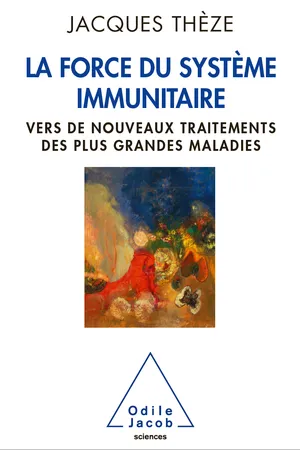
eBook - ePub
La Force du système immunitaire
Vers de nouveaux traitements des plus grandes maladies
- 320 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Comment le corps humain se défend-il avec autant de succès contre ses innombrables ennemis, bactéries, virus, cellules cancéreuses ? Pourquoi lui arrive-t-il de perdre la partie face à des agresseurs trop malins ? Et pourquoi en vient-il parfois à se dérégler, jusqu'à prendre pour cible le corps qu'il est censé défendre, comme dans les maladies auto-immunes? Les stratégies de nos défenses immunitaires sont d'une extraordinaire diversité, anticorps, leucocytes, cellules tueuses et lymphocytes régulateurs recourant à des méthodes fascinantes pour parvenir à leurs fins. Et l'on s'émerveille de comprendre le fonctionnement d'un système aussi organisé, capable de transporter en un clin d'œil, d'un bout à l'autre du corps, les molécules ou les cellules capables de neutraliser les attaques les plus pernicieuses. Notre système immunitaire se révèle comme une individualité à part entière, dotée d'un langage, d'une sensibilité (au stress, en particulier), de stratégies préétablies, celles de nos « défenses innées », mais aussi de facultés d'apprentissage et de mémoire qui caractérisent l'immunité « adaptative ». Au-delà des concepts trop simples de « soi » et de « non-soi », l'immunologie forge toujours de nouveaux outils pour préparer l'avenir. Les grandes maladies comme le cancer, le sida et bien d'autres céderont-elles à de futurs vaccins ? Les nouveaux médicaments issus du génie immunologique tiendront-ils toutes leurs promesses ? En attendant, comme elle l'a toujours fait, notre « intelligence » immunitaire ne cesse de s'adapter pour apprendre à gérer les situations nouvelles. Jacques Thèze, professeur à l'Institut Pasteur, membre correspondant de l'Académie de médecine et expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé, est un spécialiste internationalement reconnu dans la lutte contre le sida. Comme médecin et scientifique, ses travaux ont également contribué à faire émerger l'immunologie au rang des sciences biomédicales de pointe.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à La Force du système immunitaire par Jacques Thèze en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Médecine et Immunologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
DEUXIÈME PARTIE
Système immunitaire
et pathologie
Chapitre IX
LA LUTTE
CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES,
ENCORE ET POUR TOUJOURS
Parmi les catastrophes qui ont marqué l’histoire de l’humanité, les grandes épidémies rejoignent les famines et les guerres dans notre inconscient collectif. L’histoire de l’Antiquité et du Moyen Âge est explicite sur l’horreur que suscitaient les épidémies de peste, de variole ou d’autres maladies décimant des villes, s’acharnant sur des groupes qui vivaient parfois ces désastres comme une punition des dieux. Nous portons toujours en nous la crainte de ces drames. Depuis le XIXe siècle, les connaissances scientifiques, initiatrices de progrès médicaux et sociaux, ont néanmoins bouleversé cette donne. Aujourd’hui, nous pouvons facilement voir combien les améliorations apportées ont été immenses. Mais nous pouvons aussi constater que les microbes apprennent à résister aux traitements et que des maladies émergentes très pathogéniques ne cessent d’apparaître. Le combat contre les maladies se doit d’être renouvelé en permanence et la question fondamentale que nous traiterons dans ce chapitre est donc de voir de quelle manière le système immunitaire peut être utilisé pour poursuivre, et éventuellement gagner, cette lutte.
L’origine des maladies infectieuses
À partir des années 1960, les maladies infectieuses furent souvent considérées comme en voie d’extinction ou, pour le moins, sous complète maîtrise médicale. Plusieurs raisons expliquaient cette perception. Dans les pays aux revenus élevés, l’amélioration de la nutrition et des conditions de vie ayant augmenté le niveau de santé des populations, celles-ci résistaient beaucoup mieux aux maladies infectieuses. De plus, et surtout, le succès de l’utilisation des antibiotiques reléguait les infections au rang de maladies faciles à traiter, bénignes donc. S’ajoutait à cette constatation l’efficacité des vaccinations ayant conduit à l’éradication de la variole, à l’espoir d’en faire de même avec la poliomyélite ainsi qu’avec d’autres infections.
Après un demi-siècle de croyance à la « fin des maladies infectieuses », les inquiétudes sont réapparues. Si on mesure leur impact par le nombre de décès qu’elles causent directement, le bilan de ces affections demeure une source de grande préoccupation. Certes, dans un pays développé comme la France, le taux de mortalité directement lié aux maladies infectieuses (environ 4 %) ne se classe qu’au quatrième rang après le cancer (environ 30 %), les maladies cardio-vasculaires (environ 25 %) et les drogues dont l’alcool et le tabac (environ 20 %), soit un total d’environ 25 000 morts pour 550 000 décès déclarés par an. En revanche, au niveau planétaire, la situation est bien différente. Les maladies infectieuses représentent la première cause de mortalité (environ 30 %), loin devant le cancer (environ 15 %) et les maladies cardio-vasculaires (environ 10 %), soit 17 millions de morts sur un total mondial de 57 millions de décès annuels. Étant donné la multiplication des échanges internationaux, les intenses mouvements de population et les bouleversements économiques actuels et prévisibles, les chiffres mondiaux sont de très loin les plus significatifs et démontrent que l’impact des maladies infectieuses n’a finalement pas reculé.
À ce tableau s’ajoute l’effet du réchauffement climatique qui étend le domaine d’activité de certaines infections, jusqu’à maintenant limitées aux régions tropicales. De la même manière, l’apparition ou la réapparition de maladies émergentes pourraient faire des ravages sur des populations immunologiquement non préparées. Ces dernières décennies, à côté du virus du sida, on a ainsi vu apparaître les virus responsables du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), de la grippe H5N1 et H1N1, du chikungunya et de la fièvre hémorragique à virus Ebola, particulièrement meurtrière puisqu’elle tue 50 % des individus infectés. On considère qu’au moins une maladie émergente apparaît tous les ans et on ne peut pas oublier les menaces de « guerre » ou de « terrorisme microbiologique ». Ces nouveaux risques, s’ajoutant aux anciennes maladies, donnent le sentiment que nous sommes face à un combat sans fin, à l’issue incertaine. Dans cette bataille, conjugué avec la lutte environnementale et l’hygiène, le système immunitaire demeure un élément clé susceptible de nous aider à contenir cette pression mortifère pour l’avenir de l’humanité.
Dans le cadre du vocabulaire utilisé dans ce livre, les maladies infectieuses sont toujours le résultat d’une attaque par un ennemi extérieur capable de multiplication dans notre corps. Ces êtres sont regroupés sous le nom de microbes mais sur l’ensemble de ces organismes, très peu sont susceptibles de donner des maladies. Actuellement, 1 420 agents pathogènes pour l’homme ont été identifiés alors qu’il existe plusieurs dizaines de millions de microbes.
Ces chiffres posent de nombreuses questions. Pourquoi des maladies infectieuses ? Quelle est leur place dans l’évolution ? Comment les microbes deviennent-ils pathogènes ? Nous pensons que les réponses à ces questions peuvent se regrouper autour de deux grandes conceptions. L’une dérive de la théorie darwinienne de l’évolution et l’autre s’articule autour d’une vision plus écologiste du monde vivant.
La théorie darwinienne postule que chaque espèce est née par l’acquisition héréditaire d’une caractéristique lui donnant un avantage qui n’existait pas dans l’espèce qui la précédait. Cet avantage se traduit par une capacité à se multiplier plus rapidement et/ou par une fertilité accrue. Quels avantages certains microbes ont-ils tirés en devenant pathogènes pour les animaux ou pour l’homme ? On peut imaginer qu’en tuant leur hôte, ils immobilisent une niche riche en nutriments et qu’en se transmettant d’un individu à un autre, ils « éternisent » cette niche. Dans ce cadre, les maladies infectieuses découleraient de mutations de micro-organismes devenant pathogènes après ces changements génétiques.
Toujours dans le cadre darwinien, l’espèce humaine aurait utilisé les bactéries pathogènes pour ajuster son évolution. Au cours de ces processus, elle aurait adapté le polymorphisme des gènes contrôlant l’efficacité du système immunitaire. Le groupe humain aurait ainsi gardé en permanence un noyau résistant aux pathogènes alors que tous les autres individus demeuraient sensibles. Ces derniers apparaissent alors comme une variable d’ajustement de la densité de la population humaine, s’équilibrant avec l’abondance de la nourriture et la possibilité de se préserver des rigueurs climatiques. De plus, dans le cadre de cette hypothèse, les infections seraient utilisées pour contre-sélectionner les individus les plus faibles et maintenir ainsi le noyau le plus vigoureux assurant la permanence de l’espèce.
À l’opposé, la conception écologiste des maladies infectieuses donne peu de poids aux changements génétiques. Cette vision est essentiellement bâtie sur des observations récentes dérivant de l’étude des maladies infectieuses émergentes et de la connaissance des paramètres conduisant à leur éclosion et à leur propagation. Selon cette conception, il existe un équilibre d’interactions entre l’environnement de l’homme, celui des animaux et des végétaux. Des événements imprévus peuvent engendrer des déséquilibres et créer des conditions biologiques favorables à la transmission à l’homme d’un agent infectieux préexistant. Dans ce cadre, les maladies infectieuses doivent être comprises comme le résultat d’une dynamique complexe intégrant l’adaptation à l’homme des agents infectieux sans changement génétique de ces derniers. Cette dynamique peut découler de conduites humaines, incluant ainsi des dimensions anthropologiques, démographiques et socio-économiques. Il est implicite que cette analyse établie à partir des maladies émergentes peut s’appliquer à toutes les maladies infectieuses, chacune d’entre elles ayant été, en son temps, une maladie émergente.
Le monde des microbes
Étymologiquement, les microbes ou micro-organismes sont des êtres vivants de petite taille qu’on ne peut observer qu’au microscope optique. Cependant, en médecine, on a pris l’habitude de ranger dans cette catégorie de très nombreux organismes pathogènes et d’en rapprocher des parasites visibles à l’œil nu.
LES MICROBES VIVANTS, PATHOGÈNES POUR L’HOMME
Les bactéries sont des organismes vivants unicellulaires dont la multiplication est extrêmement rapide. Ainsi les bactéries pathogènes peuvent-elles, dans un temps record, envahir un organe ou le corps entier et empêcher son bon fonctionnement. Les bactéries peuvent sécréter des produits délétères appelés toxines. Certaines d’entre elles, les endotoxines, ne sont libérées qu’après la lyse des corps bactériens. Parmi les bactéries les plus connues on compte le pneumocoque, le méningocoque, le staphylocoque responsable de diverses maladies. Le streptocoque responsable d’angine, le colibacille responsable d’infections urinaires ou intestinales et le bacille de Koch responsable de la très grave épidémie de tuberculose sont également très répandus. Dans certaines conditions qui leur sont défavorables, certaines bactéries arrêtent leur multiplication et se transforment en spores extrêmement résistantes, qui peuvent survivre des milliers d’années comme celles du bacille du tétanos.
Les parasites comprennent deux groupes d’espèces. Les protozoaires se présentent sous la forme d’une cellule unique. Parmi ces protozoaires, on range par exemple les amibes donnant de graves dysenteries et les Plasmodium qui donnent le paludisme. Au contraire, les métazoaires sont des êtres vivants pluricellulaires, parfois de grande taille, parmi lesquels les vers parasites tiennent une place importante. Parmi ces vers, les schistosomes provoquent la bilharziose, la seconde endémie parasitaire après le paludisme. Les vers filaires sont responsables de maladies variées comme la loase, la « cécité des rivières » ou les filiaroses lymphatiques engendrant parfois le spectaculaire éléphantiasis dans lequel certains membres deviennent énormes par blocage du retour de la lymphe, le ver s’étant introduit dans un des canaux lymphatiques. Dans nos contrées la pathogénicité de vers comme le ténia ou l’ascaris s’exerce par la gêne qu’ils infligent au bon fonctionnement intestinal et par le détournement de l’alimentation.
Enfin, parmi les microbes vivants, on compte les agents provoquant différentes pathologies regroupées sous le terme de « mycoses ». Certains de ces organismes unicellulaires sont des levures comme Candida albicans ou les cryptocoques. D’autres sont des champignons microscopiques à filaments, comme Aspergillus. Les mycoses peuvent être superficielles ou profondes, ces dernières mettant souvent en jeu la vie du patient.
VIRUS ET PRIONS, INERTES MAIS INFECTIEUX
Les virus existent sous deux formes. Dans l’état extracellulaire, ce sont des objets particulaires dormants. Au contraire, dans l’état intracellulaire, ils deviennent des éléments génétiques qui peuvent se multiplier, indépendamment des chromosomes de l’hôte, en détournant sa machinerie à leur profit. Les virus sont donc des parasites intracellulaires obligatoires qui exercent leurs effets pathogènes par la destruction des cellules cibles. Chaque cellule infectée libère des milliers de particules virales, ce qui rend la progression d’une infection virale spectaculairement rapide. Parmi les virus, ceux qui provoquent la grippe, les hépatites, la rougeole sont bien connus de même que celui de la varicelle qui est aussi responsable du zona. Nous parlerons du virus du sida au chapitre XII.
Les prions sont des agents pathogènes sans matériel génétique. Chez l’homme, le plus connu est représenté par une protéine ayant adopté une conformation anormale. La protéine normale Prp-c est impliquée dans des fonctions essentielles à la vie des cellules. La protéine anormale Prp-sc, ne pouvant être éliminée, s’accumule dans les neurones et provoque leur mort. De plus, l’exposition à Prp-sc entraîne progressivement la transformation de toutes les protéines normales en protéines anormales et entraîne lentement une dégénérescence globale du système nerveux. Les maladies humaines correspondantes sont le kuru, rencontré en Nouvelle-Guinée, et la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
LA RELATION HÔTE-AGENTS PATHOGÈNES :
VIRULENCE CONTRE DÉFENSES
Les agents pathogènes sont les microbes responsables d’une maladie après infection d’un sujet en bonne santé. Le pouvoir pathogène d’un microbe se définit donc par la maladie qu’il engendre et qui lui est spécifique. Pour certains microbes, le pouvoir pathogène est un potentiel qui ne se révèle qu’avec certaines caractéristiques de l’hôte comme dans le cas des infections opportunistes.
Pour chaque microbe, le pouvoir pathogène est une notion qualitative alors que la virulence est une notion quantitative. Le pouvoir pathogène du pneumocoque est lié à sa capacité à coloniser les poumons, celui du colibacille à celle d’infecter les voies urinaires ou les intestins. Pour une même espèce microbienne, il peut y avoir des souches également pathogènes mais plus ou moins virulentes. La virulence se mesure par le nombre de microbes nécessaires pour provoquer la maladie. Plus ce nombre est faible, plus la virulence est élevée.
La pathogénicité d’un microbe est essentiellement conditionnée par son tropisme, c’est-à-dire sa capacité à se lier aux cellules de certains organes, définissant ainsi sa porte d’entrée et la plupart des caractéristiques de la maladie qui s’ensuit. Pour les bactéries, cela implique un mécanisme d’adhésion alors que pour les virus la liaison avec un récepteur spécifique de la surface cellulaire est la règle. Au niveau de la porte d’entrée, la colonisation de l’hôte achevée, plusieurs types de pouvoir pathogène peuvent se manifester. Ce pouvoir s’exprime d’abord par le déclenchement d’une réaction inflammatoire locale, secondaire à la multiplication du microbe et à la stimulation des défenses innées, l’ensemble signant la maladie : infection pulmonaire, infection urinaire, infection sur cathéter, etc. Le devenir de la maladie dépend ensuite de l’évolution de cette réaction inflammatoire. En amplifiant les défenses innées et en initiant les réactions de l’immunité adaptative elle peut faire avorter l’infection. Mais si le microbe n’est pas neutralisé, sa pathogénicité se développe par l’accroissement et le prolongement des réactions inflammatoires qui passent de leurs actions positives vers leurs effets pathologiques. La pathogénicité peut aussi se manifester par la diffusion de toxines. Parmi les plus connues, la toxine du choléra responsable des diarrhées entraînant la déshydratation, la toxine de la coqueluche responsable de la toux quinteuse et la toxine tétanique, responsable des contractions musculaires mortelles. Parmi ces toxines, il existe aussi des enzymes qui dégradent les tissus et créent des nécroses. De plus, à partir de cette porte d’entrée on peut avoir des localisations secondaires (endocardites, ostéites, etc.) ou une généralisation de l’infection (septicémie) qui évidemment aggravent la pathogénicité du microbe impliqué.
Parmi les paramètres accroissant la virulence, sont incluses toutes les parades que peuvent développer les microbes en vue de neutraliser les défenses de l’hôte. Certaines bactéries, comme les pneumocoques, peuvent synthétiser une capsule épaisse qui les enveloppe largement et empêche la phagocytose. Des protozoaires, comme Plasmodium falciparum, peuvent échapper aux réponses immunes spécifiques par le mécanisme de variation antigénique. Chez eux, pour un antigène de surface donné, il existe plusieurs gènes. Lorsque la réponse immune s’est développée contre le produit d’un de ces gènes, le parasite mute et fait apparaître un nouvel antigène de surface contre lequel le système immunitaire n’est pas préparé. Plasmodium falciparum comprend ainsi une cinquantaine de variantes antigéniques utilisables séquentiellement, ce qui lui permet d’échapper à la plupart des réponses de défense de l’hôte. Enfin, certains virus comme les agents de l’herpès ayant capté des gènes humains, codant pour des interleukines et des récepteurs d’interleukines, peuvent neutraliser quelques mécanismes de l’immunité pour favoriser leur propre multiplication.
Une mention particulière doit être faite pour les infections opportunistes. Elles concernent des microbes qui ne donnent pas de maladie sur des sujets sains mais deviennent pathogènes chez des sujets immunodéprimés comme peuvent l’être des patients traités par chimiothérapie ou des patients infectés par le virus de l’immunodéficience humaine ou VIH.
Le développement des infections
et le cinquième principe
Lors de la présentation générale du système immunitaire (chapitre III), nous avons expliqué les cinq principes généraux régissant son organisation. Le cinquième principe fait état d’un équilibre entre le système immunitaire individuel et le système immunitaire collectif. Il prévoit que cet équilibre gouverne la progression de toutes les maladies découlant de l’action d’un agent transmissible (maladies infectieuses et certains cancers).
LES RÉSERVOIRS DE MALADIES INFECTIEUSES
De nombreuses maladies infectieuses utilisent un réservoir dans lequel le microbe est stocké, quelquefois de manière inapparente. Dans le cas d...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Dédicace
- Dédicace
- Présentation générale
- PREMIÈRE PARTIE. Mécanismes de fonctionnement
- DEUXIÈME PARTIE. Système immunitaire et pathologie
- TROISIÈME PARTIE. Les grands défis thérapeutiques
- Conclusion
- Glossaire
- Remerciements
- Table
- Du même auteur
- 4e de couverture