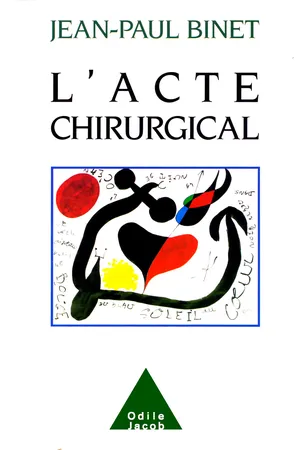
- 304 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
L' Acte chirurgical
À propos de ce livre
Un des grands noms de la chirurgie cardiovasculaire, Jean-Paul Binet, a voulu embrasser sa discipline dans sa généralité (le travail de la main), mais aussi en montrer la prodigieuse diversité, les progrès et les transformations. À le suivre, le lecteur est invité à dépasser le sentiment mêlé de fascination et d'effroi qu'inspire parfois cette branche de la médecine. Membre des Académies de médecine et de chirurgie, correspondant de l'Académie des sciences, Jean-Paul Binet exerce au Centre chirurgical Marie-Lannelongue.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L' Acte chirurgical par Jean-Paul Binet en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Médecine et Chirurgie et médecine chirurgicale. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
Une histoire de l’acte chirurgical
La naissance de la chirurgie actuelle est toute récente. Elle date du moment où furent généralisés, après l’anesthésie, l’antisepsie et l’asepsie, l’usage de la transfusion sanguine et la pratique de la réanimation, c’est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Mais l’histoire de l’acte chirurgical remonte, sans doute, à l’origine même de l’homme. Ce n’est pas faire preuve de grande imagination que de dire qu’elle fut faite de nécessités traitées : blessures suturées, suppurations ouvertes et fractures immobilisées. On pourrait résumer en disant que, pendant des siècles et sans doute des millénaires, l’acte chirurgical tint plus au rêve qui allait se réaliser qu’à la réalité du moment. Plus certainement, on peut affirmer qu’il n’y a pas eu d’acte chirurgical, tel qu’on l’entend aujourd’hui, pendant des millions d’années.
C’est par acharnement, on pourrait dire aussi par souci ou par manie, qu’on a voulu chercher dans l’histoire des diverses civilisations quelque chose se rapprochant de ce qui allait être beaucoup plus tard notre art.
Nous sommes si familiarisés avec la marche régulière du progrès depuis le début de ce siècle qu’elle nous paraît un phénomène normal et qui a toujours existé. Or, il n’y a pas synchronisation obligatoire entre la marche du temps et la mise au point d’une technique. Comment pourrions-nous autrement concevoir que pendant des siècles, que dis-je, pendant des millénaires, des hommes faits comme nous, affrontés aux mêmes problèmes que nous, ont erré dans ce domaine presque sans résultat et n’ont pu que transmettre pieusement le maigre acquis de prédécesseurs immémoriaux ? C’est pourtant ce qui s’est passé en médecine et plus clairement encore dans cette partie de la médecine qui en était la plus hardie par la force des choses : la chirurgie. C’est seulement à partir de la fin du siècle dernier qu’elle a pu prendre l’essor impressionnant qui la porte encore aujourd’hui de conquête en conquête… Mais tout conduit à croire que la chirurgie qui aujourd’hui nous paraît triomphante aura tellement changé d’ici une vingtaine d’années, dans sa gestuelle, sa pratique et ses indications, que renaissant, nous ne la reconnaîtrions plus. Ce n’est pas dire qu’elle est en train de disparaître : la Roche Tarpéienne n’est pas le chemin obligatoire qui mènerait du Capitole à notre toute nouvelle Pyramide du Louvre.
Dans le rappel du passé, on pourrait sans inconvénient sauter du déluge aux premiers traités de chirurgie dignes de ce nom : ceux qu’ont élaborés les Grecs ; il n’y a aucun puzzle, ni historique ni géographique, à reconstituer. Mais ce serait se priver de quelques faits historiquement certains, si étonnants que l’on en vient à se demander comment le progrès chirurgical n’est pas venu plus tôt.
Les origines
On a trouvé dans les gisements préhistoriques des crânes d’adultes et aussi d’enfants trépanés, datant de l’époque néolithique, c’est-à-dire entre 5 000 et 2 000 ans avant notre ère : ces trépanations furent faites avec le silex, sur le vivant. Si l’on tend à penser qu’elles furent des mutilations à but initiatique ou magique, on se demande comment elles n’ont pas tué car elles ont cicatrisé.
Les fresques pharaoniques et surtout trois papyrus (Brush, Eberg et Smith) ont révélé que les Égyptiens connaissaient l’anatomie par la pratique de l’embaumement et de la momification. Mieux, le papyrus de Smith ressemble à un précis de thérapeutique dans lequel l’acte chirurgical n’est pas exclu. Tant et si bien que Dominique Larrey, dans l’ardeur de la découverte, interpréta certains hiéroglyphes en forme de membres comme les témoins d’amputations pratiquées, alors que ce n’étaient que signes d’alphabet.
On peut s’étonner, dans les civilisations sumérienne et chaldéenne, que l’on parle d’honoraires de santé en cas d’acte (sans doute de para-chirurgie) réussi, mais aussi de châtiment corporel en cas d’échec.
On ne peut s’étonner, en revanche, que l’antique civilisation chinoise ait préféré l’aiguille à l’instrument tranchant et que les principes mêmes de l’acupuncture, connue depuis des temps immémoriaux, y aient été adoptés : de multiples aiguilles atraumatiques et bien placées peuvent à moindre danger et pour moins de douleur, remplacer la lame sanglante. C’était inscrit dans le plus ancien traité médical, le Nei King, œuvre voulue par l’Empereur Jaune, écrit sans doute en 300 avant Jésus-Christ, réédité en cinquante éditions successives en vingt siècles. Mieux et jusqu’à cette époque récente, la pratique de la chirurgie était pratiquement proscrite tant l’accent, depuis la haute Antiquité, était mis plus sur la prévention des maladies quelles qu’elles soient, que sur leur guérison.
Tout autre fut la chirurgie hindoue, dont l’existence nous est rapportée par Charaka et Susruta qui vécurent aux Ier et Ve siècles après Jésus-Christ mais qui racontent parfaitement ce qui s’est passé chez eux avant notre ère. Leur apport est vraiment considérable ; il faut le détailler :
- L’usage des narcotiques (jusquiame, chanvre indien).
- L’existence d’instruments de chirurgie : on en compte 121 + 1, le 122e étant la main du chirurgien ! Ces instruments avaient tous été dessinés et portent tous des noms évocateurs. Quel luxe, en effet, dans l’art de couper, d’ouvrir ou de découper puisqu’ils avaient inventé toutes sortes de couteaux : couteau à un tranchant, couteau à pointe débordante, couteau-alène, couteau crochet, couteau en pointe de dent, couteau à examen, ciseaux dirigés vers l’intérieur, couteau en feuille d’herbe kusa, couteau à bout recourbé, couteau en forme de sceau, couteau en forme d’ongle, couteau en bec de héron, couteau à pointe triangulaire, couteau en feuille de lotus, couteau en feuille de roseau, couteau à pointe de grain de riz, couteau à lame coupante.
- La pratique de toutes sortes de chirurgie, telle la chirurgie réparatrice du nez, mise au point pour réparer les nez amputés, comme c’était la coutume chez les prisonniers de guerre.
- La pratique d’une chirurgie inconnue des grecs à l’époque (la réparation des hernies et même la taille périnéale).
- L’usage des agrafes vivantes : des fourmis dont les pinces agrippaient le bord de la peau et qui étaient ensuite soigneusement décapitées.
On reste médusé par ces écrits qui font de l’Inde le plus ancien pays chirurgical du monde… et il n’y a aucune raison de douter de leur véracité.
Il est difficile de parler de la chirurgie précolombienne puisqu’on n’en a pas gardé de trace, l’invasion espagnole après Christophe Colomb (XVIe siècle) ayant détruit tous les documents relatifs à ce sujet. Il semble bien cependant (mais quand ?) que les médecins usaient de plantes pour insensibiliser en enivrant, qu’ils découvrirent l’emplâtre pour immobiliser les fractures, le cheveu pour suturer les plaies. Mais, peut-être est-ce légende, tout comme le sacrifice des médecins du premier magistrat de Michuaca qui, bien soigné, n’eût pas dû mourir, ou comme les deux dieux Anomococipactonal et Tlatecuinxochicauca qui auraient inventé l’acte médico-chirurgical…
Il faut en venir au « miracle grec ». Comme Shakespeare, comme Homère, on peut se demander si Hippocrate a bien existé et s’il s’agit d’un homme ou de toute une école. Mais l’œuvre est là et elle est impressionnante. Celui auquel elle doit son nom serait né dans l’île de Cos, vers 460 avant Jésus-Christ ; il appartenait aux Asclépiades, descendants d’Asclépios (l’Esculape des Romains). Si les soixante-douze livres qui forment le Corpus Hippocraticum sont trop peu homogènes pour ne pas être le résultat d’une vaste compilation, ils n’en traduisent pas moins, dans l’ensemble, une même conception de la médecine qui est étonnamment actuelle : démystification des maladies au mépris des superstitions ancestrales qui voyaient en elles l’œuvre de puissances surnaturelles et qui invitaient donc aux pratiques magiques, méthodes positives dans l’observation et l’interprétation comme seul moyen de comprendre sinon toujours de guérir.
Marquent la naissance de ce qui sera l’acte chirurgical : « De l’officine du médecin », « Des fractures », « Des plaies de la tête », « Des articulations et des luxations », « Des ulcères » et « Des fistules ». On y trouve, avec stupéfaction, la technique de trépanation et ses indications, la technique d’évacuation des pleurésies purulentes au moyen du fer et du feu, enfin les techniques de réduction des plus fréquentes fractures ou luxations des membres et même des vertèbres, à l’aide de treuils, leviers et coins, appareils qui furent employés presque tels quels pendant des siècles.
Hippocrate mourut, paraît-il, plus que centenaire, en 365 avant Jésus-Christ. Il est l’origine, en tout cas le symbole, d’une véritable révolution dont le résultat fut la division de la médecine : l’une dite diététique, une autre dite pharmaceutique par les médicaments, la troisième qu’on appela chirurgicale par le travail de la main. C’était, en quelque sorte, le baptême de la chirurgie. Il est juste qu’il ait été reconnu jusqu’à nous comme le « Père de la Médecine ». C’est devant son effigie que tout futur médecin et donc tout futur chirurgien, dans tous les pays, prête le serment d’exercer son métier en respectant l’éthique dont il a fixé les normes. Il est aujourd’hui abrégé, pour ne pas dire tronqué : en voici l’original, à tout point de vue bien plus éloquent.
1. Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie, par Panacée, par tous les Dieux et toutes les Déesses, les prenant à témoin, que je satisferai pleinement, selon mon pouvoir et mon jugement, à ce serment et à ce contrat.
2. [Je jure] de considérer celui qui va m’enseigner l’art [médical] à l’égal de mes parents, de partager ma vie avec lui, de pourvoir à ses besoins s’il est dans la nécessité, de tenir ses enfants pour des frères dans la lignée mâle et de leur enseigner cet art s’ils désirent l’apprendre, sans rétribution ni contrat, de pourvoir de préceptes, de leçons orales et de tout le reste de l’enseignement, mes fils, ceux de mon maître et les disciples [venus de l’extérieur] liés par contrat et serment selon la coutume médicale, mais nul autre [en dehors d’eux].
3. Je prescrirai le régime pour le bienfait des malades selon mon pouvoir et mon jugement, mais les protégerai contre la malveillance et l’injustice.
4. Jamais je ne donnerai de médicament mortel à qui m’en demandera, ni ne prendrai l’initiative d’une telle suggestion ; pareillement, je ne donnerai à aucune femme de pessaire abortif.
5. Dans la pureté et la droiture, je maintiendrai ma vie et mon art.
6. Jamais je ne taillerai ceux qui ont la pierre [les calculs vésicaux], mais je les refoulerai vers les maîtres familiers de cette pratique.
7. Dans quelque maison que j’aille, j’entrerai pour le bienfait des malades, m’abstenant de toute injustice volontaire, d’autres forfaits et de toute tentative de séduction, envers les femmes et les hommes libres ou esclaves.
8. Quoi que je voie ou entende dire dans la société pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui ne doit pas être divulgué, le regardant comme un secret inviolable.
9. Or donc, si je satisfais pleinement à ce serment et ne faillis point, puissé-je jouir de la vie et de mon art, honoré de tous les hommes à perpétuité ; mais si je viole et me parjure, que tout le contraire m’arrive !
Mais l’apport grec ne fut pas seulement celui des traités hippocratiques. Il existait avant. L’Iliade (VIe siècle av. J.-C.) est le récit des batailles de la guerre de Troie qui mêle les dieux et les hommes ; on est surpris d’y trouver une description topographique si précise des blessures que l’on peut en tirer une statistique de gravité. Sous le nom d’Homère se cache peut-être un « thérapeute »1. Par ailleurs, les sanctuaires (Épidaure) et les « dieux foudroyants ou foudroyés » (Asclépios) n’étaient pas faits que pour les miracles. Ils initiaient à une certaine médecine voire une certaine chirurgie dont l’école de Cnide est un premier exemple. L’apport grec se manifeste aussi après Hippocrate : tout ce qu’il y avait de connu et d’écrit sur la médecine fut rassemblé à Alexandrie, dans la fameuse bibliothèque créée par Ptolémée Philadelphe. Ce qu’il y avait de chirurgical dans les sept cent mille volumes réunis, ne tenait sans doute qu’en quelques livres. Ils inspirèrent Hérophile et Érasistrate qui vécurent dans les mêmes années (IIIe siècle av. J.-C.) et qui furent fondateurs d’écoles rivales mais complémentaires. L’un ou l’autre firent-ils de la vivisection sur des condamnés à mort ? On n’en est pas sûr. Mais ils enrichirent la médecine grecque par les découvertes qu’ils firent sur l’anatomie du cerveau, du cœur et de l’appareil pulmonaire.
Un peu plus tard (30 apr. J.-C.), dans cette même ville d’Alexandrie, Cornelius Celse a vécu et a été illustre : son De Arte Medica n’est pas qu’une compilation puisqu’il y décrit, notamment, les plaies de l’abdomen et de l’intestin et surtout la ligature des vaisseaux blessés. Par ailleurs, il esquissa le premier portrait idéal du chirurgien : « Il doit être jeune ou du moins assez voisin de la jeunesse ; il faut qu’il ait la main prompte, ferme, jamais tremblante, la gauche non moins habile que la droite ; la vue nette et perçante ; l’aspect hardi ; le cœur assez compatissant pour vouloir la guérison de son malade, mais non au point de mettre, sous l’émotion de ses cris, plus de précipitation que la circonstance ne le comporte ou de moins découper que le cas l’exige ; en un mot : il doit tout faire comme si les gémissements du patient ne l’impressionnaient pas. »
Il n’est pas étonnant que Rome n’apporte à ce tableau d’honneur qu’un seul nom : Galénos, Galien (IIe siècle apr. J.-C.), qui pressentit le fait de la circulation sanguine au milieu de notions de physiologie erronées. Personnage curieux que ce Galien ! Instruit de tout, voyageur itinérant, chirurgien par occasion, médecin de trois empereurs, son nom est le dernier de ces « phénomènes » de l’avant-médecine ou chirurgie de cette époque. La réponse est simple : pour le Romain, exercer médecine ou chirurgie n’était pas conforme à la dignité du citoyen : « C’était un métier d’esclave au même titre que les porteurs d’eau, les gens de maison2. » César puis Auguste élevèrent au rang de citoyens certains praticiens gréco-romains qui les avaient soignés, mais c’était une façon de les remercier par une promotion de gratitude et non de qualification.
Rome, à vrai dire, fut bientôt l’Empire romain avec ses conquêtes et aussi l’armée romaine, qui se battait, souvent bien et loin. Seize siècles avant Napoléon, les conquérants comprirent qu’à une armée de métier il fallait des professionnels de santé, d’où la création d’un véritable service de santé militaire à raison d’un médecin par cohorte de mille soldats et la création des premiers hôpitaux de campagne. Il est vraiment dommage que ces premiers médecins-chirurgiens n’aient laissé aucun écrit sur ce qu’ils furent et ce qu’ils pratiquèrent. Il ne nous reste rien de ce premier corps de santé que des fragments d’instruments de bronze retrouvés dans ce qui furent les marches de l’Empire… tous identiques ou presque à ces panoplies médico-chirurgicales, que les cendres du Vésuve, ayant enfoui en 79 après notre ère Herculanum et Pompéi, allaient nous livrer intactes, dix-huit siècles plus tard !
Les invasions barbares mirent fin à ce qui avait si bien commencé. Encore est-il heureux que tout n’ait pas été définitivement perdu et ...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Du même auteur
- Copyright
- Dédicace
- Introduction
- Chapitre 1 - Une histoire de l’acte chirurgical
- Chapitre 2 - La main pensante
- Chapitre 3 - L’arbre de la chirurgie
- Chapitre 4 - Les compagnons du chirurgien
- Chapitre 5 - Une autre chirurgie ?
- Chapitre 6 - L’hôpital et le chirurgien
- Chapitre 7 - Dialogue avec l’opéré
- Conclusions
- Table