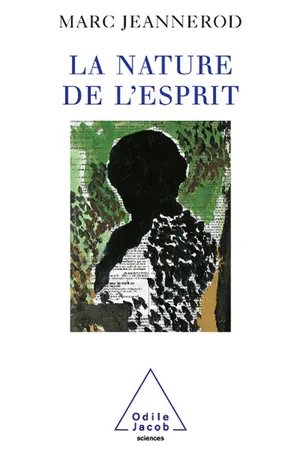
- 256 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
La Nature de l'esprit
À propos de ce livre
Les sciences cognitives se proposent de " naturaliser l'esprit ". Quel est le sens de ce projet ? Nos connaissances sur le cerveau permettent-elles de le réaliser ? Pour répondre à ces questions, Marc Jeannerod prend des exemples comme la biologie des émotions, l'apparition du langage ou les mécanismes de la communication entre les individus. À travers eux, il présente la découverte la plus récente des sciences cognitives : les neurones miroirs, mobilisés aussi bien par la réalisation que par la représentation de l'action. Cette introduction à l'une des grandes révolutions scientifiques de notre temps expose aussi ses implications cliniques, notamment pour la compréhension de maladies comme la schizophrénie ou l'autisme. Marc Jeannerod est professeur de physiologie à l'université Claude-Bernard-Lyon-I et directeur de l'Institut des sciences cognitives.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à La Nature de l'esprit par Marc Jeannerod en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences biologiques et Neurosciences. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
PREMIÈRE PARTIE
L’ancrage biologique de la cognition
Chapitre premier
NATURALISER LA COGNITION
Ce premier chapitre fournit des détails historiques sur la genèse de l’idée de sciences cognitives et montre les interactions précoces de cette idée nouvelle avec les sciences du vivant. Le contexte scientifique de cette époque, en particulier dans le domaine des sciences du système nerveux (le terme de neurosciences n’a été utilisé que plus tard, après 19701), a d’abord été dominé par la métaphore de l’ordinateur. Même si cette métaphore a été clairement rejetée par la suite, c’est peut-être là une des sources du malentendu persistant de la part des adversaires des sciences cognitives, qui n’ont pas su voir cette évolution et qui persistent à croire que les sciences cognitives considèrent toujours l’esprit comme un programme de calcul dans une machine détachée de la réalité. À une certaine époque, en effet, l’objectif était d’identifier les règles de fonctionnement de machines, idéales ou réelles, artificielles ou vivantes, susceptibles de traiter de l’information. Le neuropsychologue Karl Lashley, au cours d’une des réunions fondatrices des sciences cognitives, avait énoncé une espèce de profession de foi à laquelle il avait demandé à tous les participants d’adhérer : « Tous les phénomènes du comportement et de l’esprit peuvent et doivent être décrits en termes de mathématiques et de physique2. »
La vision actuelle est bien différente. Ces règles, qui semblaient opérationnelles pour résoudre les problèmes du linguiste, du spécialiste de l’intelligence artificielle ou du roboticien, ne sont pas celles de notre langage, de notre mémoire, de la programmation de nos mouvements ou de notre perception des objets. En d’autres termes, l’analyse de règles permettant à des machines créées par l’être humain de fonctionner ne nous rapproche pas de la connaissance des règles naturelles qu’utilise le cerveau, une machine que nous n’avons pas créée. Ces règles, artificielles ou naturelles, ont pourtant bien au moins un point commun puisque le cerveau de l’ingénieur qui construit une machine ne devrait pouvoir utiliser d’autres règles que celles à partir desquelles il est lui-même construit ! Le texte qui suit aborde ces problèmes et pose du même coup les bases d’une naturalisation de la cognition.
La révolution cognitive
Reportons-nous une soixantaine d’années en arrière, au moment où les sciences cognitives naissantes se donnaient pour objectif de réaliser la simulation de l’intelligence naturelle par des machines, et donc de parvenir à la production d’une intelligence artificielle3. L’enjeu de cette entreprise était radical : si la production de la machine simule l’œuvre de la nature au point qu’on ne peut les distinguer l’une de l’autre, c’est que le cerveau n’est qu’une machine parmi d’autres et que la pensée, l’intelligence, la connaissance, en un mot la cognition, sont indépendantes des systèmes, biologiques ou non, qui les produisent.
L’idée fondatrice était alors que penser, c’est calculer ; que calculer, c’est manipuler des symboles ; et donc, que la pensée est une activité symbolique détachée de la réalité biologique. On en arrive, par cet enchaînement logique, à assimiler dans une même catégorie la cognition artificielle, résultat du fonctionnement d’ordinateurs, et la cognition naturelle, qui résulte du fonctionnement de cerveaux : l’une et l’autre sont les produits de « machines pensantes », c’est-à-dire d’ensembles physico-mathématiques doués de la propriété de manipuler des symboles.
On peut rappeler brièvement les expériences de salon qui ont marqué ce débat. Tel est par exemple le jeu de l’imitation imaginé par Alan Turing. Le jeu se joue à trois : une machine, un être humain, un observateur. L’observateur pose des questions et observe les réponses de la machine ou de l’être humain qui lui sont transmises par un écran d’ordinateur. Si l’observateur ne peut distinguer la réponse donnée par la machine de celle donnée par l’être humain, c’est que la machine a parfaitement simulé le comportement de l’être humain et donc qu’elle a gagné (test de Turing) ; et, si la machine gagne, sa victoire démontre que la pensée est bien une manipulation de symboles par une machine quelconque, cerveau ou autre.
À l’opposé, John Searle répondait par le jeu de la chambre chinoise qui se joue également à trois : un sujet est dans une pièce fermée, avec des caractères chinois qu’il ne connaît pas mais qu’il peut identifier par leur forme. Il dispose aussi d’une règle qui lui indique la séquence de caractères qu’il doit produire en réponse à chaque séquence qu’un observateur extérieur lui transmet. Il manipule des symboles sans les comprendre et pourtant ses réponses sont jugées pertinentes par un Chinois qui le confond avec un vrai Chinois. Bien que le sujet réussisse le test de Turing, il ne pense pas pour autant : manipuler des symboles n’est donc pas penser4.
La comparaison entre cerveau et ordinateur n’est pas pertinente
L’assimilation étroite entre cognition naturelle et cognition artificielle, parmi d’autres obstacles épistémologiques, rencontre aussi celui des « réalisations multiples ». Le fait qu’il existe en général plusieurs façons de résoudre un problème donné n’implique pas que, si deux systèmes aboutissent au même résultat, ils sont identiques ni même qu’ils fonctionnent suivant les mêmes principes. Le fait que le cerveau et l’ordinateur parviennent à résoudre le même problème n’implique donc pas qu’ils utilisent les mêmes moyens, ni que le cerveau parvient à la solution en manipulant des symboles abstraits.
Cette notion de réalisations multiples soulève une difficulté potentielle lorsqu’on cherche à établir une corrélation entre un état cérébral et un état mental. Les deux types d’états, en effet, sont loin d’être compatibles entre eux. Les états cérébraux présentent une complexité intrinsèque incomparablement plus grande que l’état mental correspondant : ils résultent d’interactions entre un très grand nombre d’éléments (neurones, synapses, récepteurs, etc.), qui ne sont pas représentés individuellement au niveau mental. On ne peut que faire l’hypothèse que les productions mentales qui sont la conséquence du fonctionnement cérébral intègrent ces aspects élémentaires du fonctionnement cérébral et ne reflètent pas de manière détaillée les mécanismes sous-jacents. Pour prendre un exemple, un mouvement quelconque du bras est le résultat de l’activité d’un grand nombre de neurones et de fibres musculaires, dont l’expression individuelle est fondue dans la trajectoire du bras. On n’a pourtant pas de difficulté à admettre que le mouvement est coextensif de ces activités élémentaires simultanées : c’est la façon dont se manifestent ces activités élémentaires lorsqu’on examine les effecteurs du système moteur, de même que l’état mental est la façon dont se manifeste l’activité des multiples éléments qui constituent l’état cérébral lorsqu’on examine son fonctionnement au niveau cognitif5.
Le fait est que la comparaison entre cerveau et ordinateur révèle plus de différences que de similitudes. En effet, les ordinateurs fonctionnent sur le principe du tout ou rien, en alignant très rapidement des symboles digitaux (0 ou 1) produits par des circuits intégrés. Dans le cerveau, en revanche, l’information est le produit de l’intégration d’une multitude de variables physico-chimiques – des courants ioniques traversant les canaux de la membrane des neurones. L’activité d’un neurone qui résulte de ces courants ioniques est bien, dans une certaine mesure, du type tout ou rien, mais le neurone n’est pas isolé, il fonctionne au sein de populations où de nombreux éléments agissent en parallèle. Le résultat final de ce traitement est donc de nature probabiliste. Des modèles physiques plus réalistes du traitement neuronal ont été imaginés récemment : ce sont les modèles connexionnistes qui possèdent certaines des caractéristiques du réseau nerveux biologique, en particulier celle de traiter l’information selon des voies parallèles (on parle de réseaux « neuromimétiques »). Leur existence même, toutefois, et le fait qu’ils sont éventuellement capables de donner des réponses à des questions cognitives sont en contradiction avec la notion de traitement symbolique, fondé sur un traitement séquentiel, qui représente l’attribut principal du traitement de l’information dans la version cognitiviste classique. Le fonctionnement même de ces réseaux s’inspire d’ailleurs des connaissances acquises au cours des dernières décennies sur le fonctionnement du système nerveux : traitement de type analogique plutôt que digital, importance de l’organisation spatiale, introduction de la notion de « poids synaptique » pour rendre compte d’un filtrage partiel des informations au niveau des connexions, autant de caractéristiques qui distinguent définitivement ces réseaux du mode de fonctionnement des ordinateurs classiques. La question est de savoir si ces machines parviendront, à terme, à un niveau de cognition comparable à celui de la cognition naturelle. Tout le problème de l’analogie entre le cerveau et l’ordinateur est dans la nature de l’ordinateur dont on parle : s’agira-t-il un jour de machines plus molles, plus humides, de machines de l’ère des biotechnologies ? Cette analogie est-elle un des avatars de la technologie momentanément dominante ? Le cerveau a toujours été, et il est encore, le point sensible du discours technologique sur l’être humain : système hydraulique pour Descartes, central téléphonique pour Bergson, ordinateur il y a peu… Réservons-nous la possibilité que le cerveau soit en attente de l’analogie avec une machine qui n’existe pas encore, mais sera peut-être construite un jour.
Pour éclairer ce débat futur, il est bon de rappeler un certain nombre de dimensions fonctionnelles qui font la spécificité de la cognition naturelle et de son support biologique. Cette énumération est importante dans la mesure où elle révèle des propriétés qui sont par nature étrangères au monde de la cognition artificielle :
1. L’activité du système nerveux peut être représentée comme les contours d’une carte à plusieurs dimensions plutôt que comme une séquence de symboles. La localisation des phénomènes au sein du réseau a une grande importance, elle est invariante d’un sujet à l’autre, alors que, pour le fonctionnement d’une machine symbolique, l’emplacement où les opérations séquentielles se déroulent est sans importance.
2. Le cerveau fait partie d’un ensemble d’organes, d’un organisme. Le cerveau pilote l’organisme et reçoit de lui, non seulement son alimentation énergétique, mais de nombreuses informations. L’ordinateur n’a pas de corps (un pur esprit ?), il a seulement une alimentation électrique qui lui permet de fonctionner. Cette relation du cerveau avec le corps est la source d’informations particulières, qui créent un contexte individuel dans lequel s’inscrivent l’ensemble des informations venues du monde extérieur par l’intermédiaire des organes des sens, et du monde intérieur par l’intermédiaire des signaux végétatifs et humoraux.
3. Le fonctionnement d’un cerveau est le résultat d’une histoire telle que deux cerveaux ne sont jamais les mêmes, non seulement du fait qu’ils procèdent de deux génomes différents, mais aussi du fait de leur appartenance à deux vies, deux histoires, deux expériences. Le cerveau retient une partie de cette histoire sous forme de mémoire, où il puise des éléments lors de la construction d’une représentation. Deux ordinateurs identiques programmés de la même façon seraient des clones totalement interchangeables.
4. Le cerveau fonctionne dans un réseau qui comprend d’autres cerveaux. L’intersubjectivité, le fait que nous sommes en communication avec d’autres individus, est une dimension fondamentale de notre fonctionnement, dès la vie embryonnaire. Au cours de la vie, le cerveau est dans un nœud de relations avec ceux d’autres individus. Notre système nerveux est d’ailleurs équipé de mécanismes spécifiques très sensibles pour décoder les signaux qui nous proviennent d’autres êtres vivants, et en particulier de congénères. Parmi ces mécanismes, on peut citer à titre d’exemple ceux qui nous permettent de reconnaître les visages et de détecter les expressions faciales, ou encore ceux qui permettent de différencier les mouvements qui appartiennent à une forme vivante de ceux qui sont produits par un système mécanique. La troisième partie de ce livre est consacrée à ce problème de la « cognition sociale ».
Cognition et propriétés émergentes
L’histoire du mouvement cognitiviste nous apprend que, dès les années fondatrices, existait une forte interpénétration entre les sciences mathématiques et physiques et la biologie. La première révolution cognitive, celle de la cybernétique, était, pour partie, une tentative d’intégration de concepts biologiques avec ceux qui provenaient de diverses théories mathématiques, comme la théorie de l’information. Les biologistes étaient d’ailleurs fortement présents dans ces débats : parmi les participants aux réunions fondatrices (les Conférences Macy), on rencontrait des neurologues comme Warren McCuloch, des anatomistes comme von Bonin ou des physiologistes comme Ralph Gerard, Lorente de No ou Heinrich Klüver6. Un de ces pères fondateurs était Arturo Rosenblueth qui, avec Walter Cannon, se posait en continuateur de Claude Bernard. En réaction au réductionnisme en biologie, il affirmait la dépendance des parties par rapport au tout. La bio-cybernétique de Cannon permettait de concevoir des systèmes régulateurs en feed-back qui pouvaient rendre compte du fonctionnement de nombreux systèmes, en particulier dans le domaine de l’endocrinologie naissante.
Du côté de ce qui allait devenir les neurosciences, cette période de 1930 à 1950 contribue à imposer la notion d’organisation fonctionnelle qui se substituera bientôt à l’explication dominante du comportement et du fonctionnement psychique par les réflexes. La théorie de la « forme », en particulier, affirmait que la totalité ne peut se réduire à la somme de ses parties, que l’organisme constitue une unité fonctionnelle en interaction avec son environnement. L’ouvrage de Kurt Goldstein – La Structure de l’organisme – se proposait de démontrer que les effets d’une lésion cérébrale ne peuvent pas s’expliquer par la perte d’une seule fonction localisée mais relèvent d’une rupture de l’adaptation globale de l’organisme à son milieu, d’un changement d’attitude vis-à-vis de l’environnement. Selon cette conception, l’organisme et le milieu constituent solidairement une forme que la lésion désorganise et dissocie. Il s’agit ici, on le voit, non de quelque propriété mystérieuse ou « émergente », mais seulement de la prise en compte du fonctionnement ordonné d’un ensemble de mécanismes régulateurs. On découvrait alors que le cerveau est un système dynamique qui ne se réduit pas à son anatomie et que les effets de lésions se comprennent par la rupture des relations entre structures normalement interconnectées. La fonction réside donc dans la coordination entre structures cérébrales7. Ce même argument holiste était aussi utilisé par Karl Lashley, qui pensait que les traitements de haut niveau (dont le reflet était l’intelligence) résultent de l’organisation dynamique de l’ensemble du système nerveux. Il concevait les différentes localisations cérébrales comme inopérantes en tant que divisions fonctionnelles présumées (puisqu’elles étaient, selon ses termes, « équipotentielles ») et faisait reposer le fonctionnement de l’ensemble sur le principe d’« action de masse » (la complexité du traitement dépend de la masse de tissu impliquée)8. Rappelons cependant, avant de poursuivre dans cette ligne, que les localisations cérébrales dont parlaient Lashley et ses contemporains (pour en nier l’existence) n’ont plus grand-chose à voir avec les actuelles modifications localisées de l’activité cérébrale, observées à l’aide des techniques modernes d’imagerie cérébrale. Ce que ces techniques nous révèlent, c’est l’existence de réseaux d’activité connectant diverses régions cérébrales. Ces réseaux s’activent lors de l’exécution d’une tâche donnée pour laisser ensuite place à d’autres. La même région (la même localisation) peut appartenir à plusieurs réseaux fonctionnels différents, ce qui ne signifie pas pour autant, d’ailleurs, qu’elle puisse remplir plusieurs fonctions : il serait plus juste de dire que différentes fonctions requièrent la participation de la même région. Ainsi décrite, l’activité cérébrale prend un aspect dynamique finalement assez proche des conceptions de Goldstein ou de Lashley.
Tout se ramenait alors à une question d’organisation fonctionnelle des éléments les uns par rapport aux autres plutôt que de localisations rigides spécifiées par la seule anatomie. Les neurologues n’étaient d’ailleurs pas les seuls à se poser la question du réductionnisme. Dans un autre domaine des sciences de la vie, celui de la biologie moléculaire à ses débuts, le même débat était alimenté par les questions que se posait Erwin Schrödinger. Dans son manifeste de 1943, Qu’est-ce que la vie ?, Schrödinger cherchait les raisons de l’incapacité de la physique et de la chimie de son époque à fournir une explication du vivant9. On ne pouvait en effet se contenter de la réponse du physicien naïf, à savoir que, si les ...
Table des matières
- Page de titre
- Du même auteur aux éditions odile jacob
- Copyright
- Table
- INTRODUCTION
- PREMIÈRE PARTIE. L'ancrage biologique de la cognition
- DEUXIÈME PARTIE. La représentation des actions
- TROISIÈME PARTIE. La cognition sociale
- CONCLUSION
- APPENDICE : NOTES EXPLICATIVES
- BIBLIOGRAPHIE
- Notes
- REMERCIEMENTS
- INDEX