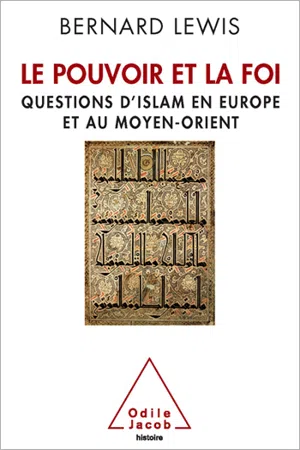
- 272 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Au moment même où toutes nos idées reçues sur les rapports entre Occident et Moyen-Orient sont en passe d'être bousculées par le vent de l'histoire, celui que le New York Times qualifiait de « doyen des études moyen-orientales » livre sa vision du rôle de la religion dans cette partie du monde. Quel est réellement le poids de l'islam dans la politique, par le passé et de nos jours ? La démocratie est-elle possible en terre d'islam ? Pourquoi les discours extrémistes ont-ils un tel impact ? Pourquoi la question de la place des femmes dans la société est-elle si sensible ? La paix et la liberté sont-elles vraiment possibles ? Les sociétés du Moyen-Orient s'occidentalisent-elles en profondeur ? Sur toutes ces questions que l'actualité nous incite à revisiter, l'un des plus grands spécialistes de l'islam présente le dernier état d'années de réflexion et d'étude. Considéré comme l'un des meilleurs interprètes de la culture et de l'histoire du Moyen-Orient, Bernard Lewis est historien, professeur émérite à l'Université de Princeton. Il a récemment publié Que s'est-il passé ? L'islam, l'Occident et la modernité et L'Islam en crise.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Le Pouvoir et la Foi par Bernard Lewis en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Theology & Religion et Religion, Politics & State. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Chapitre II
L’Europe et l’islam
À la fin du XVe siècle, les peuples européens ont connu une forte expansion qui, au milieu du XXe siècle, a fini par placer le monde entier, à des degrés divers, dans l’orbite de la civilisation européenne. L’expansion européenne s’est effectuée vers l’ouest par la mer et vers l’est par la terre. Dans certaines régions, elle s’est traduite par la domination, puis l’assimilation ou l’exclusion des peuples indigènes, ensuite par l’installation d’Européens de l’Est et de l’Ouest sur des terres considérées comme vierges. Dans d’autres, cette expansion a mis les Européens en contact et souvent en opposition avec d’anciennes civilisations et de puissants États. Au XXe siècle, pratiquement tous ces États avaient été vaincus et subjugués, leurs populations et leurs territoires ouverts à la pénétration économique, politique et culturelle de l’Europe. Les rares États qui sont parvenus à survivre dans ce monde dominé par l’Europe n’ont pu le faire qu’au prix de l’adoption généralisée du mode de vie dominant.
Lors de leur expansion en Afrique et en Asie, les Européens se sont trouvés face à trois grandes civilisations : celle de l’Inde, celle de la Chine et celle de l’islam. Alors que le cœur de ce dernier se trouvait dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, peuplées majoritairement par de musulmans arabophones, persanophones ou turcophones, il existait également de vastes populations musulmanes et de nombreux États musulmans dans les steppes eurasiatiques, sur le sous-continent indien, dans la péninsule et les îles du Sud-Est asiatique et dans de larges régions de l’Afrique noire.
Dans la relation qui s’est nouée entre l’Europe expansionniste et ces trois civilisations afro-asiatiques, il existait une différence de taille entre l’islam et les deux autres. Avant les grandes expéditions des découvreurs et la phase d’expansion, l’Inde et la Chine étaient restées très éloignées de l’horizon européen et passaient pour des pays semi-légendaires, que l’on ne connaissait que grâce à des références fragmentaires tirées des Écritures ou des classiques, ou aux récits occasionnels de voyageurs intrépides. Les Indiens et les Chinois connaissaient encore moins bien l’Europe, dont le nom même et les populations n’apparaissaient nulle part dans leurs écrits littéraires et historiques.
Dans le monde islamique, l’Europe était tout aussi inconnue. Son nom apparaît dans quelques anciennes traductions ou adaptations arabes de textes géographiques grecs, mais il n’en était pas pour autant utilisé dans les productions géographiques et politiques de l’islam médiéval et ne s’est imposé couramment qu’au XIXe siècle, lorsque la domination politique puis intellectuelle de l’Europe a entraîné l’adhésion à une nomenclature européenne.
Si le mot « Europe » était inconnu, la réalité qu’il recouvrait était en revanche familière depuis longtemps. Contrairement à ses voisins et prédécesseurs, l’islam comme entité politique se définissait par la religion en tant que société au sein de laquelle l’identité et l’allégeance étaient déterminées par l’acceptation d’une foi commune. Pour les musulmans du Moyen Âge, le monde se divisait en deux : la « maison d’islam », où la foi et le droit islamiques prévalaient, et le reste du monde, connu sous le nom de « maison de la guerre », où la foi et le droit islamiques finiraient en temps et en heure par triompher grâce aux musulmans. Très tôt, ces derniers ont appris à faire la différence entre les sociétés de l’Est et du Sud, dont les dirigeants n’encourageaient aucune religion révélée identifiable et dont les populations pouvaient être sensibles aux enseignements de l’islam, et celles du Nord et de l’Ouest, qui se réclamaient du christianisme. Si le mot « Europe » ne signifiait rien, le mot « christianisme », en revanche, était riche de sens.
La chrétienté et l’islam avaient été voisins – ennemis le plus souvent – depuis l’avènement de l’islam au VIIe siècle. Leur relation était ancienne, et ils entretenaient même certaines affinités élémentaires, même si ces dernières ont rarement été mises explicitement en avant au Moyen Âge ou à l’époque moderne.
Que pouvaient bien avoir en commun l’islam et la chrétienté ? On peut tout d’abord apporter une réponse morale à cette question en évoquant un héritage commun, puis une réponse concrète : un territoire partagé, ou plus exactement revendiqué de part et d’autre.
Le christianisme et l’islam, de même que leur prédécesseur, le judaïsme, sont nés dans la même région et ont été façonnés par les mêmes influences. Les deux religions les plus tardives étaient les héritières des anciennes civilisations du Moyen-Orient et de celles qui les ont remplacées. Toutes deux ont été profondément influencées par le judaïsme, par la philosophie et les sciences grecques ainsi que par le droit et le mode de gouvernement romains. Elles avaient en commun une grande variété de souvenirs et de croyances portant sur la prophétie, la révélation et les écritures. Ces affinités, exprimées dans la théologie et même dans la langue, créaient des possibilités de débat et donc de dialogue qui n’auraient pu voir le jour entre chrétiens ou musulmans d’un côté et les tenants des religions orientales, comme l’hindouisme ou le bouddhisme, de l’autre. Les chrétiens comme les musulmans se traitaient mutuellement d’infidèles, mais, ce faisant, exprimaient une attitude commune vis-à-vis de la religion.
Outre cet héritage commun, ces deux religions partageaient également un territoire. L’expansion de la foi et de l’État musulmans aux VIIe et VIIIe siècles s’est largement faite au détriment de la chrétienté. À l’Empire perse, les musulmans ont pris l’Irak, alors majoritairement chrétien. À l’Empire romain christianisé et à quelques autres États chrétiens, ils ont pris la Syrie, la Palestine, l’Égypte, l’Afrique du Nord, la péninsule Ibérique et la Sicile. Aujourd’hui, c’est le Portugal et l’Espagne qui nous viennent à l’esprit lorsque nous pensons à des régions d’Europe un temps abandonnées à l’islam, puis reconquises. Dans les pays du Levant et en Afrique du Nord, le christianisme était pourtant plus ancien et plus solidement implanté que dans le sud-ouest de l’Europe, et leur perte – surtout celle de la Terre sainte – a été ressentie bien plus douloureusement par l’Occident médiéval chrétien. Plus tard, l’arrivée des Mongols en Europe de l’Est puis leur conversion à l’islam ont fait passer la majeure partie de cette région sous contrôle islamique. Tandis que les Tatars islamisés dominaient la Russie et la steppe, les Turcs ottomans pénétraient dans la péninsule des Balkans et se dirigeaient vers le cœur de l’Europe.
Le christianisme comme l’islam avaient du mal à admettre l’existence de l’autre en tant que religion importante, que foi concurrente et que civilisation porteuse d’un autre message à l’humanité. Des deux côtés, cette mauvaise volonté s’exprimait dans la pratique par l’utilisation de qualificatifs ethniques et non religieux pour caractériser l’adversaire. Les musulmans parlaient des chrétiens européens en les appelant les « Romains », les « Slaves » ou les « Francs » ; tandis que les Européens utilisaient les mots « Sarrasins », « Maures », « Turcs » ou « Tatares » pour parler des musulmans, en fonction des groupes rencontrés. Chaque religion était pourtant pleinement consciente que l’autre se caractérisait par une autre révélation et une autre vision du monde, et elles l’exprimaient toutes deux par le recours à des adjectifs tels qu’incroyants, infidèles, paynim et kafir.
Chronologiquement, le christianisme est né plus tôt que l’islam, et ce ne fut pas sans conséquences sur leur attitude l’un envers l’autre. Chaque religion se considérait comme la révélation définitive des intentions de Dieu vis-à-vis de l’humanité. Pour les chrétiens, les juifs étaient des précurseurs et en tant que tels pouvaient être traités avec une certaine forme de tolérance limitée et précaire. Leur religion était authentique mais incomplète et corrompue. Les musulmans pouvaient envisager les chrétiens et les juifs comme des précurseurs dont les livres sacrés dérivaient de révélations authentiques mais incomplètes et corrompues par ceux qui en avaient eu la garde et ne s’en étaient pas montrés dignes. Pour ces raisons mêmes, ces deux révélations ne pouvaient qu’être détrônées par la révélation parfaite et définitive de l’islam.
Là encore, il existe un contraste important entre la réaction de l’islam face à l’expansion européenne et celle de l’Inde et de la Chine. Pour les hindous, les bouddhistes, les confucianistes et les autres, la civilisation chrétienne était nouvelle et inconnue ; ceux qui l’avaient apportée – et tout ce qu’ils avaient apporté d’autre – pouvaient donc, dans une certaine mesure, être jugés en fonction de leurs mérites. Pour les musulmans, le christianisme – et par extension tout ce qui pouvait lui être associé – était connu, familier et dévalorisé. Ce qui était vrai dans le christianisme avait été incorporé à l’islam ; tout ce qui ne l’avait pas été était forcément faux.
Quant aux chrétiens, et pour des raisons évidentes, la même différence caractérisait leur attitude face aux trois grandes civilisations asiatiques. Ni les Indiens ni les Chinois n’avaient jamais conquis l’Espagne, pris Constantinople ou assiégé Vienne. Ni les hindous, ni les bouddhistes, ni les confucéens (du moins à l’époque) n’avaient rejeté les Évangiles chrétiens en les jugeant corrompus et dépassés pour les remplacer par une version plus récente et plus satisfaisante de la parole de Dieu.
Si les chrétiens et les musulmans avaient peu de respect et d’estime pour les autres religions que la leur, ils étaient pleinement conscients des dangers que représentaient les puissances hostiles inspirées par ces autres religions. Pendant très longtemps, cette peur a été induite par la menace que l’islam faisait peser sur l’Europe, et, pendant tout le Moyen Âge, l’islam n’a cessé d’être perçu comme autre chose qu’un danger mortel. En à peine plus d’un siècle, les armées musulmanes avaient arraché au monde chrétien les côtes du sud et de l’est de la Méditerranée ; ils avaient conquis le Portugal et l’Espagne, une partie de l’Italie et s’attaquaient désormais à la France. En Europe de l’Est, les invasions des Tatares, puis des Turcs ont fait planer la menace musulmane jusqu’à l’époque moderne.
Il est aujourd’hui à la mode de présenter les croisades comme la première incursion violente de l’impérialisme occidental dans le tiers-monde. Cette interprétation anachronique n’a aucun sens dans le contexte de cette époque. Avant tout, l’avancée des armées chrétiennes au XIe siècle avait pour but de desserrer l’étau des musulmans en Europe et de reconquérir les territoires perdus de la chrétienté. L’offensive contre les musulmans en France, la reprise de la Sicile et la reconquête progressive de l’Espagne faisaient partie d’un même mouvement qui a culminé avec l’arrivée des croisés au Levant à la fin du XIe siècle. Comme l’Espagne et le Portugal, la Syrie et la Palestine étaient de vieilles terres chrétiennes, et il était du devoir des chrétiens de les reprendre, d’autant que c’est là qu’étaient situés les lieux saints du christianisme. Leur conquête par l’islam était encore relativement récente, et les deux pays comptaient encore d’importantes populations chrétiennes.
La reconquête du sud de l’Europe a été définitive et elle a délimité en un sens l’Europe elle-même. Au Levant, les croisés ont échoué. Ils se sont heurtés à une vague nouvelle d’expansion musulmane menée cette fois non par les Arabes, mais par les Turcs, qui avaient déjà conquis la majeure partie de l’Anatolie grecque et chrétienne, et qui s’apprêtaient à faire entrer l’islam turc dans le sud-est et dans l’est de l’Europe, grâce aux conquêtes effectuées par une Horde d’Or islamisée et turquisée. Cette expansion a entraîné à son tour d’autres réactions de la part de l’Europe, avec l’expansion de la Moscovie et, des siècles plus tard, celle des peuples chrétiens des Balkans.
Entamée à la fin du XVe siècle, la grande expansion européenne vers l’est et vers l’ouest a été à l’origine la continuation de ce processus de libération de l’Europe. Les Espagnols et les Portugais ont chassé les Maures hors de la péninsule Ibérique et les poursuivirent ensuite jusqu’en Afrique et au-delà. Les Russes ont repoussé les Tatares de Moscovie et les ont poursuivis jusqu’au fin fond de l’Asie.
À l’ouest, les Espagnols et les Portugais ont été suivis par d’autres nations maritimes d’Europe occidentale puis, dans une moindre mesure, par les continentaux dépourvus d’accès à la mer. En Europe de l’Est, les Russes ont pu librement poursuivre leur expansion à l’est et au sud vers la mer Caspienne, la mer Noire et l’Asie centrale. À terme, l’Europe de l’Est, l’Europe de l’Ouest et l’Europe centrale ont convergé de nouveau vers le Moyen-Orient, lorsque la puissance ottomane a commencé à faiblir puis à disparaître.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, ce n’était plus l’Europe qui se trouvait prise dans l’étau musulman, mais les territoires islamiques, qui subissaient la rigueur de l’expansion européenne. Au nord, les Russes ont avancé dans les régions musulmanes turcophones et persanophones situées entre la mer Noire et l’Asie centrale. Au sud, les puissances maritimes ont profité de leurs nouvelles bases dans le sud de l’Asie et de l’Afrique pour se rapprocher en passant par l’océan Indien, le golfe Persique et la mer Rouge. Plus à l’ouest, les Espagnols, suivis plus tard et avec davantage de succès par les Français et les Italiens, ont envahi l’Afrique du Nord musulmane. Au début du XXe siècle, la majeure partie du monde musulman se trouvait incorporée dans les quatre grands empires européens : russe, hollandais, britannique et français. Même l’Iran et la Turquie, les deux empires musulmans qui avaient réussi à préserver une indépendance précaire en période de domination européenne, se trouvaient désormais profondément pénétrés par les intérêts, les institutions et les idées européens, à pratiquement tous les niveaux de la vie publique, mais aussi de la sphère privée.
Les dirigeants du monde islamique ont eu très tôt conscience de cette avancée européenne et des dangers qu’elle représentait du point de vue politique, militaire et économique. L’Empire ottoman, qui a pris au XVIe siècle la tête du monde islamique, n’a pas saisi tout de suite la pleine mesure de l’expansion russe et européenne vers l’Asie, notamment après l’incorporation de l’Égypte, de la Syrie, puis de l’Irak dans les territoires ottomans et l’extension de la puissance ottomane sur les mers orientales. Une expédition ottomane a été envoyée en Inde, et une autre, plus modeste, a même été envoyée jusqu’à Acheh, sur l’île de Sumatra. Au XVIe siècle, les représentants de l’Empire ont étudié la possibilité de percer deux canaux, l’un à travers l’isthme de Suez afin de permettre à la flotte ottomane de passer de la Méditerranée à la mer Rouge, et l’autre entre le Don et la Volga afin de donner le moyen à la flotte ottomane de se déployer de la mer Noire à la Caspienne.
Ces percements sont restés à l’état de projets et, en règle générale, l’Empire ne semble jamais avoir été motivé par une quelconque urgence. Pourquoi, d’ailleurs, l’aurait-il été dans la mesure où les Ottomans étaient certains de leur supériorité écrasante face à une Europe chrétienne divisée par des guerres religieuses, économiques et dynastiques ? Certes, les Européens traversaient les mers pour établir des échanges commerciaux avec des pays lointains, mais les Ottomans contrôlaient fermement les carrefours importants où se croisaient l’Europe, l’Asie et l’Afrique. La flotte ottomane dominait la Méditerranée orientale, où la victoire chrétienne à la bataille de Lépante ne fut guère qu’un incident sans importance. Les armées ottomanes circulaient librement dans le sud de l’Europe. Pendant un siècle et demi, c’est un pacha turc qui a régné sur Buda, tandis que les soldats turcs ont fait par deux fois le siège de Vienne. Les Ottomans avaient donc apparemment peu de raisons de craindre les puissances européennes et de chercher à s’en défendre.
Ils avaient encore moins de raisons de redouter la progression des idées européennes. Les Européens chrétiens du Moyen Âge étaient parfaitement conscients que l’islam représentait une religion concurrente qui, à certains moments, avait même semblé menacer la survie même du christianisme. De nombreux chrétiens s’étaient d’ailleurs convertis, et, parmi les premiers fidèles gagnés à l’islam en dehors de l’Arabie, beaucoup – probablement une majorité – étaient des chrétiens convertis. Pour l’Europe chrétienne, l’islam représentait un danger religieux autant que militaire. Les érudits européens ont appris l’arabe, ont traduit le Coran et d’autres textes, et ont étudié la doctrine islamique ; ils avaient deux raisons de le faire. Dans l’immédiat, il s’agissait avant tout de protéger les chrétiens de la tentation d’une conversion. Il fallait ensuite, à plus longue échéance, convertir les musulmans. On peut voir dans ces études de l’arabe et de l’islam le germe de ce qui sera plus tard l’orientalisme. Il a fallu plusieurs siècles aux chrétiens européens pour comprendre qu’il n’était plus urgent d’empêcher les conversions de chrétiens et que la conversion des musulmans n’avait jamais été envisageable. Entre-temps, à la Renaissance, avec le renouveau du savoir et l’émergence des études philosophiques, l’étude de l’arabe a fini par être assimilée dans les universités à celle du latin, du grec et de l’hébreu – langues classiques des Écritures –, et l’orientalisme est entré dans une nouvelle phase qui se prolonge encore aujourd’hui.
Ces mouvements n’ont pas eu d’équivalent du côté de l’islam....
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Table
- Dédicace
- Préface
- Chapitre I. Permis de tuer
- Chapitre II. L'Europe et l'islam
- Chapitre III. Religion et politique dans l'islam et le judaïsme
- Chapitre IV. L'islam et la démocratie libérale
- Chapitre V. Enfin libres ?
- Chapitre VI. Guerre des sexes et choc des civilisations
- Chapitre VII. Démocratie et religion au Moyen-Orient
- Chapitre VIII. Paix et liberté au Moyen-Orient
- Chapitre IX. Démocratie, légitimité et succession au Moyen-Orient
- Chapitre X. Ce que l'histoire nous enseigne
- Chapitre XI. Liberté et justice en terre d'islam
- Chapitre XII. L'Europe et l'islam
- Chapitre XIII. Liberté et justice dans le Moyen-Orient moderne
- Remerciements
- Quatrième de couverture