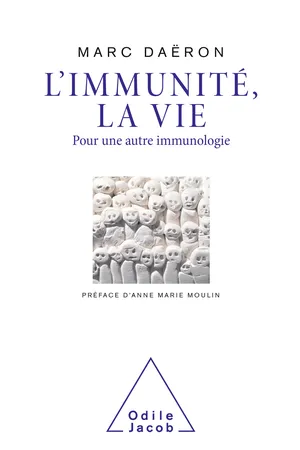
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Nous, les vivants, sommes des chimères. Mammifères, oiseaux, reptiles ou poissons, insectes, araignées ou mollusques, plantes ou algues, nous sommes tous constitués par une communauté d'êtres vivants qui partagent leur vie dans un même «?méta-organisme?». C'est parce que nous sommes ensemble que nous sommes vivants car nous avons besoin les uns des autres pour vivre. Si eux et nous pouvons vivre ensemble, c'est parce qu'un système immunitaire le permet, qui nous adapte à eux et les adapte à nous. De cette accommodation réciproque résulte une immunité d'un nouveau type, dynamique, relationnelle, jamais acquise. L'immunité que négocie ce système n'est pas parfaite, tant s'en faut, c'est un compromis. Elle n'évite pas toujours la maladie, elle en est même parfois la cause. La maladie est le prix de l'immunité. Car ce que permet le système immunitaire est bien plus essentiel que la défense de l'organisme, c'est l'existence même du méta-organisme que nous sommes. L'immunité n'est pas une protection, c'est une condition d'existence. Marc Daëron est immunologiste, ancien directeur du département d'immunologie de l'Institut Pasteur, chercheur émérite au Centre d'immunologie de Marseille-Luminy et membre associé à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Il a publié aux éditions Odile Jacob, avec Éric Vivier, L'Immunothérapie des cancers.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L' Immunité, la vie par Marc Daëron en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences biologiques et Biologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
III
Le compromis
« COMPROMIS. n. m. (XIIIe). 1° Dr. Convention par laquelle les parties, dans un litige, recourent à l’arbitrage d’un tiers. – Convention provisoire par laquelle deux personnes constatent leur accord sur les conditions d’une vente, en attendant l’acte notarié de régularisation. 2° Arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. »
A. REY et J. REY-DEBOVE,
Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (1984)
Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (1984)
« L’amitié se nourrit de compromis. Et ces compromis ne sont pas des reniements, ni des trahisons comme tu le penses. Ce sont des preuves d’amour. »
Philippe CLAUDEL, Compromis (2019).
CHAPITRE 1
La réaction
L’objectif de ce chapitre est de commencer par faire un état des lieux. Car un bon siècle de recherche a produit une somme considérable de données expérimentales, de faits démontrés, de mécanismes élucidés et de conclusions étayées. Nous tenterons donc d’oublier que, même lorsqu’il nous protège, le système est immunitaire, pour essayer de reconstruire un système biologique en sens inverse, i.e. en partant de faits avérés et non d’effets escomptés. Un système qui conférerait aussi une immunité protectrice, bien entendu. Nous tenterons donc ici de rassembler les bases d’un système physiologique sans a priori métaphysique ou idéologique, un système auquel ne serait pas assignée une fonction qui justifierait son existence, un système biologique libéré des causes finales.
Récuser tout a priori métaphysique est plus facile à dire qu’à faire. Il n’est évidemment pas question de nous passer de la notion de temps, par exemple, un concept purement métaphysique. La vie se déroule dans le temps, les objets physiques et donc les objets biologiques sont situés dans l’espace et dans le temps, le temps est présent jusque dans les équations différentielles de la forme dx/dt des mathématiques. La science la plus dure est entrelardée de métaphysique incontournable. Nous pouvons néanmoins nous garder de tout a priori idéologique et oublier ces guerres dans lesquelles nous avons enrôlé malgré elles les cellules et les molécules immunitaires, où nous avons la lucidité de Fabrice del Dongo à Waterloo. Nous ne pouvons sans doute pas nous passer d’a priori théorique. Sans théorie pour lier les faits, nous ne pourrions pas même en dresser un catalogue, puisque nous ne saurions dans quel ordre les ranger. Décider d’un ordre, c’est déjà projeter notre pensée sur les faits. Nous essaierons donc, si cela est possible, d’avoir toujours présente à l’esprit la métaphysique incontournable sans laquelle nous ne pouvons rien dire, d’abandonner les métaphores militaires qui nous égarent sur des champs de bataille imaginés et de nous en tenir à une théorie minimale sans laquelle nous ne pouvons parler de science.
Cette théorie minimale sera la suivante. Une réaction immunitaire est une réponse biologique. « Réponse immunitaire » est d’ailleurs souvent synonyme de « réaction immunitaire ». Une réaction biologique est une façon qu’a l’organisme de répondre à une stimulation. Quand on parle de réaction immunitaire, cependant, « réaction » a un double sens. C’est d’abord une réponse biologique comme les autres : l’organisme agit en réponse à une stimulation. Brunir au soleil est une réponse de l’organisme qui, stimulé par les rayons ultraviolets de la lumière solaire, induit la prolifération des mélanocytes de la peau. Le résultat de cette réponse, le bronzage, protège sans doute l’organisme du soleil, mais elle n’a aucun effet sur le soleil ou ses rayons. De la même façon, dans une réponse immunitaire, l’organisme réagit à une stimulation : quelque chose stimule ce que, faute de mieux, j’appellerai le système immunitaire, et celui-ci agit en réponse à cette stimulation. Mais, dans une réponse immunitaire, cette action s’exerce sur le stimulus à l’origine de la réponse, avec toutes sortes de conséquences. Je ferai donc le postulat qu’une réaction immunitaire est une réaction à la fois à et sur un stimulus, c’est doublement une réaction, c’est un aller-retour. J’essaierai de m’en tenir à cette description minimale d’une réponse immunitaire. Elle nous servira de cadre théorique.

On remarque que, selon ce schéma, le stimulus et le système immunitaire ont les deux mêmes attributs fonctionnels. L’un et l’autre ont la capacité d’agir : le stimulus stimule et le système immunitaire répond. Et la capacité de subir : le système immunitaire reçoit la stimulation et le stimulus est soumis à la réponse immunitaire. Ils peuvent aussi bien affecter qu’être affectés1, ils sont tour à tour sujets et objets. Et, vus sous cet angle, ils n’existent pas l’un sans l’autre.
La stimulation et la réponse sont en effet liées par une double relation causale. Pas de réponse sans stimulation, évidemment, mais pas davantage de stimulation sans réponse, car c’est la capacité d’induire une réponse qui fait la stimulation. Une stimulation sans réponse ne serait pas une stimulation, ce serait une action sur un système immunitaire inerte, un coup de marteau sur un clou, qui l’enfonce. C’est donc une causalité circulaire qui associe stimulation et réponse, mais la relation causale n’est pas la même dans les deux sens. Si la stimulation induit la réponse, l’inverse n’est pas vrai : la réponse n’induit pas la stimulation, elle lui confère la qualité de stimulation. La causalité porte sur des objets dans le sens stimulation → réponse, elle porte sur des idées dans le sens réponse → stimulation2.
Ce qui stimule le système immunitaire et ce sur quoi s’exercent ses réponses sont des molécules biologiques. Par ce terme, je désignerai collectivement toutes ces macromolécules qui caractérisent le vivant : les protéines, en premier lieu, avec leurs variantes (glycoprotéines, lipoprotéines, etc.), mais également les acides nucléiques sous leurs différentes formes (ADN, ARN, double brin, simple brin, etc.). Ces molécules sont grosses3 – elles ont, pour la plupart, une masse moléculaire allant de plusieurs milliers à quelques millions de daltons ; cette masse moléculaire est bien plus grande que celle des autres molécules organiques – parce que ce sont des polymères de petites molécules, des assemblages linéaires d’acides aminés pour les protéines, de nucléotides pour les acides nucléiques.
Ces grosses molécules ont une forme. Tout le monde connaît la forme en double hélice de l’ADN. Elle est due à l’appariement des quatre types de nucléotides qui constituent chaque brin d’ADN et aux contraintes physico-chimiques qui font tourner les deux brins autour d’un axe. La forme des protéines est beaucoup plus complexe parce que ces molécules sont des assemblages non plus de quatre éléments assez semblables, mais de vingt éléments assez différents les uns des autres, vingt acides aminés qui, en s’accrochant les uns aux autres dans un ordre particulier, peuvent construire une multitude de chaînes polypeptidiques. Elle est plus complexe aussi parce que de nombreuses protéines sont faites non pas d’une seule, mais de plusieurs chaînes polypeptidiques associées en une même molécule. La forme d’une protéine dépend donc des acides aminés dont elle est faite, de l’ordre dans lequel ceux-ci sont assemblés pour former une chaîne polypeptidique, de l’association des chaînes qui constituent cette protéine et de la façon dont cette ou ces chaînes se replient dans l’espace, en raison des forces qui attirent ou qui repoussent les acides aminés, dans une même chaîne et/ou entre différentes chaînes.

Ce que stimulent les molécules biologiques, ce sont des cellules, les cellules du système immunitaire. Le système immunitaire est constitué par une multitude de cellules mobiles qui communiquent entre elles et avec les autres cellules de l’organisme, de près ou de loin. À la différence d’autres systèmes physiologiques, le système immunitaire n’a pas de structure anatomique visible. Il ne peut être disséqué comme peut l’être, par exemple, le système digestif. Comme les montres de Salvador Dalí, c’est un système fluide.
Les cellules du système immunitaire peuvent être stimulées par les macromolécules biologiques parce qu’elles sont équipées de récepteurs pour ces molécules. Ce sont également des cellules du système immunitaire, les mêmes ou d’autres, qui répondent à cette stimulation en mettant en route des activités qu’elles peuvent exercer sur les molécules à l’origine de la stimulation, à condition qu’elles reçoivent les signaux appropriés.
Certaines réponses sont protectrices : elles protègent contre des organismes pathogènes comme les bactéries responsables de maladies infectieuses ou contre des processus pathologiques comme le développement de cancers. D’autres réactions sont pathogènes. Elles provoquent des maladies lorsqu’elles sont dirigées contre des molécules exogènes comme les allergènes ou contre des molécules endogènes comme les autoantigènes. D’autres réactions, la plupart sans doute, sont silencieuses comme les réactions du système immunitaire de la femme enceinte envers les antigènes paternels de son fœtus. Elles se produisent en absence de manifestation décelable.
Je décrirai donc cet aller-retour entre molécules et cellules, en m’en tenant aux éléments engagés dans ce jeu de ping-pong et aux règles auxquelles ils sont soumis. Je m’efforcerai de réduire cette description à ce que je crois être nécessaire et suffisant pour décrire une réponse immunitaire.
Pour cela, je propose un nombre volontairement réduit d’« énoncés ». Ces énoncés, numérotés de 1 à 20 et écrits en caractères gras, résument en quelques mots l’essentiel. Chaque énoncé est complété par un bref développement en caractères romains et, quand c’est nécessaire et possible, par une figure dont le but est uniquement d’éclairer l’énoncé. Pour certains énoncés, des points sont approfondis par des précisions en italique. Cette présentation offre ainsi plusieurs niveaux de lecture. L’essentiel peut être appréhendé par une lecture des seuls passages en caractères gras qui devraient suffire pour comprendre l’ensemble. Ces notions essentielles peuvent être précisées et consolidées par une lecture des passages en caractères romains. Quant aux passages en italique, ils sont là pour fournir de la matière à penser et poursuivre la réflexion au-delà de l’exposition.
J’examinerai d’abord les cellules impliquées dans les réponses immunitaires, puis les mécanismes par lesquels ces cellules peuvent être stimulées par des molécules biologiques, enfin comment ces cellules répondent à ces stimulations et avec quelles conséquences.
Les cellules
1. Le système immunitaire est constitué par un grand nombre de cellules mobiles, présentes partout dans l’organisme. Considérées dans leur ensemble, ces cellules ont la propriété d’être stimulées par des molécules biologiques et de répondre à cette stimulation.
Les cellules du système immunitaire sont présentes dans tout l’organisme. Certaines circulent dans le sang et dans la lymphe. D’autres sont concentrées dans les organes lymphoïdes primaires (le thymus et la moelle osseuse) où elles sont fabriquées, et dans les organes lymphoïdes secondaires (les ganglions lymphatiques, les amygdales et les plaques de Peyer) où elles s’installent et où sont mises en route les réactions immunitaires. D’autres résident dans les tissus : certaines y ont migré et terminé leur différenciation ; d’autres y ont été attirées pour participer à une réaction immunitaire et elles s’y constituent en organes lymphoïdes tertiaires. Toutes ces cellules seront désignées collectivement par le terme « cellules immunitaires » pour indiquer seulement qu’elles participent aux réponses immunitaires, quelle que soit leur contribution à ces réponses.
Ce qui caractérise les cellules immunitaires est leur capacité d’être stimulées par des macromolécules biologiques. Ces molécules peuvent être de nature différente et elles peuvent stimuler les cellules immunitaires selon des modalités différentes. Ces cellules peuvent alors répondre à cette stimulation soit elles-mêmes, soit en engendrant d’autres cellules capables d’y répondre. Si l’on se réfère au schéma d’une réponse immunitaire minimale utilisé plus haut, on peut remplacer « stimulus » par « molécule biologique » et « système immunitaire » par « cellule immunitaire ». On obtient ainsi une description encore plus minimale d’une réponse immunitaire, réduite à une seule cellule. Et l’on remarque la même symétrie fonctionnelle entre molécule biologique et cellule immunitaire que celle que nous avions notée entre stimulus et système immunitaire. Tour à tour, l’une et l’autre ont la capacité d’agir : la molécule stimule la cellule qui répond à la stimulation. Et la capacité de subir : la cellule reçoit la stimulation de la molécule qui est soumise à la réponse de la cellule.

Bien sûr, une réponse immunitaire n’est pas le fait d’une seule cellule. Elle nécessite la coopération d’un grand nombre de cellules de natures différentes, dont les activités, simultanées ou successives, sont complémentaires. Le fonctionnement des cellules immunitaires est coordonné parce que celles-ci communiquent entre elles. Elles sont en effet équipées de récepteurs qui leur permettent de recevoir des « informations » provenant d’autres cellules immunitaires soit par contact direct, de membrane à membrane, soit indirectement, par l’intermédiaire de médiateurs solubles. Ceux-ci peuvent diffuser dans l’environnement immédiat de la cellule qui les a produits ou, emportés dans la circulation sanguine, se répandre dans l’organisme entier et entrer en contact avec les cellules, même lointaines, qui expriment les récepteurs correspondants.
2. Les cellules immunitaires dérivent de la différenciation de cellules souches* hématopoïétiques dans la moelle osseuse. Elles appartiennent à deux grandes lignées cellulaires : la lignée lymphoïde et la lignée myéloïde.
Les cellules immunitaires sont produites dans la moelle osseuse. Elles résultent de la différenciation de cellules souches hématopoïétiques. Se différencier, pour une cellule, signifie se spécialiser dans une ou plusieurs fonctions. Une différenciation est un double processus : c’est un processus par lequel une cellule, d’une part, acquiert des propriétés spécifiques nouvelles que ne possédait pas la cellule qui l’a engendrée et, d’autre part, perd des propriétés. Elle perd notamment une partie de la pluripotence qui caractérise la cellule souche dont elle s’est différenciée. Elle devient plus adaptée mais moins adaptable. Un exemple de différenciation extrême est celle des cellules souches hématopoïétiques en globules rouges. Ces cellules ont acquis la capacité de synthétiser l’hémoglobine, ce qu’elles sont les seules à savoir faire, mais elles ont perdu leur noyau et donc la capacité de se diviser. La diffé...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Préface - L'immunité, guide de vie
- Avant-propos
- Introduction - Après l'immunité
- I - La défense
- II - Logiques du vivant
- III - Le compromis
- Abréviations
- Glossaire
- Notes
- Bibliographie
- Remerciements
- Sommaire
- Du même auteur