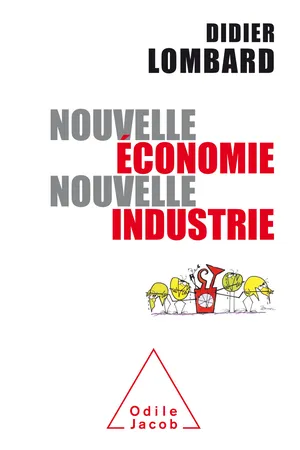
- 208 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Nouvelle économie, nouvelle industrie
À propos de ce livre
Que faire face au déclin de notre industrie et au risque de son déclassement dans la compétition économique mondiale ? D'abord et avant tout renouveler les grandes infrastructures, celles des transports, de la production d'énergie, des télécommunications. Mais aussi tirer parti de l'explosion du numérique, lame de fond qui révolutionne toutes les filières industrielles et redistribue mondialement toutes les cartes. Or la France dispose d'atouts majeurs pour réussir : une expertise scientifique et technologique reconnue, un savoir-faire industriel et, surtout, une jeunesse instruite et compétente. L'ensemble de l'économie tirera profit de cette refondation industrielle pour peu que, dans sa mise en œuvre, l'on s'affranchisse de la tyrannie du court terme et du low cost et que l'on sache conjuguer les efforts des grands groupes, des PME et des start-up innovantes. Une vision et un programme pour la nécessaire et urgente renaissance industrielle. Polytechnicien et docteur en économie européenne, Didier lombard a exercé des responsabilités au ministère de la Recherche puis au ministère de l'économie, notamment comme directeur des stratégies industrielles puis président de l'Agence française pour les investissements internationaux. P-DG de France Télécom de 2005 à 2010, Didier lombard préside le conseil de Technicolor et siège aux conseils de surveillance de STMicroelectronics et de Radiall ; il préside le comité stratégique du fonds de capital-risque Iris Capital, spécialisé dans le développement de l'économie numérique. Didier Lombard est l'auteur du Village numérique mondial (2008) et de L'Irrésistible Ascension du numérique (2011),
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Nouvelle économie, nouvelle industrie par Didier Lombard en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Commerce et Commerce Général. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE PREMIER
L’industrie moteur de la croissance
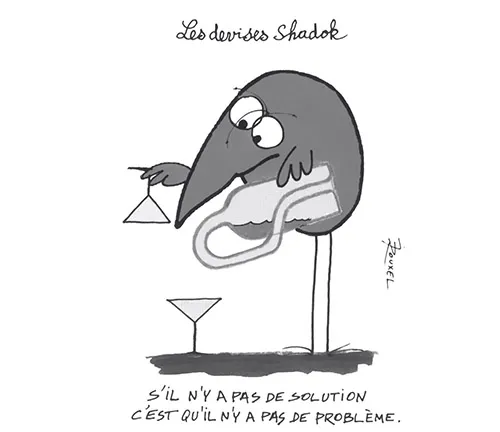
Historiquement, pas de croissance sans industrie
Cela fait près de cent mille ans que l’épopée de notre espèce humaine a débuté alors qu’Homo sapiens a commencé à quitter le continent africain pour s’installer dans la zone tempérée. Deux événements majeurs ont ponctué son développement : la révolution agricole du Néolithique, il y a six mille ans, et la révolution scientifique, il y a cinq cents ans. Cette dernière a été suivie de la grande révolution industrielle qui a tout changé. Les chiffres en témoignent : en 1500, le monde comptait environ 500 millions d’habitants ; nous sommes plus de 7 milliards aujourd’hui. La valeur totale des biens et services produits en 1500 est estimée à 440 milliards1 en dollars de 2014 alors que, de nos jours, la valeur d’une année de production approche les 78 000 milliards de dollars2. Ainsi, pendant que la population a été multipliée par 14, celle de la production l’a été par 177 ! En fait, la production des richesses s’est accélérée avec le développement de l’industrie et du commerce international au XIXe siècle, qui a vu le basculement de la création de richesses de l’Asie vers l’Europe et l’Amérique du Nord. C’est le progrès scientifique exceptionnel de l’Europe qui est à l’origine de tout cela. Pourvu qu’on se souvienne de la maxime de Rabelais : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », la science reste aujourd’hui notre meilleur capital, qu’il nous faut accroître et transmettre avec soin.
Rappelons-nous que Napoléon a pris pour emblème de son règne l’industrieuse abeille. Après le lys des champs des Bourbons, il marquait ainsi une « rupture » non seulement sociale, mais aussi économique. Membre assidu (de 1797 à 1802) de l’Institut national des sciences et des arts (l’actuelle Académie des sciences), il était conscient de l’importance du croisement entre savoirs nouveaux et anciens, aussi, comme l’avait fait avant lui Alexandre le Grand, emmenait-il dans ses campagnes militaires une cohorte de savants et de scientifiques. De plus, lorsqu’il était Premier consul, il soutint avec Cambacérès et Lebrun la création de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, fondée en 1801 à l’initiative d’un groupe de savants, de hauts fonctionnaires et d’entrepreneurs réunis autour de Chaptal, grand chimiste et industriel, alors ministre de l’Intérieur, pour la reconstruction économique du pays au sortir de la Révolution. Tout cela traduisait les changements du siècle des Lumières, qui avait su donner leur place à la science et la raison, à côté des religions et des traditions, certes utiles mais n’apportant que de faibles progrès par excès de conservatismes. L’homme politique et l’entrepreneur qu’était Napoléon intégrait ainsi les promesses de la première révolution industrielle, issue du développement extraordinaire de la science et de la technologie au XVIIe et au XVIIIe siècle, dont la somme avait été rassemblée et diffusée dans l’Encyclopédie.
À l’inverse, nous assistons de nos jours à une mise en cause trop systématique des retombées des progrès de la science dans leurs applications industrielles. C’est le procès de l’artefact qui viendrait, avec ses nuisances, contrarier la Nature si bonne par elle-même. Ce n’est pas nouveau, déjà le mythe du « bon sauvage », cher à Jean-Jacques Rousseau, était opposé à une civilisation accusée de reposer sur trop de superflu ! Peut-être était-ce vrai pour des privilégiés – et encore –, mais pour tous les autres, hélas !
Pourtant, c’est bien la révolution industrielle qui a sorti la plus grande partie de la population des pays développés du besoin et de la misère. Grâce à l’industrie, le malthusianisme, théorie prônant la limitation des terres cultivées et des rendements agricoles, a été conjuré. Car l’industrie n’a cessé d’accroître ses rendements pour répondre aux besoins de la population, ainsi que les salaires des ouvriers venant du monde agricole, créant ainsi un véritable ascenseur social. Aujourd’hui, le monde est à nouveau dans une situation de même type. D’un côté, les progrès scientifiques inouïs – dans l’infiniment grand et l’infiniment petit, dans les secrets de la vie – vont avoir d’immenses retombées sur la technologie et les moyens de production, grâce notamment au numérique. D’un autre côté, plus de la moitié de la population mondiale attend d’une nouvelle révolution industrielle la possibilité d’accéder aux conditions du bien-être : l’eau, l’énergie, la nourriture, la santé, le logement.
Le triptyque science-technologie-industrie ne devrait pas inspirer la peur. L’artificiel, produit par l’art de l’homme, n’est pas ennemi de la Nature, mais doit permettre de la mettre en valeur. Face à d’éventuelles « externalités négatives », c’est aux hommes de science de trouver de nouveaux procédés, de nouvelles solutions compatibles avec ce qu’on appelle à juste titre le « développement durable ».
Aujourd’hui comme naguère, aucun pays ne peut se développer ni même rester un pays avancé sans base productive associée aux technologies adéquates. C’est pour l’avoir ignoré que certains pays de l’Europe du Sud se sont enfoncés dans le chaos et que d’autres sont sur la pente du déclin. Le scénario est toujours le même : faute de production, sous l’effet des importations massives nécessaires pour satisfaire la demande intérieure, la balance commerciale se dégrade et devient négative. Le pays devient alors de moins en moins solvable : sous la pression des instances financières mondiales (la Troïka), le pays est contraint d’augmenter les impôts, de réduire la dépense et en particulier les investissements, l’activité économique ralentit et la spirale infernale de la banqueroute, interdite aux États, s’amorce (cas de la Grèce). Même si par cette potion amère le coût de l’emprunt peut temporairement être réduit, la faiblesse de la production est également synonyme de pertes d’emplois ; aussi, pour soutenir la consommation, des transferts sociaux massifs se font au bénéfice des chômeurs, grâce à l’emprunt, et les intérêts de la dette exploseront à nouveau – à cause de son volume excessif, mais aussi des taux élevés liés à l’insolvabilité du pays : une spirale infernale s’instaure ! Le fait que temporairement les taux d’intérêt ont diminué ne change rien à l’effet destructeur de cette spirale.
De plus, les pertes d’emplois et la disparition de pans entiers de l’industrie ne concernent pas seulement certains secteurs ou bassins d’emploi. Elles ont des effets dévastateurs sur toute l’économie, hypothéquant son avenir et celui des générations futures.
La promotion, depuis les années 1980, d’une pensée ne faisant aucune distinction entre le « travail productif industriel » et d’autres activités utiles à la société comme, par exemple, les services à la personne ou encore les activités de services touristiques, a largement occulté la nécessité de disposer d’une base industrielle solide et compétitive.
Pas d’ambition industrielle :
croissance en danger
Que représente l’industrie en France aujourd’hui ? Peut-on vraiment parler d’une marginalisation de son poids économique au profit des activités de services, alimentant un phénomène de désindustrialisation du territoire ? En quoi la situation industrielle française se distingue-t-elle de celle des autres puissances économiques ? Quelles ont été ses évolutions marquantes au cours des vingt-cinq dernières années ?
Toutes ces interrogations sont au cœur du débat public actuel sur les délocalisations, la spécialisation internationale de l’économie française et les initiatives en matière de politique industrielle.
Faut-il y voir un symbole ? Georges Pompidou, Premier ministre puis président de la République, se rendait parfois à l’Élysée au volant de sa Porsche, et personne ne trouvait à y redire. C’est que son attrait pour le secteur de l’automobile était connu, et que son utilisation d’une marque de voiture de luxe ne posait pas problème en regard de l’efficacité, reconnue, de sa politique pour le développement de l’industrie, ce qui donnait à la France un point de croissance du PIB de plus que ses grands voisins européens. Aujourd’hui encore, une partie de la balance commerciale est assurée par les produits lancés dans la lignée de ceux des années 1970, notamment ceux de l’aéronautique. Comme c’est le cas dans de nombreux pays, il ne faut pas oublier que 80 % des exportations françaises proviennent de l’industrie.
Quand nous disons industrie, de quoi parlons-nous ? Nous vivons une mutation profonde de l’industrie traditionnelle qui voit naître, au côté d’une industrie manufacturière rénovée (4.0), une industrie numérique qui prend des formes nouvelles adaptées au nouveau monde de l’instantanéité des communications, de la globalité des réseaux et de l’intelligence artificielle utilisatrice de masses de données (Big Data). Traditionnellement, on appelle industrie toute activité tournée vers la production en série de biens par la transformation de matières premières grâce à l’exploitation de sources d’énergie. Cette production de masse implique une division du travail selon des compétences diverses et l’utilisation de machines. Ce mode de production a constitué une révolution au XIXe siècle alors que l’artisanat régnait en maître. Aujourd’hui, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, une nouvelle révolution est en œuvre car l’information devient la nouvelle matière première transformée et les ordinateurs sont les nouvelles machines, c’est la raison de la deuxième partie du titre du livre : « nouvelle industrie ». L’ancienne industrie dite « manufacturière » est incluse dans une chaîne de distribution complexe où elle pèse de moins en moins en création de marges, alors qu’après un effort intense d’innovation les coûts marginaux de production tendraient vers zéro : il est alors de plus en plus nécessaire de contrôler le marketing et la distribution. C’est l’objet de ce que l’on appelle aussi la « révolution numérique ».
Les statistiques disponibles portent sur l’industrie manufacturière et ne rendent pas encore compte de cette mutation des caractéristiques de l’industrie. Elles permettent en revanche de dresser un tableau assez précis et plutôt sombre de ce secteur de l’économie, en particulier en France. Elles montrent notamment que la dégradation des principaux indicateurs a commencé dès le début des années 2000, soit bien avant que l’on puisse les attribuer à un effet de la crise économique de la décennie suivante.
Le recul de l’industrie manufacturière3 française se lit dans l’évolution de la part qu’elle représente dans la valeur ajoutée de l’économie globale ainsi que dans le poids des emplois industriels dans l’ensemble de la population active.
Part de l’industrie et de l’industrie manufacturière dans le PIB en France

– La part de l’ensemble de l’industrie ainsi que celle de l’industrie manufacturière n’a cessé de reculer depuis près de quinze ans, passant respectivement de 16,5 à 12,3 % et de 14,1 à 10 % entre 2000 et 2014.
– Concernant l’emploi industriel en France, le constat n’est pas moins sévère. Le poids de l’emploi industriel dans l’ensemble de la population active a reculé de près de 9 points en trente ans, passant de 21 % en 1986 à 12 % en 2014. Cela correspond sur la dernière décennie, 2004-2014, à la perte de près de 600 000 emplois. Face à cette régression, il serait vain de vouloir se consoler en invoquant les statistiques sur la création d’emplois dans les services. En premier lieu parce que ceux-ci ne sauraient remplacer l’industrie, notamment sous l’angle de la création de valeur ajoutée. En second lieu parce qu’une grande partie des emplois créés, tels que ceux dans les grands centres de distribution du monde Internet à l’image de celui implanté en Lorraine par Amazon, sont des emplois de manutention qui sont de toute façon non délocalisables.
Évolution de...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Pour une renaissance industrielle
- Introduction
- CHAPITRE PREMIER - L’industrie moteur de la croissance
- CHAPITRE 2 - Crise de l’industrie ou errements stratégiques ?
- CHAPITRE 3 - Stratégie industrielle : les trois piliers de la sagesse
- CHAPITRE 4 - La mise en œuvre d’une stratégie pour l’industrie
- À la croisée des chemins
- Bibliographie
- Remerciements
- Table
- Du même auteur chez Odile Jacob