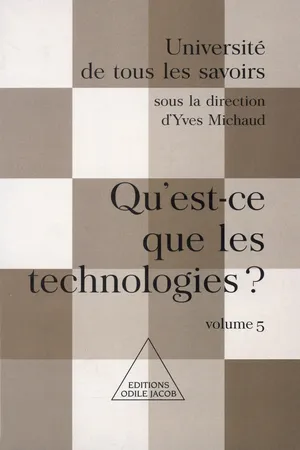
- 940 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Les plus grands spécialistes sont réunis dans ce cinquième volume. Ils éclairent les grandes questions que posent les nouvelles technologies dans l'éducation et la formation, l'informatique, l'exploration de l'espace, l'énergie, les matériaux, les pollutions et leurs remèdes, la société du risque et de l'extrême. Contributions de Jean-François Abramatic, Paul Acker, Cécile Alvergnat, Arlène Ammar-Israël, François Anceau, Jean-Louis Aucouturier, Jean-Pierre Balpe, Bertrand Barré, Gérard Berry, Hugues Bersini, Pierre Bétin, Jacques Blamont, Pierre Caspar, Sophie Cluet, Laurent Cohen-Tanugi, Hubert Curien, Walid Dabbous, Jean-Jacques Duby, Alain Ehrenberg, François Ewald, Olivier Faugeras, Jean-François Fauvarque, Gérard Gallas, Pierre-Gilles de Gennes, Jean-Paul Haton, Jean-Yves Helmer, Didier Houssin, Bernard Lahire, Jacques Lanxade, Jean-Claude Laprie, Pierre Lascoumes, Dominique Lecoq, Jean-Claude Lehmann, Jacques Livage, Annick Loiseau, Mauricio Lopez, Gilles J. Martin, Thomas-Xavier Martin, Gérard Mégie, Philippe Meirieu, Roland Moreno, Pierre Morlier, Yves Mottot, François Orivel, Guy Ourisson, Émile Pefferkorn, Jacques Péping, André Pineau, Jacques Prost, Joël de Rosnay, Laurent Sedel, Jean-Claude Serrero, Michel Sotton, Walter R. Stahel, Jacques Stern, Michel Vivant, Lothaire Zilliox.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l'application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux forfaits: Essentiel et Intégral
- Essentiel est idéal pour les apprenants et professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la Bibliothèque Essentielle avec plus de 800 000 titres fiables et best-sellers en business, développement personnel et sciences humaines. Comprend un temps de lecture illimité et une voix standard pour la fonction Écouter.
- Intégral: Parfait pour les apprenants avancés et les chercheurs qui ont besoin d’un accès complet et sans restriction. Débloquez plus de 1,4 million de livres dans des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. Le forfait Intégral inclut également des fonctionnalités avancées comme la fonctionnalité Écouter Premium et Research Assistant.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l’application Perlego sur appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n’importe où — même hors ligne. Parfait pour les trajets ou quand vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Oui, vous pouvez accéder à Qu'est-ce que les technologies ? par Yves Michaud en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Technology & Engineering et Engineering General. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
VII
MATÉRIAUX EN TOUS GENRES :
L’ANCIEN ET LE NOUVEAU
Les matériaux biomimétiques :
de la nacre aux muscles artificiels*1
par PIERRE-GILLES DE GENNES
Le désir de retour à la nature touche la société occidentale à intervalle régulier. Celui que nous connaissons actuellement dépasse sans doute les précédents par son intensité, mais il a la même chaleur et la même naïveté qu’au temps de Jean-Jacques Rousseau. Ainsi lorsque nous souhaitons remplacer les sacs en plastique des supermarchés par des sacs de papier en oubliant qu’il faudrait y sacrifier des forêts entières et surtout que la production du papier requiert de grandes quantités de produits toxiques.
Cependant, ce retour à la nature offre aussi la possibilité d’apprendre un certain nombre de leçons de la nature. On découvre en particulier que les matériaux du vivant ont des propriétés extraordinaires, très souvent bien supérieures à ce que nous savons faire avec nos procédés industriels, aussi perfectionnés soient-ils : par exemple le collagène dont sont faits les tendons, les ligaments, ou les disques vertébraux qui nous permettent de nous tourner à peu près dans tous les sens, tout en supportant des contraintes physiques importantes.
Il y a là un enseignement important pour ceux qui essayent d’élaborer des matériaux nouveaux. Nous commençons à comprendre les usines du vivant.
Cette compréhension dans toute sa complexité et ses approches est illustrée dans la conférence à travers quelques exemples :
- L’architecture de la carapace de petites algues, les diatomées.
- La résistance particulière de la nacre des huîtres ou des ormeaux, cette pellicule assez mince constituée principalement d’un carbonate de calcium structuré sous forme de lamelles très bien cristallisées entre lesquelles est intercalée une couche organique contenant principalement des sucres et des protéines. De là la résistance à la fracture de ce matériau.
- Le mucus de l’escargot fait d’eau et de certains polymères qui forment gel quand il n’y a pas d’agitation ou redeviennent liquides quand on exerce une traction et permettent ainsi le déplacement de l’animal.
- Les actionneurs (quartz piézo-électrique, caoutchouc, actionneurs mous divers) dont certains pourraient reproduire de manière approchée le comportement des muscles naturels (déformations importantes dans un temps court avec transformation de l’énergie chimique en énergie mécanique et retour final à l’état de départ).
*1. Résumé d’après la 273e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 29 septembre 2000 établi par l’équipe de l’Utls.
Silice et verre*1
par JEAN-CLAUDE LEHMANN
Un peu de physique : qu’est-ce qu’un verre ?
Comment peut-on se représenter, au niveau des atomes ou molécules qui le constituent, un gaz, un liquide ou un solide ? Un gaz est un ensemble d’atomes ou de molécules qui se déplacent librement au sein de l’enceinte qui les contient (Fig. 1a). Lorsqu’on refroidit un gaz et que l’on atteint la température de condensation (par exemple pour la vapeur d’eau 100 °C), le gaz se transforme en liquide. Dans le liquide, les atomes ou molécules sont au contact les uns des autres, mais sans liaison entre eux, ce qui permet au liquide de se déformer, un peu comme le ferait le contenu d’un sac de billes (Fig. 1b). Si enfin l’on refroidit le liquide, il se fige en un solide cristallisé : cette fois-ci, non seulement les atomes ou molécules sont liés les uns aux autres par des liaisons chimiques, donc ne peuvent plus glisser les uns sur les autres comme les billes du sac, mais ils sont rangés dans un ordre donné (Fig. 1c). Cet ordre est imposé par la taille des atomes et la nature des liaisons chimiques. C’est ce que l’on nomme une structure de « cristal ».

Figure 1a

Figure 1b

Figure 1c
Cette dernière transition du liquide au solide peut se décrire comme sur la figure 2a par la diminution brutale, à la température de solidification (appelée ici Tf pour « température de fusion », la fusion étant le phénomène inverse, de passage du solide au liquide, qui se produit à la même température lorsqu’on chauffe le solide), d’un paramètre thermodynamique appelé l’entropie. L’entropie est en quelque sorte une mesure du degré d’ordre d’un milieu : une foule désordonnée a une entropie plus grande qu’une troupe qui marche au pas. Sur la figure 2a on voit qu’après soli dification l’entropie du cristal continue à décroître jusqu’à être nulle au zéro absolu : cela est dû à de petits mouvements d’agitation thermique des atomes autour de leur position d’équilibre. Au zéro absolu, les atomes sont devenus immobiles au sein d’un cristal parfaitement ordonné : l’entropie est nulle. Pourtant, si ce processus de solidification est le plus fréquent, les choses peuvent se passer différemment. Tout d’abord, il peut arriver qu’un liquide très pur ne se solidifie pas à la température Tf. Le liquide continue à se refroidir au-dessous de Tf, ce qui constitue le phénomène de surfusion. Puis à une certaine température, dépendant des conditions expérimentales, on observe une brusque solidification, le milieu passant alors de la courbe d’entropie du liquide, à celle du solide. (Fig. 2b)
Enfin un troisième cas est possible : l’entropie du liquide part sur la courbe de fusion, mais au lieu de « tomber » vers le cristal, le milieu devient visqueux et évolue de façon continue vers un solide, selon une courbe d’entropie plus élevée et qui ne tend pas vers zéro ou zéro absolu (Fig. 2c) ! Que s’est-il passé ? Le liquide s’est progressivement figé sur place. Des liaisons chimiques se sont établies entre les atomes, mais ceux-ci ne se sont pas ordonnés pour former un cristal. On peut considérer que la phase solide obtenue est identique à un liquide, mais avec des atomes fixés les uns aux autres, comme si les billes de notre sac étaient maintenant collées les unes aux autres. C’est cette structure solide désordonnée qu’on appelle un verre ou de façon plus savante un solide amorphe (par opposition à un solide cristallisé).

Figure 2a

Figure 2b

Figure 2c
La figure 3 montre de façon schématique la structure d’un matériau qui, suivant le cycle de refroidissement, peut se trouver dans l’un ou l’autre des états solides. Il s’agit de la silice de formule SiO2. Sur la figure 3a est schématisée la structure de la silice cris talline, le quartz. Les atomes de silicium et d’oxygène sont parfaitement ordonnés. Sur la figure 3b est représentée la structure de la silice amorphe. On voit que les atomes sont bien liés entre eux, mais dans une structure désordonnée. C’est un verre.

Figure 3a et 3b
De la silice au verre courant
La silice peut donc avoir la structure d’un verre. Cependant il ne s’agit pas d’un matériau d’usage courant, car sa température de fusion, Tf, est élevée : 1 850 °C. Un verre courant est une silice modifiée de la façon suivante :
Pour abaisser la température de fusion jusque vers 1 100 à 1 300 °C, on mélange la silice (en fait du sable), à un fondant. En effet on sait que l’ajout d’un second matériau a souvent l’effet d’abaisser la température de fusion (c’est ainsi que l’eau salée reste liquide au-dessous de 0 °C). Ce second matériau, appelé « fondant » est pour le verre à base d’alcalin, le plus souvent de sodium Na, parfois de lithium Li ou de potassium K. L’ajout de soude, sous forme Na2O va donc permettre d’abaisser la température de fusion du mélange.
Pour donner au verre des propriétés spécifiques de couleur, de transparence, de dureté, de résistance mécanique, de résistance aux attaques chimiques (ou simplement à l’humidité), etc. On ajoute à la composition verrière (le mélange que l’on va fondre puis laisser refroidir pour former le verre), toutes sortes de constituants qui se retrouvent au sein du verre sous forme d’oxydes.
À titre d’exemple, la composition d’un verre courant pourra être la suivante :
SiO2 : 73 % NaO : 13,7 % K2O : 0,4 %
CaO : 10,6 % MgO : 0,3 % Al2O3 : 1,8 %
Il s’agit là d’un verre silico-sodo-calcique car ses trois principaux constituants sont la silice, la soude et la chaux.
Quelles sont alors les principales propriétés du verre ?
Tout d’abord l’existence de la phase visqueuse évoquée plus haut : elle est très importante car elle a pour conséquence que dans une plage de température, certes élevée, au-dessus de 1 000 °C, mais large de quelques dizaines de degrés, il est possible de donner au verre la forme que l’on veut, un peu comme de la pâte à modeler. Les procédés verriers relèvent tous de cette même approche : on chauffe vers 1 200 à 1 400 °C un mélange de matières premières (sable, soude, chaux etc.), éventuellement additionné de débris de verre à recycler (qu’on appelle du calcin). On forme ainsi un verre liquide. On laisse refroidir ce liquide jusqu’à la température de formage, vers 1 100 °C, température à laquelle il forme une pâte visqueuse à partir de laquelle on forme des bouteilles, des plaques pour les vitrages, des fibres etc. ; puis on laisse refroidir à la température ordinaire pour que l’objet ainsi formé devienne un objet en verre solide.
Au-delà de l’existence de cette phase visqueuse, le verre possède de nombreuses propriétés. Il est généralement transparent et peut être coloré en de nombreuses teintes. Il est dur, ce qui signifie que sa surface est difficile à rayer. Au demeurant il est fragile, il se casse facilement. Cette fragilité du verre n’est pas due à sa structure amorphe qui serait plutôt résistante, mais à l’existence de microfissures à la surface du verre, qui en se propageant conduisent à la rupture du verre. On peut d’ailleurs rendre un verre très résistant aux chocs en bloquant la propagation de ces fissures par un traitement physico-chimique approprié… mais cher ! Le verre est inerte chimiquement, ou plutôt très faiblement attaquable. C’est ce qui fait notamment la qualité du verre en tant qu’emballage de produits alimentaires ou pharmaceutiques. C’est un matériau complexe, dont la nature chimique comprend souvent 10 à 12 constituants, et pourtant bon marché. Les produits verriers les plus simples (vitrage, bouteilles…) se vendent au kilo à peu près au même prix que la pomme de terre, soit quelques francs au kilo ! Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses qualités, ses propriétés optiques, son état de surface, font que le verre est beau, et c’est ce qui fait de lui l’un des matériaux à la fois les plus anciens et les plus modernes de notre usage quotidien.
Le verre, matériau traditionnel e...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Introduction
- I - Enjeux de l’éducation et formation de demain
- II - L’homme et l’informatique : machines, connexions et agents
- III - La société informatique : vers la société de la communication et la société de surveillance
- IV - Artifices
- V - Exploration et exploitation de l’espace : une aventure et ses enjeux
- VI - Batteries, piles, atomes et moteurs biologiques : quelles énergies ?
- VII - Matériaux en tous genres : l’ancien et le nouveau
- VIII - Les pollutions et leurs remèdes
- IX - La société du risque et de l’extrême
- Les auteurs
- Table