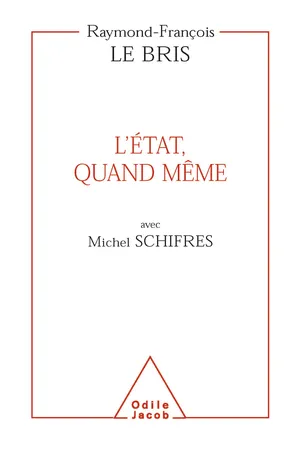
- 320 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
L' État, quand même
À propos de ce livre
Comment pallier les insuffisances de l'État ? Quelles voies choisir pour les surmonter ? Quel projet présenter aux agents publics pour qu'ils adhèrent à l'ambition d'une administration plus soucieuse du citoyen, plus efficace, plus transparente ? Comment mieux tirer parti des initiatives qui réussissent ? À la lumière de sa longue expérience et des combats qu'il a menés, Raymond-François Le Bris livre son regard sur cet État qui, malgré les critiques, doit rester le garant de notre unité, de notre sécurité, de notre cohésion, de nos valeurs partagées. La réforme de l'État est nécessaire. Elle est attendue. Elle est possible ! Préfet honoraire, agrégé des facultés de droit et de sciences économiques, Raymond-François Le Bris a notamment été directeur général de la chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris et directeur de l'École nationale d'administration. Michel Schifres est journaliste. Il est vice-président du comité éditorial du Figaro.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L' État, quand même par Raymond-François Le Bris,Michel Schifres en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politics & International Relations et Politics. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Chapitre V
Comment recruter, nommer, diriger
Michel Schifres : Les jeunes entrent sur le marché du travail relativement tardivement. Quelles en sont les conséquences ?
Raymond-François Le Bris : Ce phénomène concerne autant le secteur privé que la sphère publique, pour la plupart des emplois non manuels ainsi que pour les fonctions d’encadrement. Pour ces types d’emploi, l’âge d’accès au premier métier se situe vers 25-26 ans. Ce moment, en même temps qu’il marque l’accès aux premières responsabilités professionnelles, traduit par ailleurs un vrai décalage entre d’une part l’autonomie de vie personnelle, qui caractérise le mode de fonctionnement des jeunes générations depuis deux décennies environ, et le système scolaire ou universitaire dans son ensemble d’autre part.
Il y a en effet désormais, entre les modes de vie personnelle que choisissent les jeunes générations, sitôt la majorité civile acquise, quelquefois même bien avant, et les situations de dépendance matérielle et intellectuelle où les place un régime d’études prolongées, une profonde distorsion. Il y a cinquante ans ce phénomène concernait moins de 5 % d’une classe d’âge ; il intéresse aujourd’hui près de 70 % du même ensemble. En effet, cet âge d’accès aux premières responsabilités pour l’encadrement introduit un phénomène de « contagion » dans l’ensemble du dispositif français. Même lorsque l’on ne se destine pas, au départ, à des fonctions d’encadrement parce que, à cette période de la vie, on n’a ni le goût ni la volonté de poursuivre de longues études, par une sorte d’effet mécanique, on va être conduit à les prolonger. Les personnes concernées vont ainsi se trouver placées à un niveau de qualification et de connaissances très largement supérieur à celles que la nature des fonctions auxquelles elles postulent requièrent.
Très fréquemment en effet, pour des emplois de catégorie B ou C dans la fonction publique, les candidats présentent, aujourd’hui, des niveaux de diplôme très largement supérieurs aux rémunérations proposées et aux responsabilités à exercer, au moins dans un premier temps. Si l’on veut faire tant d’études avant de postuler à un premier emploi, ce n’est pas nécessairement parce que les études passionnent ou que l’on se sent porté à les poursuivre – au moins sous cette forme et à cet âge –, c’est parce qu’une certitude s’est ancrée dans l’opinion : plus on sédimente les diplômes, plus on a de chances de réussir, y compris aux concours administratifs qui permettent d’accéder à des fonctions moyennes. À cet égard, au nombre des rôles qu’assument les grands recruteurs que sont l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, les entreprises publiques, celui qui consisterait à faire passer le message selon lequel on peut accéder à des fonctions tout à fait intéressantes, même si l’on achève sa première formation à bac+2, serait certainement utile. Le juste corollaire de ce dispositif devrait être que le système de promotion individuelle ultérieure soit très largement reconnu et développé tout au long de la vie professionnelle, quel que soit le niveau initial de recrutement.
Nous retrouvons ici ce concept de deuxième chance sur lequel je me suis déjà beaucoup étendu en répondant à votre question sur « la tyrannie du diplôme initial ». En effet, quelque secteur l’on considère, l’introduction généralisée de cette possibilité donnée à des personnes, ayant quitté le système scolaire plus tôt que la moyenne (entre 21 et 22 ans), de pouvoir, au moment où elles le souhaiteraient, redéfinir un parcours, valider, y compris universitairement, des acquis et être promues en conséquence me paraît constituer une réforme essentielle. De sa mise en œuvre découlent aussi d’autres conséquences : et notamment celle qui consisterait à imposer à tous ceux qui ont bénéficié d’un régime prolongé d’études et d’un niveau élevé d’accès au premier emploi de devoir, eux-mêmes, faire la preuve récurrente de leur adaptation à leurs fonctions, les passages d’un niveau de responsabilité à un autre plus élevé étant subordonnés à des tests de qualifications organisés à partir d’une formation continue.
Un tel système de motivations et d’adéquations permanentes de la personne à la fonction n’est en effet concevable que s’il concerne tout le monde quel qu’ait été le niveau initial d’accès dans les différents corps de la fonction publique. Chacun serait ainsi assuré que toutes les voies lui sont ouvertes pour le futur, quelle qu’ait été la durée initiale de ses études. Cette sorte de « focalisation » sur le devenir individuel, grâce aux changements structurels qu’induirait la généralisation de la seconde chance, me paraît pouvoir constituer, dans notre société, un puissant aiguillon de changement. Aiguillon d’autant plus nécessaire que la durée de vie active de la population française se rétrécit dangereusement.
Il s’agit là d’une nouvelle spécificité de notre pays. Car, pour ne considérer que trois exemples étrangers, celui de l’Allemagne, celui des États-Unis et celui de l’Espagne, dans ces trois grands pays partenaires les jeunes accèdent beaucoup plus tôt aux premières responsabilités professionnelles : la généralisation de la formation en alternance en Allemagne, qui implique la présence sur les lieux de travail à un âge plus précoce qu’en France, l’association d’activités à la poursuite des études aux États-Unis, qui conduisent ceux des jeunes Américains qui accèdent aux universités à combiner travail scolaire et poursuite de leurs études, l’existence de filières attractives de formations professionnalisantes, ont pour effet d’augmenter le nombre de jeunes actifs dans ces trois pays. Le taux d’activité des 15-24 ans est ainsi respectivement de 45 % en Allemagne, de 60 % aux États-Unis, de 42 % en Espagne, contre seulement 26,5 % en France1 !
En France, l’âge d’accès au premier emploi est donc extrêmement plus tardif que dans la plupart des autres grands pays développés. Par ailleurs, les fins d’activité dans notre pays sont beaucoup plus précoces : 37 % des Français, seulement, continuent d’être en activité au-delà de 54 ans, contre 56 % aux États-Unis (les chiffres en Allemagne et en Espagne sont comparables aux nôtres).
Ces chiffres peuvent surprendre, surtout quand on se rappelle les débats passionnés, au printemps 2003, autour des 40 annuités minimum et des 60 ans d’âge requis pour faire valoir ses droits à la retraite.
Telles sont pourtant les données.
Si l’on ajoute à ces considérations le faible taux d’entrepreunariat en France, c’est-à-dire le rapport qui existe entre le nombre de propriétaires d’entreprises et le total des actifs (8,5 % par rapport à la moyenne OCDE, qui est de 11,1 %, ce qui place notre pays dans les tout derniers), on mesure mieux toutes les faiblesses structurelles qui affectent notre vitalité2. Ce phénomène traduit tout à la fois une dérive des systèmes éducatifs et de tout ce qui a conduit à la spécificité française, les régimes spéciaux de retraite et les préretraites notamment.
Pour rompre avec cette situation, il est nécessaire d’ouvrir de nouvelles étapes dans la carrière individuelle des agents publics, d’en faciliter la réorientation (en fonction de l’âge, de la motivation et de la condition physique). Et ce, quel que soit le niveau initial de recrutement, le corps d’affectation et les diplômes sur la base desquels le recrutement s’est effectué. Parmi les solutions à mettre en œuvre pour faciliter l’augmentation des taux d’activité en France, il faut à mon sens intervenir aux deux extrêmes de la vie professionnelle : quand elle débute et quand elle est sur le point de s’achever. S’agissant du départ tout d’abord, l’incitation à commencer plus tôt pour faire que le premier emploi coïncide mieux avec le niveau de diplôme obtenu paraît constituer une bonne piste. La condition essentielle au succès d’une telle réforme passe par une large reconnaissance de l’expérience professionnelle et un droit à la formation continue qui, compatible avec les engagements professionnels, ouvre à chacun une deuxième chance et des possibilités de promotions et de réorientation tout au long de la vie. S’agissant de l’autre terme, celui de la vie professionnelle qui prend fin, l’augmentation du taux d’activité passe par des mesures précises et audacieuses en ce qui concerne la « réemployabilité » des « seniors ». Les plans successifs, que l’on voit se dérouler au rythme des alternances politiques depuis plus de trente ans, ont montré leurs limites : la meilleure illustration en est le taux d’activité des Français au-delà de 54 ans. Il faut donc reprendre la question à sa source et tout d’abord à partir de la motivation des salariés, qu’ils relèvent du secteur privé ou du secteur public.
Quels champs nouveaux d’expertise le professeur, qui enseigne l’anglais, la géographie, les mathématiques ou l’histoire depuis quinze ou vingt ans à des classes de niveau identique dans un même collège ou lycée, souhaite-t-il respectivement découvrir ou acquérir ? Comment l’y préparer ? Comment concilier le régime de retraite pour lequel il a cotisé depuis qu’il est entré dans la fonction publique avec celui dont il va relever s’il fait le choix de poursuivre sa vie active dans une autre administration, dans un établissement public ou dans une entreprise relevant du secteur privé ?
De la même manière, la question se pose aussi de savoir comment on doit permettre à des salariés du secteur privé, guettés par la même lassitude des gestes répétés et d’un métier définitivement exploré, de se préparer à de nouvelles missions, y compris d’enseigner à temps partiel ou à temps plein et à formaliser ainsi pendant le reste de leur vie active ce qu’ils ont, dans un premier temps, si bien accompli dans la réalité de leur métier.
Ces questions ne peuvent être éludées au moins pour deux raisons : l’allongement de la durée de la vie active, lié à une progression considérable de l’espérance de vie et à un équilibre des régimes de retraite, impose à l’évidence que soit traité le problème de la réorientation professionnelle des actifs vieillissants. Par ailleurs, le besoin de sens, l’acceptation de la flexibilité, la reconnaissance de l’expérience, valeurs autour desquelles se retrouvent de plus en plus de Français, constituent autant d’incitations à poser en termes renouvelés la question de « l’employabilité » des seniors : en d’autres termes, comment maintenir un haut niveau d’intérêt à l’exercice d’une profession au-delà de 50 ans ?
À l’opposé, il faut également accepter que certaines missions au cœur du service public, parce qu’elles ne peuvent être exercées que par des personnels jeunes, puissent faire l’objet d’un traitement spécifique. On peut à cet égard citer le cas des sapeurs-pompiers professionnels, celui des fonctionnaires de police et des gendarmes. Chacun sait qu’il s’agit là de métiers essentiels à la sauvegarde de la sécurité et des libertés mais qui sont dangereux et physiquement éprouvants. Pour être bien assumés, ils exigent chez ceux qui les exercent une condition physique exceptionnelle. Or, avec le temps, celle-ci s’altère, de sorte que les responsables chargés de la gestion de ces corps se trouvent placés devant de grandes difficultés d’« employabilité » pour ceux des fonctionnaires qui n’ont pas bénéficié de promotions dans d’autres corps ou métiers où l’engagement physique est moins essentiel. Le corps des sapeurs-pompiers de Paris a trouvé la solution en recrutant, pour une durée maximale de quinze ans, de jeunes volontaires qui, passé ce temps d’engagement, retrouvent aux alentours de 35-40 ans une seconde vie professionnelle, et perçoivent immédiatement, au terme de leur engagement initial, une retraite.
Pourquoi ce qui se fait pour les sapeurs-pompiers de Paris ne pourrait-il être étendu pour partie au corps des fonctionnaires de police en uniforme ou aux gendarmes sous la forme d’un contrat de quinze années ? À l’expiration de cette période, ceux des fonctionnaires ou militaires qui auraient été promus ou affectés à des missions plus administratives ou d’encadrement pourraient poursuivre, les autres étant préparés à exercer d’autres fonctions plus compatibles avec leur âge dans le secteur public ou dans le secteur privé. La sécurité publique y gagnerait certainement en efficacité et les fonctionnaires ainsi réorientés, après qu’aient été liquidés leurs droits à retraite, en intérêt de métier.
De telles orientations permettent également de poser en termes renouvelés la question des limites d’âge spécifiques à chaque corps pour lesquelles les fins d’activité précoces constituent une charge considérable pour les régimes de retraite de la fonction publique et donc pour les finances publiques.
Ces orientations mettent évidemment profondément en cause la césure historique public/privé qui marque l’histoire de notre République depuis 1946. Cette séparation absolue engendre aujourd’hui des effets néfastes qui sont perceptibles dans de nombreux domaines : celui de la santé publique où la séparation totale entre la médecine de ville et l’activité hospitalière provoque aujourd’hui un engorgement des services d’urgence et des dysfonctionnements graves dans l’accueil hospitalier pour des affections aiguës ; celui de la recherche, du fait des faibles liens entre les activités publiques dans ce domaine et les initiatives privées ; la gestion de tous les corps de fonctionnaires dans une perspective de fonction publique de carrière pour l’ensemble des agents, quelles que soient la nature des missions, leur proximité plus ou moins grande avec le service public, participe de cette même idée d’une infranchissabilité de la fonction qui sépare le privé du public.
C’est aussi sur ce point qu’il convient de faire évoluer le dispositif : la création de contrats de longue durée pour des agents dont la mission, quoique pérenne, nécessite, pour être exercée, des qualités physiques particulières (sapeurs-pompiers, agents de police, gendarmes) assorties de l’obligation pour l’administration de préparer leur sortie et leur insertion dans un nouveau métier, privé ou public ; l’externalisation de toute une série d’activités qu’avec le temps l’administration a assumées et dont le rapport avec le service public n’est pas évident (activités d’accueil et d’information, services accessoires, fabrication de documents, services généraux), la mise en place d’un partenariat actif entre les laboratoires publics de recherche et des institutions privées… constituent autant de formes que pourrait prendre la nouvelle relation public/privé.
Outre qu’une telle démarche répond aux attentes des citoyens, telles que les révèlent régulièrement analyses d’opinion et enquêtes lourdes, elle aurait également pour conséquence de réduire les dépenses de fonctionnement des administrations publiques, quelles qu’elles soient, car ce qui est vrai des fonctionnaires de police d’État l’est également des policiers municipaux, pour autant que soit prolongée cette étrangeté qui fait partager une mission régalienne de l’État avec des fonctionnaires relevant d’autorités locales.
Nous aurons l’occasion d’y revenir.
MS : Aujourd’hui, dans la fonction publique, comment les nominations se déroulent-elles ?
RFLeB : Très largement d’abord à partir d’un concours. La fonction publique d’État recrute chaque année environ cinquante mille agents. À certains moments, le processus s’accélère : c’est actuellement le cas du fait des départs successifs en retraite, de sorte que le nombre d’agents recrutés pourrait atteindre soixante-dix mille personnes par an pour les périodes à venir.
Quoique plus spécifiques, les recrutements de la fonction publique territoriale ou dans les hôpitaux obéissent à des règles comparables : concours sur titres, sur dossier, sur épreuves, inscriptions sur des listes d’aptitude après que les candidats aient été testés, on retrouve ici, ainsi déclinées de manière adaptée, les règles qui font des concours la clé de voûte des recrutements dans la fonction publique.
Le principe constitutionnel d’égalité et les textes que cette règle a inspirés expliquent cette situation. Chaque ministre a la responsabilité d’organiser les recrutements pour les fonctionnaires qu’il gère et dont le déroulement de carrière est organisé par corps. Il existe aujourd’hui environ neuf cents corps actifs dans la fonction publique d’État pour lesquels il est encore procédé à des recrutements.
Seuls échappent à cette définition les agents dont la fonction est, par nature, interministérielle et dont les carrières peuvent – en principe – se dérouler successivement dans diverses administrations : il s’agit notamment des administrateurs civils, qui sont recrutés et formés par l’École nationale d’administration, ou bien seulement formés par elle avant d’être nommés. Mais, à dire vrai, dans les faits, cette interministèrialité de fonctions et d’affectations est plus théorique que pratique : les responsables des ressources humaines dans chaque ministère interviennent peu dans la définition des programmes qui vont être enseignés à leurs futurs agents. Par ailleurs, ceux-ci, après qu’ils aient reçu leur première affectation vont, pour plus de 65 % d’entre eux, demeurer en fonction dans le ministère où ils ont été initialement nommés. Je ne puis, en rappelant ces quelques données, m’empêcher d’évoquer ici un souvenir. Soucieux d’affirmer le caractère interministériel de l’ENA – que traduit d’ailleurs son rattachement direct au premier ministre –, j’avais, dans la conception que je me faisais de ma mission, celle d’être un prestataire de services pour le compte d’administrations utilisatrices, décidé de réunir tous les responsables des ressources humaines des différents ministères où les élèves reçoivent une affectation à leur sortie de l’École. L’objectif était clair : recenser leurs observations sur l’adaptation des élèves sortis de l’École aux missions que les administrations où ils avaient choisi de servir leur confiaient ; identifier les lacunes et les insuffisances observées par ces responsables des ressources humaines chez leurs jeunes recrues ; recueillir leurs observations, suggestions et commentaires… pour les traduire ensuite en tant que de besoin dans la scolarité des élèves, après en avoir discuté avec mes collaborateurs et soumis les propositions qui en étaient résultées aux instances délibérantes de l’École.
L’affaire fit long feu. Grande émotion à la direction générale de l’administration. Un directeur d’école s’avisait de consulter directement les utilisateurs au mépris de la règle non écrite selon laquelle, dans l’administration, les relations latérales sont suspectes, et que, pour être bien menée, toute initiative doit suivre un double cheminement ascendant/descendant… avec retour dans le meilleur des cas ! Quand j’évoquais plus haut « le temps particulier de l’administration », c’est aussi à ce type de pratiques que je pensais…
Pourtant, le principe hiérarchique qui structure la vie administrative n’a jamais signifié que les relations latérales de service à service soient interdites ou même déconseillées. A fortiori si l’initiative relève d’un directeur d’établissement public qui, dans le respect du principe de spécialité, souhaite, comme c’était le cas en l’espèce, faire évoluer un dispositif de recrutement et de formation dont il était chargé vers une meilleure réponse aux besoins des administrations utilisatrices.
L’affaire connut néanmoins deux prolongements. Le directeur général de l’administration, reprenant à son compte cette démarche, décida sur la base du principe hiérarchique de convoquer lui-même tous les responsables des ressources humaines, en fait les directeurs de l’administration générale et des personnels des différents ministères, pour mieux analyser leurs attentes en matière de formation et… de m’en tenir informé…
Quant à moi, pour « sortir du bocal », je décidai de créer un comité d’analyse et de prospective composé ad personam de représentants de la société civile et de quelques hauts fonctionnaires ; ce groupe, dont le président du conseil d’administration que je tenais régulièrement informé de mes initiatives et de mes projets avait approuvé l’idée, se réunit régulièrement à partir d...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Préface
- Chapitre I - L’ENA dans l’État
- Chapitre II - La tyrannie du diplôme initial
- Chapitre III - Le rejet des énarques
- Chapitre IV - Le temps particulier de l’administration
- Chapitre V - Comment recruter, nommer, diriger
- Chapitre VI - L’administration est-elle gérée ?
- Chapitre VII - Le nouvel État
- Conclusion