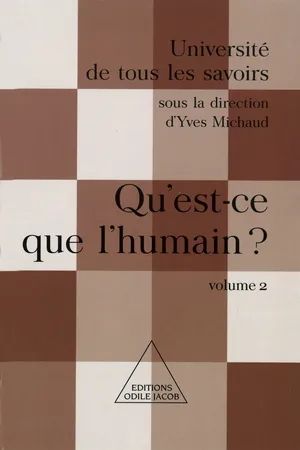
- 608 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Les plus grands spécialistes français sont réunis dans ce volume. Ils éclairent les grandes questions que posent le langage, le droit, la démographie et l'économie mondiale, l'alimentation, la santé. Éric Arnaud, Alim-Louis Benabid, Guy Bernfeld, Claire Blanche-Benveniste, Gilles Brisson, Patrice Cayré, Bernard Cerquiglini, Jean-Claude Chesnais, Anne Christophe, Pierre Corvol, Patrick Cozzone, Laurence Danlos, Olivier Danos, Bernard David, Philippe Denormandie, Jean-Yves Devaux, Dominique Dormont, Roland Douce, Robert Ducluzeau, Oswald Ducrot, Claude Fischler, Jacques Fontanille, Philippe Froguel, Antoine Garapon, Jean-Yves Goffi, Marion Guillou, Jean Guyotat, François Héran, Marie-Angèle Hermitte, Didier Houssin, Gilles Johanet, Philippe Kourilsky, Bernard Laks, Claude Le Pen, Michel-Louis Lévy, Jean-Louis Mandel, Luc Montagnier, Gérard Pascal, Philippe Sansonetti, Thierry Sévenet, Didier Sicard, Dan Sperber, Alain Supiot, Jean-Louis Terra, Hervé This, Jacques Vallin, Jacques Vauclair, Dominique Vermersch, Jacques Véron, Geneviève Viney, Moshe Yaniv.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Qu'est-ce que l'humain ? par Yves Michaud en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Philosophie et Histoire et théorie de la philosophie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
VII
COMMENT NOUS SOIGNERONS-NOUS ?
La spectrométrie de résonance magnétique explore directement les réactions chimiques du cerveau humain1
par PATRICK CoZZONE
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) s’est imposée depuis une quinzaine d’années comme la modalité la plus puissante de l’imagerie médicale. L’IRM est à présent devenue une méthode d’exploration morphologique irremplaçable. À côté de l’IRM anatomique, d’autres applications se développent comme l’angiographie par résonance magnétique, l’IRM de diffusion et de perfusion (identification des zones de nécrose, mesure du débit et du volume sanguin cérébral…), et l’IRM fonctionnelle qui est particulièrement adaptée à l’étude des fonctions cognitives, sensorielles et motrices du cerveau. Par un effet d’addition, ces applications ouvrent de nouvelles voies dans l’exploration anatomique, dynamique (flux sanguin) et fonctionnelle du cerveau. Le caractère non-invasif des méthodes utilisant l’IRM entraîne également un effet de substitution par rapport à certaines méthodes établies qui utilisent par exemple l’injection de produits de contraste iodés ou d’isotopes radioactifs, l’introduction de cathéters ou l’exposition à des radiations ionisantes. Une autre application en développement rapide est la spectrométrie de résonance magnétique (SRM) qui est basée sur le même phénomène physique que l’IRM et utilise les mêmes équipements. Dans les deux cas, les sujets sont placés dans des aimants et les zones corporelles étudiées sont soumises à des ondes radio non-ionisantes (gamme des mégaHertz). L’analogie s’arrête là car il existe des différences fondamentales dans les contributions que l’IRM et la SRM apportent dans la pratique médicale. La SRM permet d’obtenir des renseignements précis non plus sur les structures anatomiques des organes et des tissus et les flux liquidiens qui leur sont associés, mais sur le métabolisme (intermédiaire, oxydatif, lipidique…) des cellules qui les composent, sans altérer leur intégrité car les énergies mises en jeu sont extrêmement faibles (quelques millijoules). La SRM in vivo offre une véritable « photographie métabolique » des cellules en fournissant des informations en temps réel sur les différentes réactions biochimiques du métabolisme au fur et à mesure qu’elles se produisent. Le caractère non invasif et indolore de la SRM in vivo constitue un avantage considérable car le chercheur et le clinicien disposent ainsi d’une méthode d’investigation respectant rigoureusement l’intégrité structurale et fonctionnelle de l’organe étudié. Des expériences répétitives peuvent être conduites sans danger sur l’homme pour obtenir des informations dynamiques et cinétiques sur les événements métaboliques survenant dans les organes, et notamment le cerveau.
Pratiquement, la SRM cérébrale peut être réalisée sur les équipements cliniques d’IRM à 1,5 Tesla au prix de quelques adaptations des appareillages et des logiciels. L’exploration métabolique du cerveau par SRM est réalisée en quelques minutes, à la suite de l’examen classique par IRM, sans avoir à mobiliser le sujet et sans aucune injection. En IRM, on détecte les signaux émis par les protons (noyaux des atomes d’hydrogène) des molécules d’eau des cellules, en les codant dans les 3 dimensions de l’espace par des gradients de champ magnétique et en les excitant par des trains d’impulsions de radiofréquences. L’image anatomique par résonance magnétique est ainsi le résultat d’une cartographie reflétant la distribution des molécules d’eau dans deux ou trois dimensions de l’espace selon que l’on analyse une coupe ou un volume. La SRM cérébrale est basée sur la résonance des protons portés par de nombreux métabolites de la glie et des neurones. Ces protons appartenant à des molécules ou des groupements chimiques différents ne résonnent pas tous à la même radiofréquence (contrairement au cas des molécules d’eau en IRM) et leurs signaux se distribuent sur un « spectre » de fréquences différentes caractéristiques des métabolites cérébraux qui leur donnent naissance (Fig.).

Figure – Spectrométrie de résonance magnétique du cerveau (CEMEREM-CRMBM, UMR CNRS no 6612, Marseille).
Spectre de résonance magnétique cérébrale enregistré en 3 minutes et montrant la présence des lipides, du N-acétyl aspartate (NAA), de l’acide glutamique et de la glutamine (Glx), de la créatine totale (tPCr), des dérivés de la choline (Cho) et de l’inositol (Ins). Le volume analysé est un cube dont la localisation pariéto-occipitale dans le cerveau est visualisée dans les trois directions de l’espace sur les 3 images obtenues par IRM cérébrale conventionnelle.
L’intensité des signaux respectifs constituant le spectre est proportionnelle à la concentration cellulaire des molécules qui leur correspondent. La SRM offre ainsi à la fois l’identification et le dosage simultané de plusieurs métabolites cérébraux. Pour être pleinement utilisables, les données spectrométriques doivent provenir d’une région du cerveau parfaitement localisée et connue. Par des combinaisons de gradients de champ magnétique et d’impulsions de radiofréquences on peut sélectionner dans n’importe quelle région du cerveau un volume élémentaire d’intérêt (appelé voxel) qui est en général un cube ou un parallélépipède de 1 à quelques millilitres de volume dont les signaux de SRM sont enregistrés en quelques minutes. Cette spectrométrie monovoxellienne est illustrée dans la Figure 1. De façon alternative, on peut acquérir simultanément les signaux de SRM émis par l’ensemble des voxels contigus constituant une coupe entière du cerveau. On utilise alors pour repérer dans l’espace les signaux des protons des métabolites cérébraux, des méthodes de localisation bidimensionnelle analogues à celles utilisées en IRM pour repérer les signaux émis par les molécules d’eau. On obtient alors en moins de 10 minutes plusieurs dizaines de spectres de résonance magnétique provenant de l’ensemble des voxels (en général d’un volume unitaire de 1 millilitre) définissant un plan du cerveau. On peut soit analyser les spectres les uns après les autres, soit créer une image de chacun des métabolites présents sur les spectres, et la superposer éventuellement à l’image de l’eau (IRM) pour établir une corrélation fine entre métabolisme et anatomie. La résolution spatiale est supérieure à celle obtenue en médecine nucléaire (scintigraphie, tomographie par émission de positons). Cette méthode constitue l’imagerie métabolique par SRM.
La biochimie du cerveau explorée in vivo par SRM est différente de la neurochimie classique. En effet, les molécules détectées appartiennent aux pools des métabolites cellulaires d’origine gliale, neuronale et membranaire et non pas seulement au pool des molécules synaptiques comme c’est très souvent le cas dans les études habituelles en neurochimie. Le spectre cérébral humain porte le signal d’un marqueur spécifique « naturel » des neurones, le N-acétyl-aspartate (NAA) qui est considéré comme un index de « santé » des neurones. La SRM détecte également l’inositol (Ins) qui est un marqueur d’activation métabolique gliale et un osmolyte cérébral majeur. Des molécules impliquées dans le métabolisme des lipides membranaires comme les dérivés de la choline (Cho) et les acides gras, des métabolites importants tels que le lactate (métabolisme énergétique), des acides aminés (glutamate, glutamine, aspartate, taurine, glycine…), le couple créatine-phosphocréatine (tCr) comme index de cellularité peuvent être également détectés.
La SRM devient l’examen para-clinique de choix dans l’exploration de la souffrance métabolique cérébrale car elle permet de la quantifier et, dans certains cas de la qualifier (identification précise du processus pathologique). Toute souffrance neuronale entraîne une réduction quantifiable du signal de NAA, éventuellement réversible sous l’effet d’une thérapeutique appropriée (médicaments). C’est ainsi que sur un même spectre on peut avoir une idée de la compétence métabolique des neurones, tout en disposant simultanément de marqueurs en faveur d’une anomalie métabolique précise. Les modifications du signal de l’inositol indiquent soit le degré d’activation de la glie (gliose active si le signal est augmenté), soit au contraire des anomalies de la régulation osmotique cérébrale (encéphalopathies hépatiques, si diminué). La présence (souvent labile) de lactate indique, selon le contexte, soit une activation de la glycolyse anaérobie, soit l’envahissement macrophagique d’une lésion ancienne. Enfin les variations conjointes ou non des signaux de la choline et des lipides libres renseignent sur les lésions des membranes cellulaires (démyélinisation active), sur la surcharge en acides gras (adrénoleucodystrophie), sur un processus inflammatoire (sclérose en plaques), sur une diminution du renouvellement des membranes (diminution des précurseurs). Cette liste d’événements n’est évidemment pas limitative. La mise en jeu de méthodes d’analyses statistiques multiparamétriques et de réseaux neuronaux contribue à l’analyse globale des multiples variations présentes sur les signaux métaboliques caractérisant un spectre cérébral.
Plus de mille publications internationales ont déjà été consacrées à l’étude par SRM des pathologies cérébrales focales et diffuses. À Marseille, une équipe pluridisciplinaire de cliniciens, de chercheurs et d’ingénieurs (notamment F. Nicoli, S. Confort-Gouny, Y. Le Fur, J.-P. Ranjeva, B. Denis, P. Viout, M. Izquierdo, E. Cabannes) travaillant au CEMEREM (Centre d’exploration métabolique par résonance magnétique, UMR CNRS no 6612, hôpital de la Timone) et disposant à présent d’un appareil de SRM/IRM Siemens vision plus à 1,5 Tesla particulièrement performant a acquis au fil des années une compétence étendue à la fois dans le développement des techniques de la SRM cérébrale humaine et dans l’évaluation de leurs applications aux pathologies cérébrales dans un contexte clinique.
L’expérience de cette équipe et les données de la littérature permettent de préciser les principales indications actuelles des techniques de SRM en neurologie. De façon non exhaustive, ces indications concernent toutes les encéphalopathies métaboliques (toxiques, génétiques par erreur innée du métabolisme), les encéphalopathies virales (notamment les encéphalopathies liées au VIH), les épilepsies (détermination de la zone épileptogène), les pathologies neurodégénératives auxquelles des dysmétabolismes sont de plus en plus fréquemment associés (maladie de Huntington, maladie de Parkinson, les atrophies multisystémiques), les démences (le niveau d’inositol cérébral et les tests neuropsychologiques sont corrélés dans la maladie d’Alzheimer).
Dans les tumeurs cérébrales, la SRM contribue par exemple à l’appréciation du caractère évolutif de certaines lésions, au diagnostic différentiel entre récidive et radionécrose différée, entre tumeurs et abcès cérébraux. Les indications s’étendent à l’évaluation de la zone de pénombre de l’accident vasculaire, à celle de la zone œdémateuse péritumorale, à la substance blanche en apparence normale (en fait pathologique) qui entoure les lésions de sclérose en plaques. Chez l’enfant, la SRM cérébrale apporte son concours à la compréhension de la maturation cérébrale, à la caractérisation des pathologies de la substance blanche dont environ 40 % demeurent d’origine inconnue et au suivi thérapeutique (quand la thérapeutique existe). Une nouvelle encéphalopathie avec anomalie de la créatine a même été décrite sur la base de l’analyse des spectres cérébraux. Dans des situations d’hypoxie chez le nouveau-né ou le jeune enfant, la SRM évalue l’atteinte métabolique cérébrale alors que les signes IRM ou échographiques sont ambigus ou discrets (la présence de lactate et la baisse du rapport NAA/Cho sont des facteurs de mauvais pronostics).
Dans toutes ces applications la SRM caractérise et quantifie la souffrance cérébrale au niveau glial, neuronal et membranaire sur une base moléculaire et métabolique. Elle contribue au diagnostic, au bilan de gravité et au pronostic. Elle objective l’évolution et le suivi thérapeutique (radiothérapie, greffe de moelle, chirurgie, médicaments…). Parfois, les déviations métaboliques identifiées par SRM sont infracliniques et sans anomalies apparentes en IRM. Le cas du diagnostic précoce par SRM cérébrale des complications neurologiques du sida est particulièrement illustratif à cet égard. On peut ainsi, selon la nature et le type d’évolution de l’encéphalopathie, gagner plusieurs mois dans l’instauration des traitements, et donc dans la protection du capital neuronal et glial.
Plusieurs raisons expliquent le développement rapide de la SRM in vivo pratiquée sur le cerveau. La SRM, par la nature et la richesse des informations biochimiques qu’elle fournit, apporte une vision radicalement nouvelle de l’état métabolique cérébral (pool des métabolites), dont les bases ont été incomplètement décrites par la neurochimie conventionnelle. Il convient à présent de construire une séméiologie métabolique de la souffrance cérébrale explorée par SRM qui ne s’oppose d’ailleurs pas à la neurochimie synapti...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Introduction
- I - L’homme face à l’animal
- II - Les signes et le sens
- III - Justice, responsabilité et contrat : le droit en mouvement
- IV - Démographie, croissance et mondialisation : les enjeux du nombre
- V - Alimentation, cuisine et usines
- VI - Perspectives sur les maladies
- VII - Comment nous soignerons-nous ?
- VIII - Santé, industrie et solidarité
- Les auteurs
- Table