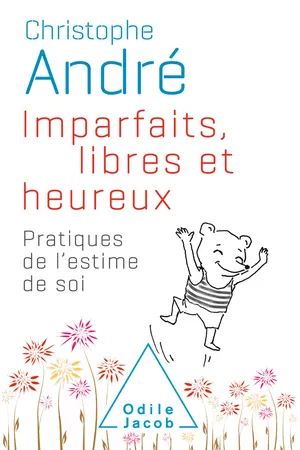
- 480 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Être enfin soi-même. Ne plus se soucier de l'effet que l'on fait. Agir sans craindre ni l'échec ni le jugement. Ne plus trembler à l'idée du rejet. Et trouver tranquillement sa place au milieu des autres. Ce livre va vous aider à avancer sur le chemin de l'estime de soi. À la construire, la réparer, la protéger. Il va vous aider à vous accepter et à vous aimer, même imparfaits. Non pour vous résigner, mais pour mieux évoluer. Imparfaits, mais libres et heureux... Christophe André est médecin psychiatre. Il a notamment publié L'Estime de soi (avec François Lelord), Et n'oublie pas d'être heureux, et Sérénité qui sont d'immenses succès. Imparfaits, libres et heureux est un best-seller mondial.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Imparfaits, libres et heureux par Christophe André en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Psychologie et Histoire et théorie en psychologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
TROISIÈME PARTIE
Vivre avec les autres
CHAPITRE 20
La douleur insoutenable du rejet social
« Malheur à celui qui est seul ! »
L’Ecclésiaste, 4, 10
Vous avez accepté de participer à une expérience de psychologie au laboratoire de votre université. Après vous avoir fait passer un test de personnalité, le chercheur qui vous a reçu vous en donne les résultats : « Désolé, mais vous avez tout à fait le profil psychologique des personnes qui terminent leur vie dans la solitude, incapables de rester durablement dans des relations épanouissantes. » Et toc ! Puis, on vous fait passer dans une autre pièce, sous le prétexte de vous proposer un second test. Dans cette pièce, deux chaises. L’une est disposée face à un miroir, l’autre face à un mur nu. Sur laquelle allez-vous vous asseoir ? Si vous venez de recevoir cette sinistre prédiction, vous choisirez de préférence la chaise qui tourne le dos au miroir (90 % des sujets). Si, au contraire, vous avez eu la chance de faire partie d’un autre groupe tiré au sort, à qui l’on annonçait une vie relationnelle heureuse, pleine d’affection et de liens durables, vous auriez choisi indifféremment l’une ou l’autre des chaises1. Se voir un avenir en rose ne pousse donc pas à l’adulation de soi ; le pressentir morose et solitaire incline par contre à ne plus rechercher ni supporter son image.
« Je ne pouvais plus me regarder dans la glace »
J’entends souvent des patients me raconter comment ils ont évacué tous les miroirs de leur domicile, comment ils ne supportent plus leur image, comment ils s’écartent dès que sortent appareils photo ou caméras. Il s’agit presque toujours de personnes souffrant de troubles de l’estime de soi, de sentiments permanents de désamour. Et qui ont, effectivement, un vécu de rejet social chronique.
Se sentir rejeté nous pousse à fuir notre image, qui nous revoie alors à quelque chose d’inconfortable, de douloureux : ce quelque chose, c’est nous… « Puisque les autres ne m’acceptent pas, comment pourrais-je m’accepter moi-même ? » Comme si nous étions coupables de ce rejet, comme si nous éprouvions du dégoût pour nous, du moins de l’aversion. Alors que nous sommes les victimes de ce rejet, alors que nous devrions nous consoler, nous nous écartons de nous, nous nous abandonnons.
La douleur du rejet
Nous savons tous à quel point l’expérience du rejet social est douloureuse. La plupart d’entre nous n’en ont éprouvé que des formes « mineures » : rupture amoureuse, exclusion d’un groupe ou d’une bande, parfois mise à l’écart au sein d’une entreprise. Quelques-uns ont vécu des rejets traumatisants, comme des humiliations publiques. D’autres, des rejets discrets, mais répétés, comme toutes les manifestations de racisme.
« Tous les jours, je prends le train dans ma banlieue chic. Tous les jours je suis en costume-cravate et je lis un journal chic. Et tous les jours, je suis la dernière personne à côté de qui l’on vient s’asseoir. Spécialement les femmes. Ce n’est que lorsqu’il n’y a plus de place ailleurs que l’on s’installe à côté de moi. Un jour que j’étais descendu derrière une de ces femmes, je l’ai vue agripper son sac fermement en m’apercevant derrière elle. Je suis devenu tellement hypersensible à tous ces trucs que maintenant, chaque fois qu’une femme blanche court devant moi, sans doute parce qu’elle est en retard, j’ai d’abord la pensée de me dire qu’elle a peur de moi. Ça démarre tout seul2… » Ce témoignage d’un citoyen noir américain, datant de 2002, rappelle l’usure et la sensibilisation représentées par les microrejets sociaux quotidiens. On peut hélas supposer qu’il reste d’actualité et s’applique aussi à l’Europe… Le racisme, ce n’est pas seulement s’entendre dire « sale Noir » ou « sale Arabe » ou « sale Juif » ou « sale Jaune » ou « sale Blanc », etc. C’est aussi tout ce contexte d’événements subtils, insignifiants ou inaperçus aux yeux des autres, qui finit par entraîner une hypersensibilité au rejet, dont les effets sont délétères : dès que l’on arrive dans un contexte où de tels microrejets pourraient bien survenir, on devient « parano », on est sur ses gardes, on surveille, on détecte et on amplifie. Parfois avec raison : le racisme existe bel et bien, sous de multiples formes et avec de multiples intensités et niveaux de conscience. Et parfois à tort : le détecteur, trop sollicité, est devenu trop sensible.
L’exemple du racisme est particulièrement éclairant car il montre bien comment il est infiniment plus douloureux – et révoltant – d’être rejeté pour ce qu’on est que pour ce qu’on a fait. On peut accepter qu’on ne veuille plus nous parler parce que nous avons dit du mal de quelqu’un, nous ne lui avons pas rendu son argent, etc. En revanche, avoir le sentiment qu’on s’écarte de nous parce que l’on est de race, de nationalité, de religion, de classe sociale… différentes représente une douleur bien plus destructrice.
Être rejeté au quotidien
Lors des expériences de rejet social organisées en laboratoire, l’un des faits les plus frappants est donc la netteté avec laquelle ces rejets provoquent des résultats douloureux, alors que les participants savent qu’ils ne vivent que des situations artificielles et transitoires, auprès de personnes qu’ils ne reverront jamais. Comme si un profond instinct nous signalait qu’il n’y a rien de plus dangereux pour nous que d’être rejeté par nos semblables. Même le rejet par des personnes inconnues et invisibles, ou dans des situations sans enjeu concret, comme le fait d’être ignoré lors d’échanges sur Internet, va entraîner des perturbations franches de l’estime de soi3.
Au quotidien, les situations équivalentes sont, par exemple, ne pas avoir de réponse à un courrier, à un mail ou encore à un coup de téléphone : d’où l’aversion pour les répondeurs qu’éprouvent les personnes ayant des problèmes d’estime de soi (plutôt ne pas laisser de message que prendre le risque de ne pas recevoir de réponse : cela ouvrirait tout grand la voie à des fantasmes de rejet). Il y a aussi celles et ceux qui, carrément, n’osent même pas téléphoner par peur de déranger, ou de mal tomber ; mais qui sont ravies qu’on les appelle (là, au moins, elles sont sûres que leur interlocuteur souhaite vraiment leur parler). Autres exemples de situations à risque pour l’estime de soi et l’activation de fantasmes de rejet : essuyer un refus et avoir l’impression que d’autres que nous ont reçu une réponse positive à la même demande ; ne pas être invité à une soirée où l’on aurait pu s’attendre à l’être ; ne pas être cité au milieu d’autres personnes au sein d’une liste plus ou moins valorisante (contributeurs à un projet, etc.) ; être désapprouvé ou critiqué…
Tout cela est évidemment aggravé s’il y a un public : on se sent alors rejeté par tous, ce qui est sans doute le comble de la douleur sociale. C’est pourquoi les moqueries marquant le rejet par un groupe d’un individu isolé et vulnérable sont si dangereuses. Elles sont fréquentes dans l’enfance et l’adolescence, et les parents doivent y prendre garde si leurs enfants en sont victimes. Il faut alors intervenir pour faire cesser les excès de ce rejet (qui peut vite tourner à la persécution) et aider l’enfant à s’appuyer sur un autre réseau amical. Le rejet par tout un groupe donne toujours un sentiment terrible d’isolement, au moment des moqueries, mais aussi, ensuite, lorsque la personne se retrouve seule : la douleur et l’humiliation, les ruminations sur l’éternité et la gravité du rejet entraînent, selon mon expérience de psychiatre, une élévation du risque suicidaire. Autre facteur très aggravant aussi : si les personnes qui nous rejettent sont normalement des proches ou des soutiens jusqu’alors supposés solides. Cela induit dans ces conditions un double sentiment de trahison et d’abandon, qui bouleverse la personne et annihile son envie de vivre. Les témoignages de telles douleurs existent depuis que l’humain écrit ses peines… Ainsi ce passage d’un psaume de la Bible4 :
« Je suis injurié par tous mes adversaires, /plus encore, par mes voisins ;/Je fais peur à mes intimes : s’ils me voient dehors, ils fuient./On m’oublie, tel un mort effacé des mémoires, /Je ne suis plus qu’un débris. »
Les perturbations liées au rejet
Si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, nous devrions avoir tendance, lorsque nous sommes l’objet d’un rejet, à tenter de comprendre pourquoi, et à réparer ce qui peut l’être. Hélas, le rejet entraîne souvent des comportements allant à l’encontre des intérêts de la personne5, et ces comportements vont encore accroître le risque pour elle de se faire rejeter à nouveau. Voici ce vers quoi nous risquons de tendre lorsque nous avons été rejeté, et contre quoi il faut donc se prémunir :
• Se comporter envers autrui de manière agressive6. Beaucoup de comportements et d’attitudes agressifs sont facilités par le rejet ou le sentiment de rejet : « Dans les moments où je me sens insécurisée, où j’ai peur de ne pas être à la hauteur, je me montre souvent désagréable par anticipation, je préfère ne pas être approchée plutôt qu’être rejetée. »
• S’isoler. C’est la tentation du repli sur soi, qui aggrave encore le problème car il laisse la personne seule face à ses émotions et pensées. Aller vers les autres en cas de rejet est la stratégie prioritaire : même s’ils ne nous comprennent qu’imparfaitement, même s’ils ne nous réconfortent pas totalement, même s’ils se montrent décevants dans la qualité de leur soutien, le pire serait de rester seul… C’est parfois très difficile à expliquer à nos patients hypersensibles au rejet : aller vers les autres non pas pour aller mieux ou se sentir consolé, mais comme un acte de survie, qui ne nous donnera pas forcément (même si c’est parfois le cas) de mieux-être immédiat, mais sera indispensable. Comme désinfecter rapidement une blessure : cela n’empêche pas d’avoir mal, mais diminue le risque de surinfection. La surinfection des expériences de rejet, c’est la paranoïa, l’autopunition, l’amertume, la misanthropie, toutes réactions qui vont grandir notre souffrance, et diminuer nos capacités à nous re-lier ultérieurement aux autres.
• Abîmer les liens existants avec les personnes proches. Alors que c’est justement auprès d’elles que nous pourrions trouver réconfort et soutien, l’hypersensibilité au rejet s’infiltre aussi, souvent, dans les relations conjugales par exemple et augmente le risque d’insatisfaction vis-à-vis de son conjoint7. Mécontentement et ressentiment peuvent aussi être déplacés sur notre famille, nos amis.
• Chez certains, les plus fragiles ou les plus usés par le rejet, la tentation se profile toujours, à un moment ou à un autre, de se faire du mal. On ressent l’envie obscure de s’automutiler, ou de s’autodétruire. La consommation brutale de toxiques comme l’alcool relève de cette dynamique de l’autodestruction, chez des femmes notamment, où l’on observe, après des rejets, l’absorption d’alcool fort jusqu’à l’ivresse, puis le coma. Les crises de boulimie, elles aussi, sont souvent déclenchées par des vécus de rejet social, même minimes (ne pas avoir de courrier dans sa boîte aux lettres, de message sur son répondeur, de mail dans son ordinateur : « tout le monde m’oublie, je suis seule… »), même supposés et sans preuves. Une vague de désarroi viscéral submerge alors la personne et la pousse à se nuire, au travers de la nourriture.
• Étonnamment, faire subir à quelqu’un, même en imagination, une expérience de rejet va gripper son intelligence. Il va alors moins bien s’y prendre face aux problèmes à résoudre et aux tests de QI8. Cet effet délétère ne paraît pas uniquement dû à l’impact émotionnel du rejet : ce n’est pas seulement parce que nous sommes triste ou inquiet de ce rejet que nos performances baissent, ni parce que nous ruminons sur notre infortune. Il semble bien qu’il existe une « onde de choc » inconsciente provoquée par la situation de rejet, qui mobilise et qui fige, en quelque sorte, notre énergie psychique. Le rejet nous diminue donc, pas seulement émotionnellement, mais aussi intellectuellement, au moins dans la période qui le suit immédiatement. Prudence alors avec les « grandes décisions » ou les « dossiers importants » de notre existence.
Attention, les blessures émotionnelles liées au rejet social ne sont pas toujours spectaculaires, elles peuvent être discrètes, torpides, comme on le dit en médecine d’un abcès qui évolue sans faire de bruit… Lorsqu’on étudie l’intensité de la détresse suivant un rejet, cette dernière n’est pas systématiquement intense. Du moins consciemment. Comme si nous étions équipés d’un mécanisme amortisseur de douleur. Cela peut être utile à court terme. Mais cette anesthésie peut avoir des effets pervers sur le long terme : sans doute destinée à nous éviter le désespoir lors des expériences de rejet du quotidien, forcément nombreuses lors d’une vie en société, et pas toutes dramatiques, elle peut aussi nous engourdir, ou donner une illusion d’indifférence à nos proches ou aux observateurs. Surtout lors de rejets répétés, habituels.
C’est par exemple ce qui se passe avec les exclus sociaux, clochards et marginaux, victimes depuis leur enfance de rejets à répétition, en général violents et massifs9 : il y a chez eux une grande fréquence de la « zombification » chez les plus ...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Du même auteur chez Odile Jacob
- Copyright
- Introduction
- Comment allez-vous ?
- Première partie - L'estime de soi‚ c'est tout ça
- Deuxième partie - Prendre soin de soi
- Troisième partie - Vivre avec les autres
- Quatrième partie - Agir‚ ça change tout !
- Cinquième partie - L'oubli de soi
- Conclusion
- Recommandations de lecture
- Notes bibliographiques
- Table