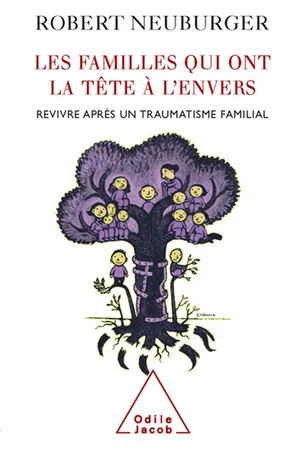
eBook - ePub
Les Familles qui ont la tête à l'envers
Revivre après un traumatisme familial
- 192 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Comment se libérer du passé quand il pèse trop lourd ? Comment se reconstruire après un drame, petit ou grand ? Comment retrouver le goût de vivre lorsque, dans sa famille, un événement plus ou moins ancien, connu ou méconnu, mais souvent sous-estimé, empêche d'aller de l'avant et d'exister pleinement ? Spécialiste de la famille, Robert Neuburger nous montre ici comment la culpabilité peut se transmettre de génération en génération et amener enfants et petits-enfants à refuser aussi bien l'amour que le bonheur. Pour toutes ces familles blessées, il propose, à partir de son expérience professionnelle, une approche thérapeutique originale, alliant la reconnaissance des faits et l'introduction de nouveaux mythes et de nouveaux rites. Psychiatre, psychanalyste, Robert Neuburger est l'un des fondateurs du mouvement de thérapie familiale en France. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Nouveaux Couples et Les Territoires de l'intime.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Les Familles qui ont la tête à l'envers par Robert Neuburger en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Psychologie et Psychanalyse. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Première partie
LES FAMILLES BLESSÉES
CHAPITRE PREMIER
Aux origines d’un traumatisme
Suzie a été agressée sexuellement par un inconnu dans l’ascenseur de son immeuble. L’homme, profitant de ce qu’elle avait la clé, l’a traînée jusqu’à son appartement, vide à cette heure, et les violences ont continué. Suzie avait 9 ans au moment des faits. Ce traumatisme personnel s’est accompagné d’un effondrement familial. Son père, dans les semaines qui ont suivi, s’est montré incapable de faire face à ses obligations professionnelles, tant il était obsédé par le viol de sa fille. La mère, elle, n’a été d’aucune aide pour personne, pas même pour sa fille : elle ne pouvait pas lui parler, la calmer, la consoler. Suzie est restée longtemps dans un état de stupeur anxieuse, incapable de demeurer seule ou de sortir non accompagnée.
J’ai reçu cette famille plusieurs mois après les faits. Le tableau avait peu changé, hormis le fait que Suzie avait développé une obésité non négligeable. Les différents intervenants – médecins et psychologues –, sans nier l’importance du traumatisme, ne comprenaient pas pourquoi la situation n’évoluait pas.
L’exploration du contexte familial a permis d’éclairer la situation. Certes, le traumatisme personnel de Suzie était reconnu par ses parents, mais ceux-ci étaient surtout préoccupés par le jugement de leurs propres familles qui les considéraient comme responsables, sinon coupables, du viol. Les familles d’origine avaient l’une et l’autre une conception très traditionnelle des rôles parentaux : il n’était pas concevable qu’après l’école, les enfants ne soient pas attendus et accueillis par leur mère. Jugeant cette façon de voir aliénante et peu moderne, le père de Suzie avait eu l’audace d’opter pour une vision plus « moderne » et de laisser à sa femme le droit de travailler à l’extérieur. Voilà pourquoi Suzie avait la clé de l’appartement, ce que le reste de la famille désapprouvait.
Une véritable crise familiale a donc suivi l’agression sexuelle de Suzie. Au lieu du soutien attendu, les parents de la petite fille ont dû faire face au jugement très dur porté, aussi bien du côté maternel que paternel, par les grands-parents, les oncles, les tantes : leur conception de l’éducation des enfants a été jugée responsable du malheur arrivé et ce qui constituait le cœur de leur identité familiale a été mis à mal par la remise en question de leur « modernisme », par ailleurs très relatif.
Une violence qui laisse des traces
Au sens étymologique, un traumatisme est la trace, la conséquence immédiate et à distance d’un choc physique, isolé ou répété, volontaire ou non, touchant l’intégrité corporelle. La notion a été étendue au domaine psychique, notamment grâce à Freud. La notion de trauma psychique est évidemment métaphorique : on imagine que le psychisme d’un individu est l’équivalent d’un corps physique ; s’il y a des plaies physiques, pourquoi pas des plaies psychiques ? Comme toute métaphore, l’image est parlante, et peut être piégeante. Parlante parce qu’elle est forte ; piégeante parce qu’un psychisme n’est pas un corps : le psychisme est avant tout un mode de fonctionnement qui entraîne des convictions identitaires. Un trauma physique n’entraîne pas nécessairement un trauma psychique – chez les saints, le martyre ne fait que renforcer leur âme, c’est-à-dire leur psychisme – et, à l’inverse, il existe des traumas psychiques qui ne sont pas liés à une atteinte physique – trahisons, humiliations, injustices, etc.
Un trauma n’est pas une violence, mais le produit d’une violence. « Tu m’as traumatisé » signifie « Tu as exercé sur moi une violence qui a laissé des traces traumatiques ». Des violences équivalentes peuvent laisser des traces traumatiques chez certains, rien pour d’autres : tout dépend de la sensibilité de la personne qui subit la violence, de son rapport avec celle qui l’exerce et du contexte. C’est la raison pour laquelle on ne peut faire la liste des causes traumatiques : une même cause peut provoquer un traumatisme, ou ne rien provoquer du tout.
Les deux faces d’une même dignité
Poursuivons la métaphore : ce corps psychique comporte au moins deux dimensions qui correspondent aux deux dimensions de la dignité humaine : la dignité personnelle, individuelle, et la dignité d’appartenance ; la situation traumatisante est ce qui attaque l’une ou l’autre dignité. Dans chaque société, à chaque époque, il y a un jeu entre ces deux conceptions de la dignité, jeu qui est particulièrement mis en évidence par le traitement que réserve une société donnée à ses faibles et ses déviants – malades mentaux, délinquants, enfants…
Les frontières du moi
Est « traumatisant », le fait de ne pas avoir été respecté dans son intégrité, dans son intimité, c’est-à-dire dans son corps, dans ses convictions, dans son droit à l’existence. Autrement dit, est traumatisante la négation de sa dignité humaine. Un traumatisme vient toujours du non-respect de la dignité, sur le plan individuel – et on aboutit logiquement à un traumatisme individuel – ou sur le plan des appartenances – et la souffrance, bien sûr toujours vécue par un individu, trouve alors sa source dans le fait que ce n’est pas lui-même, mais ses appartenances à tel ou tel groupe qui n’ont pas été respectées.
Tout « corps social », et l’image n’est pas due au hasard, que ce soit une société dans son ensemble, un corps de métier, une institution, un groupe ethnique ou des groupes plus restreints – une association, un couple, un groupe d’amis – peut être frappé par un trauma. La simple menace peut déclencher des sentiments que l’on pourrait presque qualifier de « nationalistes » et dont on prend souvent conscience dans des circonstances inhabituelles, lorsque « la Patrie est en danger », par exemple. À la suite des événements du 11 Septembre, ce sentiment s’est exprimé dans tout le peuple américain, les différences entre citoyens s’effaçant devant la menace collective. Ce « nationalisme », cet esprit de corps qui est latent dans tout regroupement humain, est également présent dans des ensembles plus restreints comme la famille.
De l’individu à la famille : le passage
Dans l’histoire de la petite Suzie, un traumatisme a donné naissance à un autre traumatisme. Suzie a, en effet, subi un trauma individuel. Rien de ce qui fait son humanité n’a été respecté : elle a été considérée comme un outil de jouissance, un objet au service d’un pervers ; sa qualité d’être humain a été bafouée, ainsi que son droit à l’existence, sa liberté, son libre arbitre. Et les répercussions de cet événement ne s’arrêtent pas là : un second traumatisme découle du précédent, qui a trait aux qualités de sa famille, malmenées et contestées : le « modernisme » qui constituait le ciment de cette famille, son originalité, sa spécificité, son support identitaire, son drapeau, son emblème – dans le langage des thérapeutes, on dirait son « mythe » – a cessé d’être crédible. On a le sentiment que ce qui soutenait Suzie et ses parents, leur colonne vertébrale, s’est effondré…
Du mythe au traumatisme
Dans les mythes familiaux, comme dans tout dispositif mythique, on trouve trois sortes de signifiants : ceux qui indiquent le destin individuel, ce que l’on doit devenir quand on fait partie d’une famille donnée ; ceux qui indiquent comment on doit se comporter vis-à-vis des autres membres du groupe familial ; enfin, ceux qui signalent comment penser et comment agir face aux autres, à ceux qui sont étrangers au groupe. On trouve la même disposition dans une institution beaucoup plus vaste comme la France, dont la devise contient également des indications relatives à cette triple disposition mythique : la liberté comme destin individuel, l’égalité dans les rapports avec le groupe et la fraternité avec les étrangers.
Toute famille dispose de ces trois domaines mythiques, avec des éléments s’enracinant dans l’une ou l’autre des familles d’origine – leur existence sert, en effet, à faciliter la greffe nécessaire entre deux personnes qui fondent une famille, chacun apportant ce qu’il a reçu de convictions mythiques, de normes, de valeurs, d’idéaux de sa famille d’origine, soit pour le critiquer et proposer un modèle de vie et d’éducation différent, soit pour œuvrer en continuité2. Dans une telle configuration, le trauma familial est précisément ce qui atteint ou détruit un des éléments du mythe familial, voire parfois la totalité du mythe, comme dans le cas de la famille de Suzie. Suzie fait partie d’un groupe qui se sent solidaire d’elle et souffre de ne pas avoir su ou pu la protéger : ses parents. Ceux-ci ont été débordés par un problème grave et n’ont pas su y répondre, ils ont été confrontés à une attaque qui a blessé la famille au cœur : cet autre traumatisme se superpose au traumatisme individuel et affecte tous les membres de la famille, Suzie comprise.
Si on reprend maintenant la grille de lecture proposée plus haut, on peut donc dire d’un traumatisme familial qu’il est la conséquence d’une atteinte à la dignité d’un groupe familial comprise comme le droit de ce groupe à exister aux yeux de la famille élargie et, plus largement, aux yeux de la société dans laquelle vit ce groupe. Cette dignité inclut le droit à exercer une forme de souveraineté sur un territoire d’intimité familial, c’est-à-dire la liberté de gérer son existence pour autant que les lois sont respectées : droit de choisir son lieu de résidence, droit de choisir son mode de vie, ses modèles éducatifs, les supports idéologiques du groupe (éthique, religion, etc.). L’effet de ces attaques portées au mythe du groupe est d’empêcher les mécanismes réparateurs, présents dans toute famille, de fonctionner. Dans ce contexte, la pathologisation des attitudes des uns et des autres devient une solution : il est toujours possible de remplacer le mythe familial altéré par le mythe médical qui sera chargé d’opérer les réparations nécessaires, d’où la multiplication des consultations et traitements divers pour chacun des membres de cette famille ! Bien évidemment, ce type de solution ne peut engendrer qu’un état figé où les attitudes se répètent et se chronicisent.
Un trauma touche donc la partie « mythique » du groupe, celle qui donne vie au groupe, lui permet d’exister ou justifie son existence. Les situations traumatiques ne sont pas réservées aux familles frappées par un génocide, un crime, un viol, un inceste, même si ce sont celles-ci qui ont attiré l’attention des cliniciens en raison des conséquences non seulement sur ceux qui en ont été victimes, mais aussi sur leurs familles et sur leurs descendants. Des situations beaucoup plus banales comme des faillites, des licenciements, des injustices de tous ordres, des divorces, des abandons, des humiliations peuvent avoir des conséquences analogues, voire plus graves : il n’y a pas de rapport nécessaire entre la violence, la gravité d’un événement et son impact sur un groupe familial donné. Une agression relativement bénigne peut avoir des effets dévastateurs si ce trauma touche une valeur essentielle du groupe.
Ensemble, c’est tout
M. et Mme Bois-Joli* ont la quarantaine. Monsieur est concierge, madame s’occupe de la maison. Ils ont trois enfants de 14, 13 et 11 ans. La cause de la consultation est l’inquiétude de la mère depuis que la « catastrophe » a frappé. La nature de l’événement peut paraître dérisoire, mais il a entraîné l’effondrement familial.
Jusqu’à ces derniers temps, la famille Bois-Joli s’était transformée en équipe de hockey sur gla...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Table
- Dédicace
- Préface
- Première partie. LES FAMILLES BLESSÉES
- Seconde partie. RETOUR À LA VIE
- ÉPILOGUE. La trace d'un certain passé
- Notes
- Références bibliographiques
- DU MÊME AUTEUR
- Quatrième de couverture